George Orwell, « Réflexions sur Gandhi
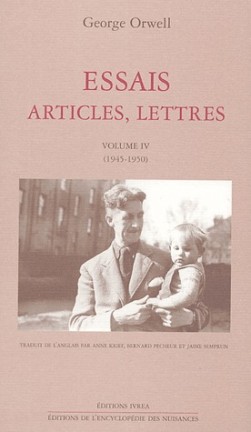
Version imprimable de Réflexions sur Gandhi
George Orwell
Réflexions sur Gandhi
(Partisan Review, janvier 1949)
Traduction par Anne Krief, Bernard Pecheur et Jaime Semprun
Ivrea/Encyclopédie des Nuisances, 2001
Jusqu’à preuve de leur innocence, les saints doivent toujours être considérés comme coupables. Mais l’examen auquel il convient de les soumettre n’est évidemment pas le même pour tous. Au sujet de Gandhi, les questions qui viennent à l’esprit sont celles-ci : dans quelle mesure était-il mû par la vanité – par l’idée qu’il se faisait de lui-même, vieil homme humble et nu, assis sur un tapis de prière, faisant chanceler les empires par sa seule force spirituelle –, et dans quelle mesure a-t-il transigé avec ses propres principes en se lançant dans la politique, indissociable par nature de la violence et de l’imposture ? Il faudrait, pour apporter une réponse précise à ces questions, examiner les actes et les écrits de Gandhi dans leurs plus infimes détails, car sa vie entière a été une sorte de pèlerinage où chaque acte avait une signification. Mais cette autobiographie (1) partielle, qui s’arrête dans les années vingt, témoigne fortement en sa faveur, d’autant plus qu’elle évoque ce qu’il aurait appelé la partie non régénérée de sa vie et nous rappelle que le saint – ou quasi-saint – était aussi un individu très capable et habile qui aurait pu, s’il l’avait voulu, réussir brillamment comme avocat ou administrateur, et peut-être même comme homme d’affaires.
À peu près à l’époque de sa première publication, je me souviens d’avoir lu les premiers chapitres de cette autobiographie dans les pages mal imprimées d’un journal indien. Ils me firent bonne impression, ce qui n’était pas alors le cas de Gandhi lui-même. Ce qu’évoquait son nom – tissage artisanal, « force spirituelle » et végétarisme – n’était guère attrayant, et son programme moyenâgeux n’était manifestement pas viable dans un pays arriéré, affamé et surpeuplé. Il était en outre évident que les Britanniques l’utilisaient, ou croyaient l’utiliser. À proprement parler, en tant que nationaliste, c’était un ennemi, mais comme il s’évertuait, lors de chaque crise, à éviter la violence – ce qui, du point de vue britannique, équivalait à empêcher toute espèce d’action efficace –, on pouvait voir en lui « un homme à nous ». Dans les conversations privées, certains en convenaient cyniquement. Les millionnaires indiens partageaient ce point de vue. Ils préféraient naturellement Gandhi, qui les invitait à se repentir, aux socialistes et aux communistes, qui, à la première occasion, comptaient bien les délester de leur argent. Il n’est pas sûr du tout que ce genre de calcul soit, à long terme, avisé : comme le dit Gandhi lui-même, « en fin de compte, les trompeurs ne trompent qu’eux-mêmes » ; quoi qu’il en soit, la mansuétude avec laquelle il fut presque toujours traité s’explique en partie par ce sentiment qu’il était utile. Les conservateurs anglais ne le dénoncèrent avec virulence que lorsque ce fut vis-à-vis d’un autre occupant, comme en 1942, qu’il prêcha la non-violence.
Mais même en cette occasion, je pus constater que les fonctionnaires britanniques qui en parlaient avec un mélange d’amusement et de désapprobation ressentaient également pour lui, à leur manière, une sympathie et une admiration réelles. Nul n’insinuait jamais qu’il fût corrompu, ni qu’il fût animé par une ambition vulgaire, ni qu’il eût jamais agi par couardise ou ressentiment. Lorsqu’on juge un homme comme Gandhi, il semble qu’on se place spontanément sur un tel plan d’élévation morale qu’on ne songe même plus à relever certaines de ses qualités élémentaires. La seule lecture de son autobiographie montre ainsi que son courage physique naturel était tout à fait exceptionnel : la façon dont il fut finalement assassiné le prouva bien, car un homme public qui aurait accordé à sa vie la moindre valeur ne se serait pas exposé aussi imprudemment. De même, il ne s’est guère montré enclin à cette méfiance obsessionnelle qui est, comme le dit avec raison E. M. Forster dans A Passage to India, le principal défaut des Indiens, comme l’hypocrisie est celui des Britanniques. Quoique sans aucun doute assez perspicace pour déceler la malhonnêteté, il semble avoir autant que possible accordé aux autres le bénéfice de la bonne foi et s’être attaché à voir en eux les qualités qui permettaient un certain dialogue. Et bien qu’il fût issu d’une famille bourgeoise assez pauvre, que ses débuts dans la vie aient été assez difficiles et que son aspect physique n’eût sans doute rien de remarquable, il n’en éprouva ni envie ni sentiment d’infériorité. Le préjugé racial, quand il le rencontra sous sa pire forme en Afrique du Sud, semble l’avoir plutôt stupéfié. Et alors même qu’il menait ce qui était de fait une guerre raciale, il ne considéra jamais les individus en termes de race ou de statut social. Le gouverneur d’une province, un millionnaire du coton, un coolie dravidien famélique, un simple soldat britannique, tous étaient pour lui des êtres humains avec lesquels on pouvait se comporter à peu près de la même manière. Il est remarquable que jusque dans les circonstances les plus durables, comme lorsqu’il se rendit très impopulaire en défendant la communauté indienne en Afrique du Sud, les amis européens ne lui aient jamais fait défaut.
Rédigée sous forme de courts épisodes pour être publiée en feuilleton, cette autobiographie n’est pas un chef-d’œuvre littéraire, mais la banalité même d’une bonne partie de son contenu contribue à la rendre remarquable. Il est bon de se voir rappeler que Gandhi eut d’abord les ambitions ordinaires d’un jeune étudiant indien et n’en vint à des positions extrémistes que progressivement, dans certains cas presque contre son gré. On apprend ainsi avec intérêt qu’il fut un temps où il porta un haut-de-forme, prit des leçons de danse, étudia le français et le latin, visita la tour Eiffel et essaya même d’apprendre à jouer du violon – tout cela dans le but d’assimiler la culture européenne aussi complètement que possible. Il n’était pas de ces saints qui se distinguent dès leur enfance par une piété phénoménale, et il n’appartenait pas non plus à la catégorie de ceux qui renoncent au monde après une vie de débauches extravagantes. Il confesse sans rien omettre ses péchés de jeunesse, mais il n’y a, en réalité, pas grand-chose à confesser. En frontispice du livre figure une photographie des quelques biens que possédait Gandhi lorsqu’il mourut : si l’on vendait tout ce qu’on voit là, on pourrait en tirer environ cinq livres. Les péchés de Gandhi, du moins ses péchés charnels, feraient à peu près aussi piètre figure si on les réunissait. Quelques cigarettes, quelques bouchées de viande, quelques annas chapardés à la servante dans son enfance, deux visites à un bordel (il s’enfuit chaque fois sans « rien faire »), un écart de conduite, évité de justesse, avec sa propriétaire à Plymouth, un mouvement de colère – telle en est la liste à peu près complète. Dès son enfance ou presque, il fit montre d’une profonde gravité, sentiment éthique plutôt que religieux, mais n’eut aucune idée précise de sa vocation avant la trentaine. C’est par le biais du végétarisme qu’il participa pour la première fois à une activité que l’on peut dire publique. Derrière ses qualités les moins ordinaires, on perçoit toujours le solide sens pratique de ses ancêtres marchands. On a le sentiment que, bien qu’ayant abandonné toute ambition personnelle, il n’en resta pas moins un avocat énergique et plein de ressources, un organisateur politique efficace, attentif à limiter les dépenses, habile à manœuvrer les comités et infatigable dans la collecte des fonds. Son caractère était extraordinairement complexe, mais ne comportait presque aucun trait qu’on puisse qualifier de mauvais. Et même les pires ennemis de Gandhi seraient prêts à reconnaître, je pense, que c’était un homme exceptionnel dont la seule existence a enrichi le monde. Qu’il ait aussi été un homme sympathique, et que ses enseignements soient d’une grande valeur pour qui n’accepte pas les croyances religieuses sur lesquelles ils se fondaient, c’est ce dont j’ai toujours été moins convaincu.
Depuis quelques années, on parle volontiers de Gandhi non seulement comme s’il avait sympathisé avec les mouvements de gauche occidentaux, mais presque comme s’il en avait fait partie. Les anarchistes et les pacifistes, en particulier, l’ont revendiqué comme un des leurs, ne relevant que son opposition au centralisme et à la violence étatique, et ignorant ce qui dans sa doctrine tendait à rabaisser l’homme et la vie terrestre. Il me semble pourtant indispensable de bien voir que la doctrine de Gandhi ne saurait s’accommoder de la conviction que l’homme est la mesure de toutes choses et que notre tâche consiste à rendre la vie digne d’être vécue sur cette terre, qui est la seule que nous ayons. Cette doctrine n’a de sens que si Dieu existe et si le monde matériel est une illusion dont il faut se défaire. Il n’est pas inutile d’examiner la règle de vie que Gandhi s’est imposée et que devait selon lui adopter quiconque voulait servir Dieu ou l’humanité – même s’il n’exigeait pas de chacun de ses partisans qu’il la respecte intégralement. Tout d’abord, il ne faut pas consommer de viande, ni si possible de nourriture d’origine animale, sous quelque forme que ce soit. (Gandhi lui-même, pour des raisons de santé, dut transiger à propos du lait, mais il semble qu’il ait ressenti cette concession comme une défaite.) Pas d’alcool ni de tabac, ni épices ni condiments, même d’origine végétale, car on ne doit pas s’alimenter par plaisir, mais uniquement pour restaurer ses forces. Deuxièmement, si possible, pas de relations sexuelles. Si ces relations ont lieu, ce doit être à seule fin de procréer et vraisemblablement de loin en loin. Gandhi lui-même, vers l’âge de trente-cinq ans, fit vœu de bramahcharya, ce qui impliquait non seulement une chasteté absolue, mais aussi l’extinction de tout désir sexuel. Il semble que cet état soit difficile à atteindre sans un régime alimentaire spécifique et des jeûnes fréquents. L’un des dangers de la consommation de lait est qu’elle risque d’éveiller le désir sexuel. Enfin – et c’est là le point crucial –, celui qui recherche le bien ne saurait entretenir aucune espèce d’amitié intime ou d’amour exclusif.
Les amitiés intimes sont dangereuses, selon Gandhi, parce que « les amis s’influencent réciproquement » et que l’on peut être amené à commettre le mal par loyauté envers un ami. C’est parfaitement vrai. De plus, pour aimer Dieu, ou même l’humanité dans son ensemble, on doit se garder de privilégier un individu particulier. Cela aussi est parfaitement vrai et marque le point où les conceptions humanistes et religieuses entrent en contradiction. Pour l’être humain ordinaire, l’amour n’a aucun sens s’il ne signifie pas que l’on aime certaines personnes plus que d’autres. Cette autobiographie ne nous permet pas de savoir quel genre d’égards Gandhi a eus, ou n’a pas eus, pour sa femme et ses enfants, mais elle nous indique en revanche qu’en trois occasions, il s’est montré disposé à laisser mourir sa femme ou un de ses enfants plutôt que de leur donner la nourriture d’origine animale prescrite par le médecin. Il est vrai que l’issue fatale a chaque fois été évitée, et aussi que Gandhi – tout en exerçant, on le devine, une forte pression morale en sens contraire – a toujours laissé au malade la possibilité, s’il le voulait, de commettre un péché pour rester en vie : pourtant, si la décision n’avait appartenu qu’à lui, il aurait interdit toute nourriture d’origine animale, quels qu’aient pu en être les risques. Selon lui, il faut qu’il existe une limite à ce que nous sommes prêts à faire pour rester en vie, et cette limite se situe bien en deçà de l’ingestion d’un bouillon de poule. Cette attitude est peut-être très noble, mais au sens que la plupart des gens donneraient, me semble-t-il, à ce mot, elle est inhumaine. Être humain consiste essentiellement à ne pas rechercher la perfection, à être parfois prêt à commettre des péchés par loyauté, à ne pas pousser l’ascétisme jusqu’au point où il rendrait les relations amicales impossibles, et à accepter finalement d’être vaincu et brisé par la vie, ce qui est le prix inévitable de l’amour porté à d’autres individus. Sans doute l’alcool, le tabac et le reste sont-ils des choses dont un saint doit se garder, mais la sainteté est elle-même quelque chose dont les êtres humains doivent se garder. La première réponse qui vient à l’esprit est de celles dont il faut se défier. À notre époque où les yogis font florès, il est admis sans discussion que le « détachement » est supérieur à l’acceptation sans réserve de la vie terrestre, et que l’homme ordinaire ne s’y dérobe que parce qu’il préfère la facilité : en d’autres termes, que l’être humain moyen est un saint raté. Pourtant, rien n’est moins sûr. Beaucoup de gens n’ont vraiment pas la moindre envie d’être des saints, et beaucoup de ceux qui atteignent la sainteté ou y aspirent n’ont sans doute jamais été très tentés d’être des hommes. Si l’on pouvait en mettre au jour les ressorts psychologiques, je pense qu’on s’apercevrait qu’à l’origine du « détachement » il y a avant tout le désir d’éviter la douleur de vivre, et par-dessus tout l’amour, qui, sexuel ou non, est une rude épreuve. Mais il n’est pas nécessaire de se demander ici quel idéal est supérieur, du rejet de la vie terrestre ou de l’humanisme. L’important est qu’ils sont incompatibles. Entre Dieu et l’homme, il faut choisir, et tous les « radicaux » et les « progressistes », du libéral le plus modéré à l’anarchiste le plus extrémiste, ont choisi l’homme.
Le pacifisme de Gandhi peut cependant, dans une certaine mesure, être séparé du reste de sa doctrine. Il avait des motifs religieux, mais Gandhi le présentait comme une technique spécifique, une méthode pour obtenir des résultats politiques précis. La conception de Gandhi différait de celle de la plupart des pacifistes occidentaux. La Satyagraha, élaborée d’abord en Afrique du Sud, était une sorte de guerre non violente, une manière de vaincre l’ennemi sans lui faire de mal et sans ressentir ni susciter de haine. Elle impliquait le recours à des actes tels que la désobéissance civile, les grèves, le fait de se coucher devant les trains, de supporter les charges de police sans reculer et sans riposter, et ainsi de suite. Selon Gandhi, il était erroné d’utiliser l’expression « résistance passive » pour traduire Satyagraha : il semble que ce terme signifie, en gujarati, « fermeté dans la vérité ». Jeune, Gandhi avait servi comme brancardier – du côté britannique dans la guerre des Boers, et il était prêt à recommencer en 1914-1918. Même après avoir complètement renoncé à la violence, il fut assez honnête pour reconnaître qu’en temps de guerre, il est généralement nécessaire de prendre parti. Il n’adopta pas et ne pouvait d’ailleurs adopter, toute sa vie politique ayant tourné autour de la lutte pour l’indépendance nationale – la position stérile et malhonnête consistant à affirmer que, dans toute guerre, les deux camps se valent absolument et qu’il est sans conséquence aucune que l’un ou l’autre l’emporte. À la différence de la plupart des pacifistes occidentaux, il ne cultiva pas non plus l’art d’éviter les questions embarrassantes. Lors de la dernière guerre, une des questions auxquelles tout pacifiste était à l’évidence tenu de répondre était celle-ci : « Que faire pour les juifs ? Êtes-vous prêt à les laisser exterminer ? Sinon, que proposez-vous pour les sauver sans avoir recours à la guerre ? » Je dois dire que je n’ai jamais entendu aucun pacifiste occidental répondre honnêtement à cette question ; en revanche, j’ai entendu toutes sortes de réponses dilatoires, en général sur le modèle « c’est celui qui le dit qui l’est ». Or il se trouve qu’une question très voisine a été posée à Gandhi en 1938, et que la réponse se trouve consignée dans Gandhi and Stalin, de M. Louis Fischer. Si l’on en croit M. Fischer, les juifs allemands devaient d’après Gandhi se suicider collectivement, ce qui « aurait fait prendre conscience au monde et au peuple allemand de la violence de Hitler ». Après la guerre, il se justifia ainsi : les juifs ayant de toute manière été tués, ils auraient aussi bien pu donner un sens à leur mort. Cette manière de voir sidéra même un admirateur aussi fervent que M. Fischer, alors qu’elle n’était que simple honnêteté de la part de Gandhi. Si l’on se refuse à tuer, on doit être prêt à ce que des vies soient sacrifiées de quelque autre manière. En 1942, quand il prônait la résistance non violente à l’invasion japonaise, Gandhi n’hésitait pas à reconnaître qu’une telle tactique pouvait coûter la vie à plusieurs millions de personnes.
Par ailleurs, il semble que Gandhi, qui, ne l’oublions pas, était né en 1869, ne comprenait pas la nature du totalitarisme et voyait toutes choses dans l’optique de sa lutte personnelle contre le gouvernement britannique. Ici, le point important n’est pas tellement que les Britanniques l’aient traité avec mansuétude, mais qu’il ait toujours été en mesure de faire entendre sa voix. Comme l’indique la phrase citée ci-dessus, il croyait pouvoir susciter une « prise de conscience du monde » – mais encore faut-il que le monde soit informé de vos actions. On voit mal à quoi pourraient servir les méthodes de Gandhi dans un pays où les opposants au régime disparaissent en pleine nuit sans qu’on n’entende plus jamais parler d’eux. Sans presse libre ni droit de réunion, il est impossible non seulement d’en appeler à l’opinion publique étrangère, mais aussi de susciter un mouvement de masse, ou même de faire connaître ses revendications à ses adversaires. Existe-t-il en ce moment un Gandhi en Russie ? Et s’il existe, que fait-il ? Pour que les Russes pratiquent en masse la désobéissance civile, il faudrait que tous aient la même idée au même moment ; et de toute façon, si l’on en juge d’après l’histoire de la famine en Ukraine, cela ne changerait rien. Mais admettons qu’une résistance non violente puisse être efficace contre le gouvernement de son propre pays, ou contre une puissance occupante : resterait encore à la mettre en pratique à l’échelle internationale. Les déclarations contradictoires de Gandhi au cours de la dernière guerre semblent indiquer qu’il avait conscience de cette difficulté. Dès qu’il s’agit de politique étrangère, ou bien le pacifisme cesse d’être pacifiste, ou bien il devient pur et simple défaitisme. En outre, le postulat qui a si bien réussi à Gandhi dans ses relations avec les individus, selon lequel tout être humain est susceptible d’une certaine compréhension et se montrera sensible à un geste généreux, mérite d’être pour le moins nuancé. Il peut, par exemple, perdre toute validité lorsqu’on a affaire à un dément. La question est alors : qui est fou ? Hitler était-il fou ? Ne peut-il arriver que toute une culture soit démente au regard des critères d’une autre culture ? Et existe-t-il, pour autant qu’on puisse savoir exactement ce qu’éprouvent des peuples entiers, la moindre relation entre un acte généreux et une réaction amicale ? La gratitude joue-t-elle un rôle quelconque dans la politique mondiale ?
Ces questions, ainsi que d’autres de même nature, doivent être examinées, et elles doivent l’être vite, pendant les quelques années qui nous restent avant que quelqu’un n’appuie sur le bouton et que les fusées ne se mettent à sillonner le ciel. La civilisation ne résisterait sans doute pas à un autre conflit majeur, et on ne saurait exclure a priori que la non-violence soit une solution. On peut porter au crédit de Gandhi qu’il n’aurait pas hésité à réfléchir honnêtement au genre de questions que j’ai évoquées ci-dessus ; en fait, il est probable qu’il les a pour la plupart effectivement abordées dans l’un ou l’autre de ses innombrables articles de presse. On garde de lui l’idée qu’il y avait beaucoup de choses qu’il ne comprenait pas, mais rien qu’il eût craint de dire ou de penser. Je n’ai jamais réussi à éprouver beaucoup de sympathie pour Gandhi, mais je ne suis pas certain qu’en tant que penseur politique il ait eu tort sur l’essentiel, et je ne crois pas non plus que sa vie ait été un échec. Il est étrange qu’après son assassinat, beaucoup de ses admirateurs les plus fervents se soient affligés qu’il ait vécu juste assez longtemps pour voir ruiner l’œuvre de toute une vie, au motif que l’Inde était engagée dans une guerre civile dont on avait toujours su qu’elle serait une des conséquences de l’indépendance. Mais ce n’était pas à tenter d’apaiser l’hostilité entre hindous et musulmans que Gandhi avait consacré sa vie. Son principal objectif politique, mettre fin à la domination britannique par des moyens pacifiques, avait en tout cas été atteint. Comme souvent, on peut tirer des faits plusieurs interprétations contradictoires. D’un côté, les Britanniques ont bien quitté l’Inde sans combattre, ce que fort peu d’observateurs auraient prédit encore un an auparavant. D’un autre côté, la décision a été prise par un gouvernement travailliste, et il est hors de doute qu’un gouvernement conservateur eût agi différemment, surtout s’il avait été dirigé par Churchill. Mais si une large fraction de l’opinion publique britannique était, en 1945, acquise à l’indépendance de l’Inde, n’était-ce pas dans une certaine mesure dû à l’influence personnelle de Gandhi ? Et si, un jour peut-être, l’Inde et la Grande-Bretagne finissent par établir des relations honnêtes et amicales, ne sera-ce pas en partie parce que Gandhi, en menant son combat opiniâtrement et sans haine, aura assaini le climat politique ? Le seul fait que de telles questions viennent à l’esprit en dit long sur la stature du personnage. On peut éprouver, comme c’est mon cas, une sorte d’aversion esthétique pour Gandhi, on peut rejeter les revendications de sainteté formulées en sa faveur (et qu’il n’a, d’ailleurs, jamais formulées lui-même), on peut également rejeter la sainteté en tant qu’idéal et tenir par conséquent les préoccupations fondamentales de Gandhi pour anti-humanistes et réactionnaires ; mais si on le considère simplement comme un homme politique, et qu’on le compare aux autres grandes figures politiques de notre époque, quelle bonne odeur a-t-il réussi à laisser derrière lui !
Note
- The Story of my Experiments with Truth, de M.K. Gandhi, traduit du gujarati par Mahadev Desai. (En français : Expériences de vérité, traduction G. Belmont.) (N.d.T.)
via George Orwell, « Réflexions sur Gandhi | «Les Amis de Bartleby

