Jaime Semprun, « Les syllogismes démoralisateurs »
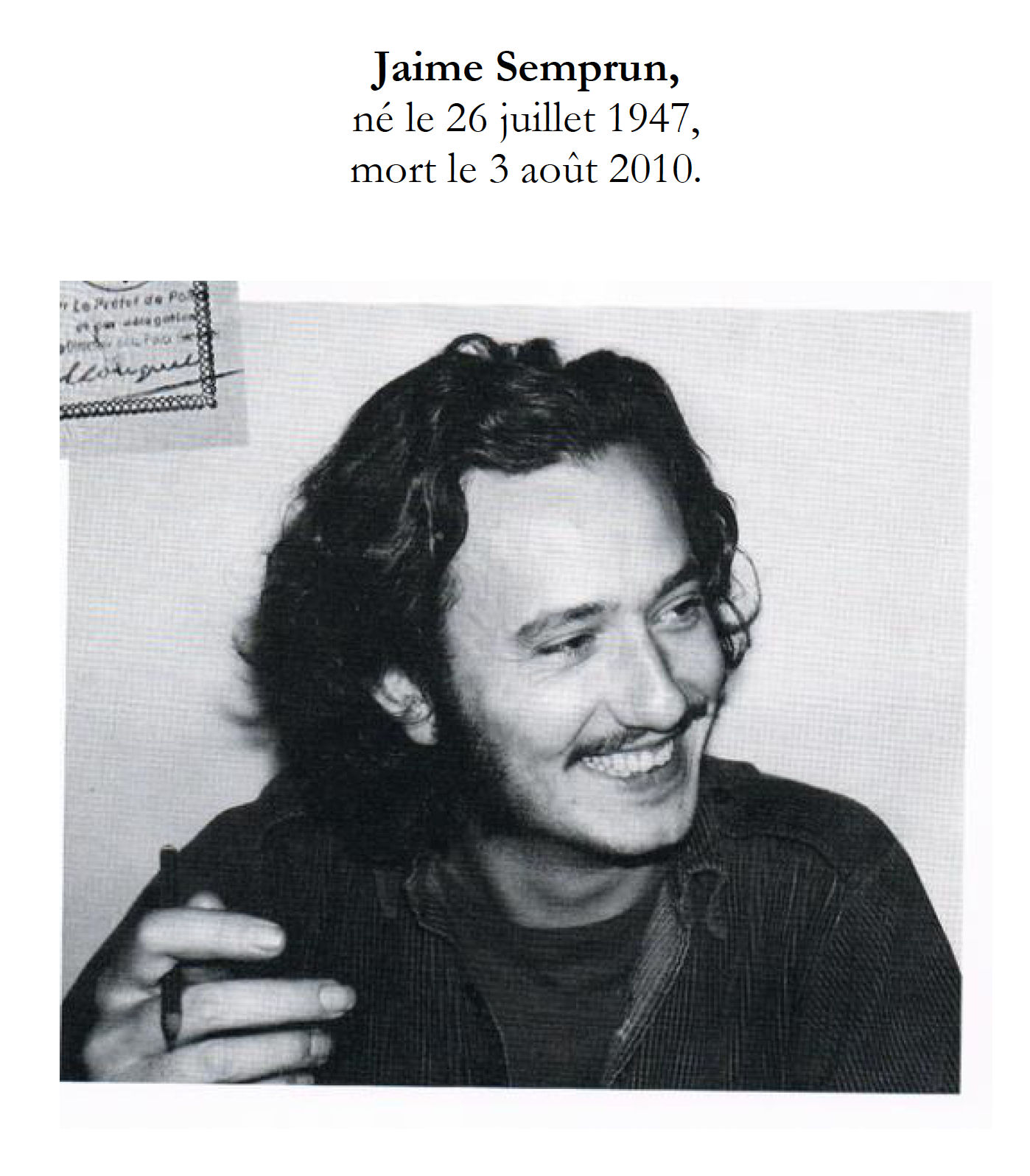
Version imprimable des Syllogismes démoralisateurs
Jaime Semprun
Les syllogismes démoralisateurs
Renversement des preuves de l’inexistence
de la révolution portugaise données par les idéologues extrémistes
Article publié dans la revue L’Assommoir n° 3, Paris, 1979.
Une revue qui s’appelle La Guerre sociale a publié dans son second numéro, en mars 1978, un article intitulé “Les luttes de classes au Portugal”, et dont le but est de démontrer combien se sont abusés ceux qui ont cru voir là quelque chose comme une révolution prolétarienne.
« Cette émergence laborieuse et avortée d’un pouvoir populaire sur les usines et les quartiers qui a tant épaté les gauchistes et les populistes de tout poil ne nous éblouit pas. » (p. 55).
Ces exigeants connaisseurs rejettent donc comme l’expression d’une même jobardise tout ce qui s’est écrit sur le sujet avec quelque intention révolutionnaire avant la tardive manifestation de leur lucidité. Et entre autres La Guerre sociale au Portugal, publié en juin 1975.
Il serait certes excellent que les textes révolutionnaires, quand il y en a, soient plus souvent améliorés par la critique réelle, et dans ce cas précis qu’un livre qui ne s’était vu opposer que la bêtise intéressée des journaux Le Monde ou Libération soit enfin critiqué au nom d’intérêts tous contraires. Mais nous allons voir que cette critique, qui se veut formulée d’un point de vue révolutionnaire – si l’on peut dire, puisqu’il consiste à affirmer qu’il n’y a pas eu de révolution au Portugal –, n’est pas révolutionnaire, et n’est même pas une critique. L’intérêt de ce texte est plutôt que s’y trouvent cristallisées à l’état solide, et même très épais, diverses sottises révolutionnaristes qui flottent à l’état diffus dans l’air pollué du temps ; et accessoirement de montrer, par l’aigreur de pion qui s’y donne libre cours, que si cette Guerre sociale, qui avait réservé jusque-là l’exercice de son ardeur polémique au méta-bordiguiste Camatte, s’était bien gardée de toute allusion à la théorie révolutionnaire moderne (n’en apprenant l’existence à ses lecteurs qu’à propos d’une contestation d’héritage portant sur un texte vieux de dix ans), ce n’était pas par un compréhensible souci de ses rédacteurs de se déterminer par leur propre opération plutôt que par référence à ce que d’autres ont accompli, mais tout simplement parce qu’il y sont hostiles. Ils ont sans aucun doute leurs raisons pour cela. Mais ces raisons subjectives de leur hostilité restent cependant dissimulées, et ils en appellent contre mon texte à l’objectivité des faits. Le résultat, que tout lecteur de bonne foi peut apprécier dans l’article paru sous la signature de « Karamazov », étant qu’ils se montrent aussi mensongers sur le Portugal que sur eux-mêmes.
« Il est une façon de parler des choses pour n’en rien dire de sérieux. C’est le cas du talentueux Jaime Semprun dans « La Guerre sociale au Portugal » (avril 1975). Talentueux, puisque Semprun fait dans le talent comme Voyer dans le génie, Migeot dans la stratégie, et Lebovici dans la révolution. »
Dans son admirable concision, l’exorde de la diatribe karamazovienne va droit à l’essentiel et désigne d’emblée le ressort caché qui fait mouvoir l’artificieux étalage de talent auquel je me suis imprudemment livré.
Il s’agit donc de sérieux, et de talent. L’un m’est absolument refusé, nous verrons plus loin au nom de quels critères ; l’autre m’est concédé, mais à des conditions à vrai dire très restrictives. Ce ne peut être en effet qu’un talent d’un genre bien particulier, relevant de l’affectation raccrocheuse, de la parade fallacieuse (l’expression « faire dans » implique tout cela, et quelques autres choses encore, aussi peu estimables), puisque du même acabit que divers autres trucages, tous également énormes et maladroits. Il n’y a donc rien là à discuter, le regard doit glisser au-delà de cet objet inessentiel qu’est le texte lui-même pour suivre « Karamazov » jusqu’à la révélation de la substance dont un tel talent n’est qu’un accident. In cauda venenum : c’est la fin de ce paragraphe qui en délivre le sens, la série d’équivalences posées entre mon talent, le génie de Voyer et la stratégie de Migeot aboutissant à la révolution de Lebovici, révolution dont la réalité est effectivement plus difficile à établir que celle de la révolution portugaise, chacun en conviendra.
Je n’ai pas à discuter ici de ce que « Karamazov » appelle le génie de Voyer et la stratégie de Migeot, mais à noter que les choses ainsi désignées ont pour seule détermination commune, entre elles et avec mon « talent », d’avoir à divers moments été portées à la connaissance du public par l’entremise des éditions Champ libre, lesquelles semblent bien constituer la seule réalité permettant de mettre de quelque manière en relation l’existence de la révolution et celle de Lebovici. Voilà donc pourquoi tout ce qui apparaît dans ces livres doit être identiquement entaché de simulation (mais quand la cuistrerie marxeuse s’étale dans Le Mouvement communiste de Barrot, ouvrage publié par les soins de ces mêmes trompeuses éditions, faut-il penser qu’elle est simulée ?).
Je n’avais jamais songé jusqu’ici à me sentir le moins du monde responsable du génie de Voyer ou de la stratégie de Migeot, non plus que du mouvement communiste de Barrot ou de la révolution de Lebovici ; mais je vois trop la force de la logique karamazovienne pour ne pas rougir d’une aussi coupable insouciance. Puisque…, comme : voilà des trouvailles d’un talent authentique ; car si le talent est l’adéquation réussie de la forme au contenu, quel talent dans ce raccourci téléscopant audacieusement la qualité d’un texte, celles d’autres textes publiés par le même éditeur, et les motifs prêtés à cet éditeur, pour faire sentir directement ce que la vulgaire démonstration aurait eu le plus grand mal à établir, à savoir que tout cela se vaut, est également révoltant et ne doit être distingué en rien.
On savait que la théorie la plus récente de l’édition avait considérablement simplifié la question très complexe du jugement d’un texte en la réduisant à celle du jugement de son éditeur. Cette théorie radicale se trouve ici appliquée avec toute la conséquence qui convient selon le principe de la responsabilité collective : on était déjà responsable de son éditeur, et de tous les mobiles occultes que les théoriciens peuvent lui découvrir à partir de ce fait avéré et ignominieux qu’il a de l’argent pour publier des livres, on le sera aussi désormais de tout ce que cet éditeur a pu choisir de publier par ailleurs. Et il suffira que les émules de « Karamazov » se départent du reste de timidité qui modère encore fâcheusement la nouveauté révolutionnaire de sa théorie pour qu’on voie quelle vaste carrière s’ouvre-là à la cohérence radicale : imprimeurs, diffuseurs, libraires, tout sera mis au compte de l’auteur, et l’on verra alors combien se compromettent lamentablement avec ce qui existe, qui ne sont pas ceux que l’on pensait. Mais je laisse développer à de plus compétents que moi cette théorie véritablement matérialiste de l’édition.
J’avoue humblement n’avoir jamais pensé qu’il me faudrait un jour me justifier de l’accusation de talent, quoique j’eusse assurément dû concevoir qu’une telle singularité, si elle venait à se manifester, ne manquerait pas de susciter la vigilante méfiance des farouches égalitaristes modernes, tous partisans conséquents de la démocratie du non-talent. Mais alors même qu’il m’accable, je ne peux espérer me laver de cet affreux soupçon en faisant voir les nombreux défauts de mon texte, quand ce n’est pas dans un objet aussi fragile et incertain que se trouve la preuve de mon talent supposé, et l’explication de sa nature mauvaise, mais dans une circonstance extérieure aussi avérée, et universellement blâmée, que l’existence des éditions Champ Libre. Je me vois donc contraint d’accorder à « Karamazov » que je suis incapable de rien produire qui démente catégoriquement son imputation. Je peux d’autant moins nourrir le vain espoir de dissimuler cette indélébile tache de sang intellectuelle qui souille quiconque a été, est ou sera en relation directe ou oblique avec ces funestes éditions, que ma servilité à leur égard, et les complaisances qu’elle me vaut, viennent encore d’être prouvées tout récemment par la publicité qu’elles ont gracieusement donnée à la correspondance où je m’exprimais le plus exhaustivement à ce sujet.
Après qu’il a ainsi, d’entrée, disqualifié absolument les thèses défendues dans La Guerre sociale au Portugal, on s’étonne presque que « Karamazov » montre encore la mansuétude de les discuter quelque peu. Aussi est-ce plutôt à en dénoncer l’ineptie qu’il s’emploie, par un montage de citations qui n’a sans doute pas pour but, quoique cela ressorte au mieux de la comparaison avec leur environnement immédiat, de faire apprécier au lecteur avec quelle ostentation j’exerce mon détestable talent. Non, les citations ont ici valeur démonstrative, et la démonstration porte sur le contenu : diligemment escortées de commentaires adéquats, elles visent à mettre en lumière la ridicule absurdité d’un texte dont l’auteur a cru devoir, contre toutes les calomnies et tous les mensonges, prendre la défense de la révolution portugaise ; et ceci sans attendre que La Guerre sociale en ait délivré la peu engageante vérité, celle de « ces formes bizarroïdes qui émergent sur un terrain social aride et rocailleux » (p. 55).
« Mais son livre, qu’est-il d’autre que la mise en style d’une version appauvrie du conseillisme ? »
Ici, au-delà de la question du style qui semble obséder ce malheureux graphomane, il faut avant tout savoir pour savourer cette mordante ironie que La Guerre sociale a hérité du vieux bordiguisme ce point d’honneur idéologique d’être absolument et en toutes circonstances hostile à l’organisation des travailleurs en conseils révolutionnaires. Voilà comment les rédacteurs de cette revue se distinguent du reste de l’ultra-gauchisme, et ils sont bien conscients qu’il leur faut s’accrocher fermement à cet article de foi pour ne pas être confondus avec le vulgum pecus :
« Nous ne prétendons pas que la révolution communiste soit chose facile. Et, précisément, pour nous, il s’agit de ne pas en escamoter la difficulté en faisant intervenir un intermédiaire : État ouvrier, période de transition, conseils, parti ou conscience prolétarienne, auxquels on confie la mission de la résoudre » (p. 3).
Et s’il est fait référence à ces conseils que des travailleurs peuvent se laisser lâchement aller à former pour escamoter la difficulté de leur révolution, peu importe à ces penseurs de la révolution communiste sans moyens que ce soit pour, d’un même mouvement, les redéfinir à la lumière de leurs tâches modernes et critiquer historiquement leurs limitations dans le passé ; ou au contraire pour valoriser positivement ces limitations comme nec plus ultra de l’émancipation, à la manière des idéologues autogestionnistes. « Karamazov » et ses frères ne s’embarrassent pas de ces distinctions : tous ceux qui veulent pervertir la pureté de leur mouvement communiste en posant intempestivement la question des médiations nécessaires sont à vouer à l’exécration prolétarienne au même titre que Rocard ou Mario Soares.
Faute d’une débauche de talent dont on ne saurait sans une grande mauvaise foi faire le reproche à ces vertueux penseurs, on appréciera le sérieux de leur pratique radicale de l’amalgame : « État ouvrier, période de transition, conseils, parti ou conscience prolétarienne », tout cela est à mettre dans le même sac, celui des « intermédiaires ». La confusion ici opérée entre intermédiaire (au sens de Kollontaï : « Une troisième personne décide de votre sort : voilà l’essence de la bureaucratie ») et médiation identifie le plus sérieusement du monde une chose à son contraire : ce qui sépare et ce qui unifie, ce qui prive les prolétaires de leurs moyens et ce qui les leur donne, l’impuissance à maîtriser directement sa propre action et la conquête du terrain pratique de la conscience. (Mais il est vrai que la conscience prolétarienne n’est elle-même pour ces guerriers sociaux qu’un lamentable leurre ; pourtant ils nous informent plus loin doctement que :
« Le nombre de ceux qui se seront assimilé au préalable la théorie révolutionnaire – et auront donc clarifié et aiguisé leurs aspirations communistes – importera fort dans les affrontements à venir. » (p. 4).
Cette théorie révolutionnaire sur laquelle doivent s’aiguiser les aspirations communistes n’est évidemment pas un « intermédiaire » bien gênant puisqu’elle n’existe nulle part ailleurs que dans leur revue ; et c’est donc du nombre de ses lecteurs dont il s’agit ici, ce qui a effectivement peu à voir avec une quelconque « conscience prolétarienne ».)
Ainsi envisagée comme devant se réaliser sans aucun autre moyen historique que la « théorie révolutionnaire » de La Guerre sociale, ni aucune conscience de ses buts chez ses protagonistes, la révolution communiste est effectivement d’une difficulté absolue, propre à décourager de plus vaillants guerriers que ces sociaux-là ; mais eux-mêmes n’en sont pas autrement affectés, car ainsi le souci de la faciliter un peu ne risque pas de les troubler dans leurs assurances confortables et leurs travaux semi-érudits.
Pour preuve de mon conseillisme appauvri, le défenseur du bordiguisme enrichi fait donc une première longue citation de mon texte :
« Inutile de passer ici en revue les centaines de “Lip” qui sont, depuis des mois, la vie concrète de milliers et de milliers de travailleurs. Qu’il suffise de dire qu’une grande partie du Portugal vit grâce à la capacité d’auto-organisation des travailleurs, et ne survit que grâce à celle des soldats. Et quand un pays ne peut plus être gouverné contre les travailleurs, il ne peut bientôt plus être gouverné que par eux ou en leur nom. Mais pour que la représentation prenne la place de la classe, au train où vont les choses, ou plutôt ce qui les fait danser, il faudra une répression ouverte. »
Puis il enchaîne :
« Sous la plume de Semprun, tout est clair. Inutile de passer en revue ce qui risquerait de déranger quelque peu une vision qui se contente d’opposer la classe (bonne) et sa représentation (mauvaise). »
Quoique je ne cherche certainement pas à être obscur, je ne pense pas devoir en l’occurrence être félicité de ma clarté : le lecteur en est beaucoup moins redevable à mon talent particulier qu’à la révolution portugaise elle-même, qui a, comme toutes les révolutions tant qu’elles vont de l’avant, tout clarifié en obligeant ses divers ennemis, au premier rang desquels les staliniens, à se déterminer par rapport à elle. Au-delà du « contentement » que chacun peut naïvement trouver là, s’il n’a pas le scepticisme aussi radical que les idéologues du communisme vrai, l’étonnant serait seulement, si l’on pouvait encore connaître quelque étonnement dans ce genre, qu’il se trouve des gens pour refuser de voir cette clarification qu’opère la classe prolétarienne quand elle s’oppose à sa représentation et commence à démentir ceux qui parlent en son nom, ou pour voir là une « vision ». Un quelconque Max Gallo disait de même au sujet de l’hypothèse selon lui extravagante, formulée dans le Précis de récupération, d’une prochaine révolution russe :
« La Russie elle-même connaîtra les soulèvements prolétariens : balayés alors Sakharov et Soljénitsyne. Au profit de qui ? Peut-être des Conseils ouvriers, que l’auteur, dans un livre précédent, a vus au travail dans la révolution portugaise. » (« L’Express », 26 janvier 1976)
Mais là où le prudent historien du mensonge immédiat se contentait d’insinuer que j’étais seul, dans mon délire, à avoir vu ce que tant d’autres, bureaucrates, policiers, journalistes, ont très bien vu aussi quoiqu’ils n’en parlent guère, de plus profonds savants peuvent conclure à la « vision » avec toute l’assurance que procure la base axiomatique de principes comme ceux-là :
« Ou la communisation est possible, ce qui dépend du développement des forces productives locales, et de la situation mondiale, ou elle ne l’est pas – et, dans ce cas, il n’y a pas une porte de sortie qui s’appellerait autonomie ouvrière. » (p. 61)
« L’opposition bureaucratie/autonomie ouvrière ne contient pas l’opposition capitalisme/communisme. » (p. 65).
Ainsi, après avoir calculé l’impossibilité de la « communisation », et si les travailleurs s’obstinent cependant dans de vaines luttes autonomes, nos idéologues doctrinaires peuvent toujours se consoler en affirmant que ces luttes antibureaucratiques ne « contiennent pas » l’opposition « capitalisme/communisme ». On se contient mal devant ces marottes de sectaires débitées sur le ton d’oracle de l’infaillibilité scientifique. Les spécialistes du formalisme des abstractions vides ramènent la contradiction entre la réalité et leurs schémas préétablis à une comparaison des validités méthodologiques respectives de deux oppositions formelles ; et depuis ces sommets de l’abstraction, la réalité leur paraît d’un contenu bien pauvre. Si l’on ne rougissait pas de recourir à Hegel pour critiquer quelque chose comme la pensée de « Karamazov », on montrerait là la ratiocination, qui sait si bien, avec sa sagesse arbitraire acquise ailleurs, se comporter négativement à l’égard du contenu qu’elle appréhende, le réfuter et le réduire à néant ; puis, pour avoir tout de même un contenu, ramasser quelque chose d’autre n’importe où et s’adonner à la vanité de son savoir.
On voit bien cependant que « l’opposition capitalisme/communisme », telle que ces guerriers en font paisiblement usage, contient absolument tout et peut leur permettre de pontifier indéfiniment sur tous les sujets avec un égal bonheur théorique :
« Le problème pour le communisme n’est pas d’instaurer l’égalité des hommes et des femmes. » (p. 25) ;
« La révolution communiste n’est pas le heurt de deux armées, comme cela se voit généralement dans les conflits guerriers, et dont l’une défendrait le vieux monde et l’autre annoncerait le nouveau. » (p. 40) ;
« Le communisme n’est pas le prolongement du capitalisme ni un programme à appliquer : c’est dans son mouvement de destruction qu’il engendre de nouveaux rapports. » (p. 40) ;
« Le but de la révolution communiste n’est pas de fonder une structure sociale, un système d’autorité démocratique ou dictatorial, mais une activité différente. » (p. 41) ;
« La révolution communiste ne se fonde pas sur l’opposition gouvernés/gouvernants. Quand bien même les hommes s’autogouverneraient, le principe de séparation à la racine de l’État et de la politique subsisterait. Le communisme ne particularise pas ce principe, il le supprime. » (p. 41).
Mettons un terme à cette avalanche d’affirmations péremptoires en remarquant comment les idéologues, emportés par la logique de leur spécialisation intellectuelle de producteurs de principes, et aussi matérialistes puissent-ils se prétendre, doivent voir un principe « à la racine de l’État », et dans le communisme la suppression de ce principe.
Mais nous aurions tort de disputer mesquinement un tel détail, qui relève plutôt du malheureux lapsus, alors que vient de nous être si généreusement révélée la définition du communisme : il n’est ni l’égalité des hommes et des femmes, ni le résultat d’un conflit, ni le prolongement du capitalisme, ni un programme à appliquer, ni une structure sociale, ni un système d’autorité démocratique ou dictatorial, ni le dépassement de l’opposition entre gouvernants et gouvernés. Le communisme n’est rien de tout cela, et il est bien d’autres choses encore qu’il n’est pas. Bref, Il est Celui qui n’est pas, et ce qui est n’est pas Lui. Alléluia !
Le lecteur anxieux de penser par lui-même la réalité appréciera les immenses avantages d’une méthode qui lui permet d’emblée la définition de ce qui existe par ce qui n’existe pas, et vice versa. Ainsi, dès qu’il aura appris à manier en virtuose cette « opposition capitalisme/communisme » qui contient absolument tout ce qui est et tout ce qui n’est pas, il pourra passer à la classification historique de tout événement passé ou présent dans la catégorie qui lui convient. Il ne risquera pas de ressembler à ces « chercheurs modernes » qui « abordent la question sociale avec plus de sophistication : il leur faut toujours tout compliquer pour justifier la poursuite de leurs travaux », et qu’ont justement dénoncés des chercheurs aussi honorablement vieillots que Jean Barrot et Denis Authier (la Gauche communiste en Allemagne). En effet il s’apercevra bien vite que tous les événements historiques étant définis par le fait d’avoir existé, ils sont également tous entachés de cette souillure ineffaçable de l’existant qui interdit au penseur rigoureux de les ranger ailleurs que dans la catégorie du capitalisme. En posant ainsi, en opposition à toute théorie ou pratique distincte et accomplie, ou cherchant son accomplissement, son savoir unique que dans l’absolu du communisme tout est différent, il parviendra à l’extrémisme absolu dans la nuit duquel toutes les révolutions sont grises, non-communistes, capitalistes en un mot.
Qu’il voie déjà, pour exciter son zèle, comment « Karamazov » démontre la supériorité de son communisme sur ceux qui « voient la révolution en marche lorsque le prolétariat ne manœuvre que sous la contrainte des lois du capital » (La Guerre sociale n° 2, p. 55). En effet, en se révoltant contre « la contrainte des lois du capital », le prolétariat est encore déterminé par ce qu’il nie. C’est cette contrainte qui le fait agir, ce n’est pas en lui-même qu’il a trouvé une « aspiration communiste » qui, convenablement aiguisée par la théorie révolutionnaire, l’aurait transporté instantanément et sans intermédiaire au-delà des lois du capital et de leur contrainte. Cette misérable sujétion indigne le penseur du communisme absolu : comment, le prolétariat n’est-il pas mû par un pur enthousiasme pour le communisme ? Il a là quelque intérêt matériel et non théorique ? Alors il est perdu pour la révolution, en vérité, « Karamazov » vous le dit :
« Cette vague de contrôle et de gestion ouvriers qui déferle sous des formes multiples, sauvagement ou avec le soutien des bureaucrates, n’est pas révolutionnaire. II s’agit de défendre des emplois menacés, de se battre pour la production. Que font les ouvriers qui y participent, sinon s’accrocher au salariat ? […] Plus que d’une lutte offensive d’appropriation, il s’agit, soit, sous l’égide des bureaucrates, de pallier aux carences du capital, soit de défendre l’emploi sauvagement. La hausse importante et généralisée des salaires mettait brutalement en question la rentabilité de nombre d’entreprises » (p. 58).
Ainsi ces inoffensifs travailleurs ne font que « pallier aux carences du capital », parce que le capital a cette « carence » de mal supporter « la hausse importante et généralisée des salaires ». Il est vrai que la « carence » fondamentale du capital, qui explique toutes les autres, c’est d’être un rapport social contradictoire dont le prolétariat est le pôle négatif, le « mauvais côté » dont la lutte met « brutalement en question la rentabilité de nombre d’entreprises ». Finalement la « carence » du capital, c’est de contenir le prolétariat, et le « palliatif » à cette « carence », c’est encore le prolétariat, la contradiction devenue consciente. Quand le prolétariat « pallie » cette « carence », c’est donc, en même temps qu’il lutte pour l’existence, à ses propres conditions d’existence qu’il s’en prend. Le prolétariat exécute la sentence que le capital prononce contre lui-même en engendrant le prolétariat.
Ne serait-ce que pour faire braire ces ânes dogmatiques, citons le rusé léniniste Brecht, meilleur dialecticien en quelques lignes sans « théorie » qu’ils ne le seront jamais avec tout leur pédantisme :
« Sur le cours des choses : To-Tsi observait avant le grand bouleversement que les maîtres de forges furent perdus quand ils ne purent plus continuer d’exploiter les forgerons. Les forgerons, qui, pour obtenir par la force de meilleurs salaires, avaient souvent refusé de travailler, faisaient pression – maintenant que les ateliers étaient arrêtés faute de fer et parce que les maîtres de forges craignaient de ne plus recevoir d’argent du gouvernement pour les véhicules de guerre – pour que l’exploitation continuât. Vivre, pour eux, c’était être exploité ; ils craignaient maintenant pour leur vie. Ils se soulevèrent contre les maîtres de forges et les chassèrent en quelque sorte parce que ceux ci se refusaient à continuer de les exploiter. » (« Me-Ti, livre des retournements »)
Tout cela ne fait guère l’affaire de nos idéologues extrémistes, car leur affaire c’est la « théorie révolutionnaire », et ce genre de réalités s’en passe fort bien. Pour assurer le salut de leur « théorie révolutionnaire », il leur faut un capital débarrassé de toute « carence », un capital aussi absolument capitaliste que leur extrémisme est communiste. Alors seulement, par le miracle « dialectique » d’un renversement total, le prolétariat sera-t-il purifié de toute souillure matérielle d’intérêts partiels, lavé de toute relation équivoque avec le capital, et, transporté au-delà de réalités contradictoires relatives, nimbé de gloire, pourra-t-il enfin fonder la Jérusalem terrestre du communisme vrai. En somme ils demandent seulement au « mouvement communiste » de reproduire dans la réalité pratique la pauvreté et le schématisme de leur propre opération intellectuelle, dernière version, desséchée et mécaniste, de l’Esprit du Monde. On retrouve là la prothèse idéologique de tous les handicapés sous-marxistes qui, dans le calme contemplatif, veulent attendre d’une « aggravation des contradictions » par laquelle la réalité rejoindrait la simplicité immobile du concept, que se vérifie absolument la critique révolutionnaire, sans qu’il soit trop besoin de s’occuper à la faire vaincre relativement, c’est-à-dire dans l’histoire réelle. Avec tout leur marxisme racorni, ils sont plus idéalistes que Hegel, qui avait du moins l’honnêteté de reconnaître que le passage du concret au concept est toujours une chute. Pour eux, c’est le concret qui démérite quand il ne se conforme pas à leurs catégories figées.
Avant de reprendre le fil de l’exégèse karamazovienne, il faut relever une autre ineptie qui traîne partout dans le révolutionnarisme contemporain : l’emploi, par des gens manifestement incapables de lire la théorie dialectique de Clausewitz, mais qui veulent tout de même poser aux experts militaires, de la notion d’offensive comme catégorie fétichisée. Valoriser ainsi l’offensive en dehors de sa relation au développement du conflit et à l’évolution dans le temps du rapport des forces, qui seule détermine sa valeur tactique et stratégique, c’est échafauder un principe abstrait au nom duquel on reprochera sentencieusement aux travailleurs leur timidité. Le burlesque de ces stratèges de Café du Communisme, empêtrés dans les notions hypostasiées au moyen desquelles ils croient se montrer théoriciens de la guerre sociale, apparaît pleinement quand ils affirment que les travailleurs ne font que « défendre des emplois menacés » lorsqu’ils organisent leur contrôle sur les entreprises dont la rentabilité est compromise par une « hausse importante et généralisée des salaires » ; car qui a imposé cette hausse des salaires insupportable pour l’économie, sinon ces mêmes travailleurs ? Les enfants de troupe de La Guerre sociale écrivent ailleurs :
« Il y a eu des occupations de logements et des suspensions de paiement, des arrêts de péage (entre autres au “Pont Puig Antich”) et des grèves avec remise en marche gratuite des transports. Mais ces mesures antipropriétaires ne sont pas le début d’une instauration, même timide, du communisme. Ce ne sont pas des innovations portugaises. Elles sont des réponses aux besoins et aux pressions des masses et des militants, liées à des iniquités flagrantes, à des urgences pressantes, et surtout à des facilités immédiates quand la répression étatique s’affaiblit » (p. 54).
Ainsi ces lamentables « facilités » auxquelles se sont paresseusement laissés aller les travailleurs portugais étaient « surtout » le résultat de l’affaiblissement de l’État . Mais pourquoi s’affaiblissait-il donc ? On pourrait aussi bien dire qu’en juillet 1936 les travailleurs espagnols furent si timorés qu’ils ne s’emparèrent des usines qu’après le départ des patrons. Mais pourquoi les patrons s’enfuirent-ils donc ? (En vérité il est presque impossible d’imaginer une sottise que ces gens n’aient effectivement proférée avec assurance :
« Les collectivisations ? Elles ont géré, non sans un certain enthousiasme révolutionnaire, ce qui n’en restait pas moins du capitalisme. Les travailleurs ont pris tant bien que mal la place des patrons : leurs tendances communistes sont restées surtout velléitaires. » (p. 41)
Et ils sont plus péremptoires encore lorsqu’ils traduisent, pour l’édification des indigènes ibériques, des textes de paléo-bordiguistes belges selon lesquels, comme le résume froidement le frère jumeau de « Karamazov » qui les préface, « il n’y a pas eu de révolution en Espagne en 1936-1939 ». Enseignement plein de sens pour ceux qui se préparent sans doute déjà à prouver l’inexistence de la prochaine révolution espagnole.)
En fait, dans toute crise révolutionnaire, et quel qu’en soit le rythme, l’initiale offensive spontanée des masses se heurte toujours, au bout d’un temps plus ou moins long selon la désagrégation de l’ennemi et le nombre de tentatives de résistance qu’il lui faut pour se reprendre, à une contre-offensive qui transforme le nouveau rapport de forces de potentiel en effectif. A ce moment c’est dans l’organisation de sa défense que ce qui s’est constitué comme camp de la révolution peut puiser la conscience de ses possibilités et les moyens de les réaliser, pour passer de nouveau à l’offensive. Jamais ne cesse l’action que les deux camps exercent l’un sur l’autre, et tout au long de ce processus les valeurs respectives de l’offensive et de la défensive doivent nécessairement varier à chaque moment et pour chaque camp.
Ainsi lorsque le 25 novembre 1975 est finalement venue la contre-offensive qu’aucune des variantes successives du burlesque pouvoir portugais n’avait réussi à mettre sur pied depuis un an et demi, les travailleurs révolutionnaires ont surtout été vaincus par ceux qui ont su les empêcher de prendre eux-mêmes en main leur défense. Staliniens et militaires de gauche ne pouvaient plus faire simplement échouer le coup comme le putsch de Kapp, et ils ne voulaient surtout pas le faire échouer comme le soulèvement de Komilov. Par la diversion, le brouillage et la confusion, ils sont parvenus à désorienter les travailleurs, et les commandos de Neves, lorsqu’ils sont passés à l’action, n’ont fait qu’encaisser ce que d’autres avaient fait payer au prolétariat.
Prétendre découvrir la méthode de guerre spécifique du prolétariat dans l’offensive, c’est soit extrapoler une banalité de base sans emploi ici (les travailleurs ne peuvent rien posséder qui soit vraiment à eux avant d’avoir tout pris), soit échafauder un méthodisme particulièrement dérisoire, parce que portant sur ce qui n’est pas du ressort de la méthode : la passion unie à la capacité, c’est-à-dire le génie. Ce que fait le génie des masses en révolution, voilà la plus belle de toutes les règles, et ce que la théorie peut faire de mieux, c’est de montrer pourquoi il en est ainsi, et comment. C’est pourquoi des gens qui refusent de voir ce qui a été la grandeur de la révolution portugaise, et donc déjà sa victoire, s’interdisent par là même de comprendre ce que fut sa défaite. Il n’y a pas de grandeur historique pour les valets de plume qui doivent tout rapetisser aux dimensions de leur « théorie ».
On voit donc que nos penseurs de la guerre sociale ne sont si prompts à affirmer qu’il ne s’agit pas d’une « guerre classique » que pour s’épargner d’avoir à penser en quoi il s’agit aussi d’une lutte armée soumise aux nécessités de toute lutte armée, et pouvoir ainsi sauter directement dans l’éther de leur « mouvement communiste », où tous les vulgaires problèmes militaires sont abolis avant même que l’on ait eu le déplaisir de les considérer.
« L’affaire portugaise est d’importance, puisque cette deuxième offensive révolutionnaire moderne, la première étant mai 68, “ridiculise […] toutes les illusions sur la révolution”. Et l’auteur semble effectivement n’avoir qu’un but : non pas comprendre ce qui se passe, mais tout rejeter dans le ridicule et tenter, lui et son prolétariat mythique, de se tenir au-dessus. »
Après m’avoir généreusement crédité de l’opposition entre la classe prolétarienne et sa représentation, produit de mon seul délire visionnaire, « Karamazov » me prête donc le but non moins irresponsable selon lui de tout rejeter dans le ridicule. Encore une fois le respect de la vérité m’oblige à refuser de m’attribuer toute la gloire d’une entreprise dont la réussite n’a que bien peu dépendu de moi. Cela aussi, c’est la révolution portugaise qui l’a accompli, et non mon talent personnel : c’est elle qui a successivement rejeté toutes les combinaisons politiques de ses ennemis dans un ridicule dont, à l’heure actuelle, ils ne se sont pas encore vraiment relevés. Là où « Karamazov » veut voir une espèce d’entreprise esthétique de dérision littéraire, il y a le caractère objectivement comique d’une situation où tous les dirigeants ont dù faire autre chose que ce qu’ils voulaient. La cruelle ironie de l’histoire, qui rejette toute l’organisation dominante de la vie dans le ridicule dès que les prolétaires commencent à prendre leurs affaires en main, on la voit encore aujourd’hui en Iran ; et partout ailleurs, dans les nombreuses occasions où les classes dirigeantes se ridiculisent très bien toutes seules, sans même que la révolution s’en mêle. Ce ne sont pas les mauvaises intentions satiriques, aussi talentueuses soient-elles, qui ridiculisent le plus efficacement le vieux monde, mais la réalité. Et cela est si vrai que pour ne pas se sentir lui-même trop ridicule, « Karamazov » doit nier farouchement cette réalité, sans pourtant jamais parvenir à se rassurer complètement.
« Au Portugal émerge l’autonomie prolétarienne. Les chatoiements stylistiques, les paradoxes multipliés, les détournements répétés ne font que reprendre et mettre en scène cette façon unique et fausse de considérer les événements. Mettre en scène, car il s’agit bien d’une reconstitution théâtrale. Ce ne sont pas des forces sociales et politiques qui sont en jeu, mais des personnages qui se bousculent et surtout se trompent les uns les autres : Spinola, le MFA, le PCP, le prolétariat. »
Pour que rien ne vienne gâcher le bonheur théoricien de « Karamazov », il faut donc que le « prolétariat mythique » dont il m’a somptueusement accordé plus haut la propriété ne soit avec son autonomie que le résultat de mon ingénieuse mise en scène : non seulement j’ai des visions, mais j’excelle à utiliser tous les poisons du style pour les faire partager à d’autres. « Karamazov », quant à lui, pense que l’on ne se prémunira jamais assez contre les séductions délétères d’une expression cohérente et d’un langage maîtrisé. L’austérité de ses mœurs stylistiques nous est déjà connue (« Le Portugal est un pays petit et pauvre ») mais il a encore à cœur de nous convaincre que son interprétation ne saurait sans une grande mauvaise foi être confondue avec une mise en scène trompeuse, une reconstitution théâtrale de la réalité, car il s’attache lui-même soigneusement, par des contradictions grossières et calculées, à lui ôter toute apparence de plausibilité. Ainsi « cette façon unique et fausse de considérer les événements », constater l’émergence de l’autonomie prolétarienne, était précisément la sienne quelques pages auparavant :
« Au Portugal, une fraction assez large du prolétariat des grandes entreprises et du secteur moderne (postes, chantiers navals, compagnie aérienne, presse) s’est trouvée en opposition, non seulement au patronat, mais aussi à la bureaucratie ouvrière (P.C., Intersyndicale). Ces travailleurs ont tenté et plus ou moins réussi, notamment à travers le comité interentreprises et ses manifestations, à s’organiser de façon autonome » (p. 54-55).
Mais on ne peut cependant le confondre avec un vulgaire partisan de l’autonomie ouvrière, car lui savait bien, de toute éternité anti-conseilliste, que cela ne donnerait rien de bon, puisque le Portugal, « ce petit pays, peut-être fier mais sûrement pauvre, ne pouvait devenir un phare ou un modèle pour le reste du monde » (p. 54) ; pourtant, par ailleurs : « On ne peut régler la question au nom de l’arriération du Portugal. Le capital est une réalité mondiale et ses effets sont planétaires » (p. 2) ; et il est vrai que « l’autogestion portugaise était une version modernisée des ateliers nationaux de 1848 » (p. 59). Ces chatoiements stylistiques, dont les soudaines fulgurances s’anéantissent réciproquement dans un vacarme d’opéra-comique, sont à mon talent de démiurge, pour ce qui est de la mise en scène, ce que les œuvres complètes de Bordiga sont à la pizza napolitaine, pour ce qui est du caractère digeste. Auprès d’un tel bredouillis ergoteur, tout doit sembler théâtral, car rien ne saurait faire moins de concessions à la simple cohérence formelle de l’exposé.
Toute analyse historique comporte nécessairement une part de relation des faits, et toute relation sélectionne, privilégie certains faits plutôt que d’autres. Ce qui peut seul en manifester la vérité, c’est le devenir historique qui démontre que les faits choisis étaient bien les plus importants, que la tendance dominante était bien celle qui avait été discernée. On peut sélectionner les faits du point de vue du valet de chambre, en les regardant par le trou de serrure du dogmatisme anti-conseilliste, ou à partir de n’importe quel choix politique. (A partir de cette réalité du choix, les mêmes ordures qui affirment que « le langage est fasciste » peuvent soutenir que toute relation historique est une fiction, pour noyer leurs petites falsifications particulières dans l’impossibilité absolue de restituer la vérité.) La cohérence interne de l’analyse reste cependant, bien évidemment, la condition nécessaire à ce que cette analyse soit elle-même cohérente avec la réalité. Il est à noter qu’avec la décomposition de la cohérence séparée des idéologies, les idéologues se montrent de moins en moins capables de satisfaire même cette première condition insuffisante. « Karamazov », quant à lui, dédaigne absolument, en véritable extrémiste qu’il est, de la remplir : il doit souffler alternativement le froid et le chaud, car il lui faut à la fois déprécier la révolution portugaise pour montrer l’exigence de son sérieux théorique, et la faire valoir pour ranimer quelque peu le prétexte à cette démonstration. L’unique tâche d’un partisan de la vérité consistait, face à un tel mouvement, non à jouer au maître d’école mais plutôt à étudier le caractère qui lui est propre. Pour cela il faut avant tout une certaine perspicacité et une certaine passion révolutionnaire, tandis que pour l’autre opération une phraséologie toute prête, immergée dans une creuse prétention, suffit amplement. Si même on parvenait à démêler et à mettre de côté tout ce qui chez « Karamazov » procède simplement de la rancœur et de la mauvaise foi, il resterait son incapacité à penser dialectiquement : quand il réussit à voir la différence, il ne voit pas l’unité, et quand il réussit à voir l’unité, il ne voit pas la différence. Quand il établit des caractères distinctifs, ils se pétrifient immédiatement entre ses mains ; et il considère comme la mise en scène la plus condamnable de faire prendre feu à ces concepts secs comme du bois en les choquant les uns contre les autres.
Mais la pensée de « Karamazov » est si riche de mesquineries véritablement modernes qu’à la suivre on se laisserait aisément emporter loin de la désuète révolution portugaise et de son autogestion façon 1848. Poursuivons, rattrapons et finissons-en.
« Dans cette bouffonnerie, le prolétariat autonome est évidemment le favori. Plus rusé que tous les autres, il ruse au point de dissimuler son autonomie même. “Au mépris outrecuidant des bureaucrates répondit cette ruse du prolétariat de s’avancer masqué, derrière les mots d’ordre mêmes de l’État et des partis.” Ce faisant, les ouvriers ne perdent pas leur temps, puisque “… livrant le combat sur le terrain de la production et de la vente des marchandises, ils commençaient à toucher à leur racine pratique les mystères de l’économie politique”. A force de ruser lui-même avec les illusions du prolétariat, il en devient presque électoraliste : “Aujourd’hui, le résultat des élections montre que si le pouvoir croyait ainsi gagner du temps, c’est en fait la classe ouvrière qui a su les utiliser au mieux pour se donner le temps de gagner… En votant pour les socialistes, les travailleurs ont d’abord voté contre les staliniens. Mais la ruse de leur raison a été d’imposer en même temps le résultat qui compliquait le plus la tâche de l’État , et qui, portant à leur comble ses contradictions et ouvrant une nouvelle phase de luttes et de tractations politiques, leur donne ainsi de nouveaux délais pour poursuivre leur organisation autonome sur le terrain social.” »
Avec une lourde ironie, « Karamazov » affecte de croire que je prête au prolétariat la conscience subjective de choisir machiavéliquement les prétextes particuliers qui lui permettront de réaliser son but total. J’ai plutôt montré, dans ce cas précis, comment le « prétexte » fourni par les bureaucrates, le mot d’ordre d’épuration des fascistes, avait été l’occasion pour les travailleurs de prendre conscience de leur but total ; les travailleurs de la Lisnave, qui ne « font » pourtant pas dans le talent comme « Karamazov » « fait » dans la théorie, n’avaient d’ailleurs rien dit d’autre en septembre 1974 :
« En menant cette lutte politique, l’épuration, elle – la classe ouvrière – prend conscience de lutter non seulement pour la chute des structures fascistes dans la Lisnave mais aussi contre toute la bourgeoisie exploiteuse. » (Premier communiqué à la population)
Mais peut-être ces travailleurs, à force d’escamoter la difficulté de leur révolution par la pratique d’assemblées révolutionnaires, s’étaient-ils laissé contaminer par le sybaritisme conseilliste. Pourtant « Karamazov » lui-même reconnaît ailleurs que « c’est une règle courante et non une exception portugaise qu’il – le prolétariat – ne déclenche pas les mouvements, mais profite de troubles provoqués par d’autres » (p. 57). « Karamazov » ne veut cependant pas du tout qu’il y j ait là, dans cette manière de profiter « de troubles provoqués par d’autres », une quelconque ruse de la raison, car il lui faudrait alors reconnaître dans le prolétariat la classe de la conscience qui peut réaliser la raison historique, l’unité du particulier et de l’universel. On comprend bien qu’il ne veuille pas entendre parler de « conscience prolétarienne », fâcheux « intermédiaire » entre ce particulier et cet universel : il doit en effet maintenir fermement séparés et sans relations équivoques les intérêts particuliers qui sont ceux de prolétaires bornés et inconscients, et les intérêts universels, qui sont l’affaire des seuls » théoriciens ». Lesquels propriétaires de l’universalité peuvent ainsi se permettre, en décernant leur satisfecit idéologique aux pillards de juillet 1977 à New York, de faire néanmoins la fine bouche : « Les limites du mouvement sont liées aux causes mêmes de son apparition : c’était plus une bonne occasion, dont il fallait profiter, qu’une insurrection » (p. 71). On n’a jamais vu, « Karamazov » lui-même vous le dira, d’insurrection qui n’ait « profité » d’une « bonne occasion ». C’était là sans doute son péché originel, sa limitation définitive : aurait-elle existé sans aucune sorte d’occasion, elle aurait peut-être su attendrir les inflexibles théoriciens de La Guerre sociale. Las ! c’est bien le monde existant qui fournit au prolétariat des occasions de se soulever, et à vrai dire on ne voit pas très bien qui d’autre pourrait lui en fournir. Le monde existant est l’occasion de se révolter contre lui : il tend ainsi aux prolétaires un piège grossier, ce sont les meilleurs, car sinon ceux-ci se révolteraient pour de tout autres motifs, comme de donner raison à La Guerre sociale.
Sur un tout autre plan, il faut relever que cette inénarrable Guerre joviale est bien injuste avec l’utilisation des prétextes, alors qu’elle sait elle-même si bien profiter d’occasions aussi dérisoires que la révolution portugaise pour faire une démonstration grandiose de ses capacités théoriques. Moi-même, qui parviens ici à dire tant de choses réjouissantes à partir d’un tel prétexte, je crois démontrer excellemment que les limitations les plus sordides ne sauraient lier irrémédiablement la réflexion dont elles sont l’objet.
Ce roublard de « Karamazov », dans sa croisade contre la ruse de la raison prolétarienne, s’enhardit finalement jusqu’à me taxer d’électoralisme, ou presque. A qui fera-t-il croire que le simple fait d’apprécier le résultat d’élections – et précisément en l’occurrence « le cuisant échec des staliniens » – revient à se montrer électoraliste, et peut être même partisan du vote pour le parti socialiste ? On pourrait tout aussi candidement assimiler à un défenseur des syndicats quiconque prétend évaluer l’ampleur d’une grève syndicale, et en tirer quelques enseignements. Mais la candeur de « Karamazov » est feinte, et il sait très bien de quoi je parle : il ne se voit pas vraiment en train de ressusciter la lutte anti-électoraliste de Bordiga dans le Comintern. Que les élections d’avril 1975, qui de toute manière ne pouvaient sauver à elles seules la contre-révolution quand c’étaient toutes les conditions de la démocratie représentative qui manquaient, lui aient de plus compliqué la tâche en approfondissant son incohérence et en précipitant la déroute des staliniens, voilà qui a été suffisamment prouvé par l’été qui a suivi pour qu’il soit tout à fait inutile de le démontrer à qui ne veut pas le voir. Et que le temps qu’ils avaient ainsi gagné n’ait pas permis aux travailleurs de développer leur organisation autonome au point de la mettre en mesure de vaincre, voilà qui de toutes les façons ne constitue pas un sujet de réflexion pour « Karamazov », puisqu’il possédait par avance toutes les garanties scientifiques de cette incapacité.
« Les ruses ont cependant leurs limites et le prolétariat des difficultés d’expression : “Au cours de cette phase de clarification rapide se fait cruellement sentir l’absence d’un courant radical organisé qui sache, à chaque moment décisif du processus, concentrer en quelques hypothèses et en quelques objectifs pratiques ce qui est dans toutes les têtes et déjà sur toutes les lèvres. ” Pourquoi ce qui est sur les lèvres ne jaillit pas, et pourquoi un tel courant ne surgit pas de l’étude pratique de l’économie politique et de la découverte de son “irrationalité fondamentale” ? Mystère. Et, de toute façon, que proposerait ce courant ? Le livre de Semprun “qui pour être rapide n’en est pas pour autant hâtif” ne lui ferait certainement pas gagner beaucoup de temps dans la découverte d’objectifs pratiques et révolutionnaires. »
« Karamazov » fait mine maintenant de s’étonner d’un défaut de mon abusive « mise en scène » lorsque je n’explique pas l’absence d’un courant radical organisé. Il y a pourtant un bien simple motif à cette absence d’explication : c’est que ce genre de « hasard » n’appelle aucune sorte d’explication. L’histoire serait de nature fort mystique, et même « Karamazov » comprendrait sans ruse aucune la raison qui y est à l’œuvre, si les « hasards » n’y jouaient aucun rôle. L’accélération ou le ralentissement d’un mouvement révolutionnaire dépendent beaucoup de « hasards » comme le caractère des individus qui y défendent les positions les plus radicales. Et ainsi au Portugal, un malheureux « hasard » a fait que ceux qui s’étaient regroupés dans le Conseil pour le développement de la révolution sociale, et avaient su au cours des premières semaines exprimer toutes les possibilités du moment, n’ont pas été capables par la suite d’influer sur le cours des événements. L’auraient-ils fait que cela n’aurait sans doute pas rencontré l’agrément de « Karamazov », puisque ce n’aurait pu être que pour aider à formuler le programme du mouvement des assemblées révolutionnaires de travailleurs, dans lesquelles « Karamazov » refuse absolument de reconnaître la forme des Conseils modernes :
« La lutte de classes au Portugal a fait surgir une multitude d’organisations et de comités unitaires de base, généraliser la pratique de l’assemblée générale. Pourquoi des soviets ne se sont-ils pas constitués à partir des multiples commissions de travailleurs d’entreprises ? Pourquoi les conseils ouvriers de Lisbonne et de Porto n’ont-ils pas pris la suite de ceux de Pétrograd et de Budapest ? » (p. 62)
D’ailleurs, quoique sa « théorie » ne laisse jamais rien sans explication, et explique même tout par avance, le fait de laisser inexpliqué un « mystère » comme l’absence d’un courant radical organisé ne semble pas trop troubler le sommeil néo-bordiguiste de « Karamazov » :
« Constatons que l’intensité de l’agitation n’a pas suffi à faire apparaître une fraction communiste et lui a donc encore moins permis de jouer un rôle important. » (p. 54)
Cette fraction communiste, si elle était apparue, n’aurait pourtant pas manqué de « fixer les objectifs qui auraient assuré une transformation même partielle, même provisoire, de la société, et aurait fait franchir un saut qualitatif à la lutte » (ibid.). Ce « saut qualitatif» aurait même probablement été le salto mortale du bordiguisme absolu, avec le tremplin théorique d’objectifs de ce genre :
« Le bouleversement de la société ne sera possible que si le prolétariat met en œuvre sa fonction sociale contre le capital, utilisant sa fonction dans l’économie comme arme dissolvant les rapports économiques. » (p. 40)
« Aujourd’hui plus qu’hier, de toute manière, le prolétariat ne peut réellement s’autonomiser par rapport aux bureaucraties qu’en s’autonomisant par rapport au capital lui-même. Il ne s’autonomise qu’en détruisant sa condition, en se dissolvant. » (p. 61)
Ces dissolutions qui s’entredissolvent sont les plus concrets des objectifs que puissent formuler les théoriciens du communisme instantané (au sens du nescafé).
Il faut enfin préciser que le propos essentiel de La Guerre sociale au Portugal n’était évidemment pas, comme tout lecteur de bonne foi l’aura compris, de formuler de Paris des objectifs pour un courant radical au Portugal, mais de prendre internationalement la défense de la révolution portugaise, au moment où il pouvait être décisif qu’elle trouve des alliés, et avant tout en Espagne. (Une traduction espagnole, médiocre mais sans falsifications, est parue peu de temps après ; mais pas encore assez vite, puisque seulement en décembre 1975.) Il n’en reste pas moins que ce n’était pas faire obstacle à l’organisation d’un courant radical, où qu’il doive agir, que de présenter une explication cohérente du processus qui avait mené la révolution portugaise au point de pouvoir faire sauter l’Europe de sa place. Cette compréhension, j’ai montré qu’il était possible de l’avoir sur le moment. Quant à La Guerre sociale, elle montre tout aussi irréfutablement qu’il est possible de ne pas l’avoir trois ans après.
« Tout l’art de Semprun consiste à voir la chose dans son contraire et à sauter par-dessus les problèmes, plutôt que de tenter de les éclairer. Dialectoque et pub-théorie. L’assurance du ton ne garantit pas la sûreté de la prévision : “Si ce qui se passe aujourd’hui au Portugal, et la façon dont cela se passe, peut influer lourdement sur l’avenir de la révolution sociale en Europe et dans le monde, c’est que pour la première fois dans un pays non bureaucratique, les staliniens n’ont pas pour rôle d’organiser la défaite du prolétariat et d’être vaincus avec lui (militairement comme en Espagne en 1936, ou politiquement comme en France en 1968), mais d’être eux-mêmes directement victorieux du prolétariat.” »
Le lecteur aura sans doute remarqué ce spirituel néologisme de « dialectoque » que « Karamazov » a forgé loin de toute influence moderne, et dont la paternité saurait d’autant moins lui être contestée qu’il a tenu, de crainte de n’être pas compris, à fournir des exemples en explicitant au mieux le sens :
« L’anticapitalisme généralisé consistait là encore à éviter que soit posée la question de la nature et de la destruction du capitalisme. » (p. 54)
« Le nouvel État se trouvait face a sa faiblesse administrative. Mais il conservait aussi la force de son prestige. Sa faiblesse même lui devenait une sorte de force empêchant que soit posé le problème de sa destruction. » (p. 63)
Confiant en son imparable dialectoque, « Karamazov » pensait peut-être de même que sa faiblesse empêcherait que se pose la question de le combattre. Eh bien il s’est trompé, là comme ailleurs.
On voit aussi que « Karamazov » use avec une insigne modestie du léger avantage que lui donne sur moi le fait de se mettre à penser trois ans après la bataille, tout en s’accordant encore avec libéralité le droit à l’erreur :
« Rien ne nous garantit l’infaillibilité, et nous sommes sujet à erreurs et à inattentions. » (p. 72)
La majesté de ce pluriel n’étant sujet qu’au singulier, nous en sommes amenés à croire que la trinité « Joseph Boër, Jack Cade, Dominique Karamazov », officiellement responsable de cette publication, fonctionne comme un Dieu unique en trois personnes, et à attendre d’un prochain concile les éclaircissements qui s’imposent sur quelques points de doctrine comme l’incarnation en Barrot du Saint-Esprit de Bordiga, ou la transsubstantiation des espèces. Mais bien qu’ayant renoncé pour son propre compte au dogme de l’infaillibilité théorique, le bordiguiste-révisionniste s’en prend à ce qu’il présente comme un manque de « sûreté de la prévision ». Personne ne peut sérieusement exiger d’une prévision qu’elle indique non seulement les tendances essentielles d’un développement, mais aussi leurs combinaisons épi- sodiques. Pour ce qui est des tendances essentielles, « Karamazov » sait très bien que j’avais précisé par ailleurs, au sujet des divers protagonistes possibles de la contre-révolution :
« Tous doivent bien accepter comme seule solution l’organisation rapide d’un capitalisme d’État, et ils ne se disputent que sur les modalités juridico-idéologiques de sa propriété, qui peuvent aller du monopole bureaucratique à une version mitigée de type Scandinave, en passant par l’autogestion à la yougoslave. » (La Guerre sociale au Portugal, p. 88).
Il était clair, et je l’ai dit, que ce taux de bureaucratisation du nouveau pouvoir serait déterminé avant tout par la lutte elle-même, par les forces qu’il y emploierait : les staliniens avaient bien pour rôle d’être directement victorieux du prolétariat, et s’ils n’ont pas réussi à l’assurer, ce n’est pas pour avoir manqué d’essayer. L’hypothèse de leur réussite devait être maintenue, à ce moment, comme je l’ai fait, parmi d’autres et en la nuançant par l’analyse du résultat des élections où « Karamazov » a voulu voir un ralliement à l’électoralisme :
« Mais sur ces détails, comme sur l’essentiel, rien n’est encore joué, car ce sont les armes qu’il devra employer contre le prolétariat qui modèleront le nouveau pouvoir, comme ce sont les armes qu’il a dû employer jusqu’ici qui l’ont modelé et l’ont fait ce qu’il est. » (« La Guerre sociale au Portugal », p. 89)
Me serais-je trompé dans la prévision des combinaisons épisodiques du développement de la contre-révolution beaucoup plus lourdement que je ne l’ai fait en surestimant la puissance de la « contre-révolution stalino militaire », que « Karamazov » n’aurait toujours pas lieu d’exulter devant ce pronostic erroné, lui qui non seulement ne s’est pas mis en position d’avoir à risquer la moindre prévision, mais qui alors même qu’il écrit longtemps après l’été 1975, ne se risque pas à la moindre explication, ni de l’échec de cette variante stalino-militaire de la contre-révolution ni de quoi que ce soit d’autre. « C’est dans la situation géographique et surtout économique du Portugal qu’il faut chercher les causes de la limite du processus social » (p. 55), et ces recherches économiques, géographiques, et peut-être même géologiques « sur un terrain social aride et rocailleux » permettent d’aboutir à la grandiose conclusion qu’en définitive :
« Le problème de fond, c’est que l’absence de révolution prolétarienne n’est pas le fait d’une répression militaire, mais celui des carences propres du prolétariat. Si le prolétariat était devenu révolutionnaire, alors il se serait trouvé dans une situation excellente pour débaucher et rallier à ses objectifs bon nombre d’officiers et de soldats. » (p. 66)
S’il n’y a pas eu de révolution prolétarienne, c’est que le prolétariat n’est pas devenu révolutionnaire. Nous tenons là le fin mot de la science karamazovienne. Mais le caractère sublime de la tautologie ne garantit même pas la sûreté de la constatation : car il y a bien eu une révolution prolétarienne au Portugal, comme n’importe qui peut s’en persuader aisément à peu près partout ailleurs que dans La Guerre sociale ; et même dans La Guerre sociale, s’il sait lire entre les lignes de son délire incohérent. Car finalement, la seule explication des furieuses dénégations de nos idéologues devant la présence de la révolution moderne au Portugal, c’est que cette révolution portugaise qui est partout, du Nicaragua à l’Iran, en même temps qu’elle met fin à tous les sous-développements, dévalue d’un seul coup et sans appel les titres de propriété scientifiques sur l’intelligence historique qu’ils avaient studieusement accumulés ; et les met en faillite avec leur affaire de pallier les « carences propres du prolétariat » par leur « théorie », alors que le prolétariat entreprend de se délivrer de toutes ses « carences » sans intermédiaires. Bref, si la révolution portugaise existe, ils ne sont rien ; et comme on a vu qu’ils n’étaient rien, qu’un peu de misère défraîchie, c’est donc que la révolution portugaise existe. Voilà la conclusion à laquelle devait nécessairement arriver tout lecteur de cette revue n’ayant pas l’intelligence définitivement polluée par les sophismes modernes.
La Guerre sociale au Portugal suivie des Syllogismes démoralisateurs
Source : Jaime Semprun, « Les syllogismes démoralisateurs | «Les Amis de Bartleby

