Abat-faim
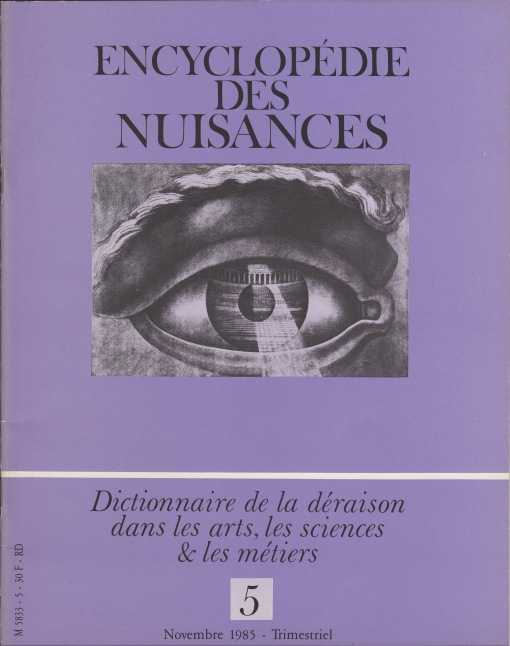
On sait que ce terme a désigné une « pièce de résistance qu’on sert d’abord pour apaiser, abattre la première faim des convives » (Larousse). Hatzfeld et Darmesteter, dans leur dictionnaire le qualifient de « vieilli ». Mais l’histoire est maîtresse infaillible des dictionnaires. Avec les récents progrès de la technique, la totalité de la nourriture que consomme la société moderne en est venue à être constituée uniquement d’abat-faim.
L’EXTRÊME DÉGRADATION de la nourriture est une évidence qui, à l’instar de quelques autres, est en général supportée avec résignation : comme une fatalité, rançon de ce progrès que l’on n’arrête pas, ainsi que le savent ceux qu’il écrase chaque jour. Tout le monde se tait là-dessus. En haut parce que l’on ne veut pas en parler, en bas parce que l’on ne peut pas. Dans l’immense majorité de la population, qui supporte cette dégradation, même si l’on a de forts soupçons, on ne peut voir en face une réalité si déplaisante. Il n’est en effet jamais agréable d’admettre que l’on s’est laissé berner, et ceux qui ont lâché le « bifteck » — et la revendication du « bifteck » — pour l’ombre « restructurée » de la chose sont aussi peu disposés à admettre ce qu’ils ont perdu au change que ceux qui ont cru accéder au confort en acceptant des ersatz semblables dans leur habitat. Ce sont habituellement les mêmes, qui ne peuvent rien refuser de peur de démentir tout ce qu’ils ont laissé faire de leur vie.
Cependant le phénomène, mondial, qui affecte d’abord tous les pays économiquement avancés et qui réagit aussitôt sur les pays soumis à l’arriération du même processus, peut facilement être daté avec précision. Quoiqu’il ait été annoncé par des modifications graduelles, le seuil franchi dans la perte de qualité se manifeste en deux ou trois années comme brusque renversement de toutes les « habitudes alimentaires » anciennes. Ce bond antiqualitatif s’est produit en France, par exemple, autour de 1970 ; et environ dix ans plus tôt dans l’Europe du Nord, dix ans plus tard dans l’Europe du Sud. Le critère qui permet d’évaluer très simplement l’état d’avancement du processus est bien sûr le goût : celui des aliments modernes est précisément élaboré par une industrie, dite ici « agro-alimentaire », dont il résume, en tant que résultat désastreux, tous les caractères, puisque l’apparence colorée n’y garantit pas la saveur, ni la fadeur l’innocuité. C’est tout d’abord la chimie qui s’est massivement imposée dans l’agriculture et l’élevage, afin d’augmenter le rendement au détriment de toute autre considération. Ensuite l’emploi de nouvelles techniques de conservation et de stockage. Et chaque « progrès » accompli, en renversant ce que les experts de l’abat-faim appellent nos « barrières mentales », c’est-à-dire l’expérience ancienne d’une qualité et d’un goût, permet d’avancer encore plus loin dans l’industrialisation. Ainsi la congélation, et le passage rapide à la décongélation, ont d’abord servi à commercialiser des « cuisses de volailles », par exemple, composées de matière broyée et reconstituées par « formage ». À ce stade, la matière en question a encore un rapport avec son nom, « volaille », qui n’est distendu que relativement à ce que pourrait être une volaille qui aurait échappé à l’élevage industriel. Mais une fois cette forme acceptée, le contenu peut d’autant plus aisément être altéré : l’exemple vient à nouveau du Japon — ex Oriente lux — où les « pattes de crabes » et « crevettes » sont en fait produites industriellement à partir de poissons à bas prix reconstitués sous cette apparence. Voilà de quoi rendre optimiste quelqu’un comme Jacques Gueguen, « chargé de recherches à la station I.N.R.A. de Nantes », où l’on étudie les moyens de nous faire avaler des steaks à base de « matières protéiques d’origine végétale ». Celles-ci ont certes encore quelques défauts, mais l’on y remédiera : « Pour la couleur, ce n’est pas tout à fait ça, reconnaît Jacques Gueguen : “les isolats de soja sont blanc crème, avec un arôme perceptible de chou. Pour le tournesol, cela donne des fibres grises. Quant à celles du colza, elles sont jaunes, toujours avec un arrière-goût de chou. De toute façon, affirme-t-il, ces fibres sont rebroyées, recolorées et aromatisées, et vous n’y verrez que du feu, une fois que vous les retrouverez sous forme de steak de bœuf, de veau, de porc ou de dinde”. Sceptique, vous vous dites que vous ne mangerez jamais de cette viande-là. Alors, jetez un coup d’œil un peu plus attentif sur la composition de vos raviolis préférés ou du hamburger que vous venez d’acheter au rayon surgelés : un paquet bien banal, avec la photo d’un steak grillé à point reposant sur son lit de salade. Du bœuf comme les autres ? Pas tout à fait, si vous lisez ce qui est écrit sur le carton : 69 % (parfois cela peut descendre jusqu’à 65 %) de viande de bœuf hachée, “assaisonnée” avec des protéines végétales. En fait ces 31 % de protéines végétales n’ont rien d’un assaisonnement mais constituent une sorte de rembourrage additionnel à la vraie viande. » (Cosmopolitan, juin 1985.)
Mais la logique qu’il y a à nous rappeler tout ce que nous avons déjà avalé n’a pas besoin d’être aussi franchement énoncée pour être contraignante : il suffit de nous faire oublier tout ce que nous ne pouvons plus goûter. Ainsi, après que l’on a rendu la bière infecte pour qu’elle soit stockable dans n’importe quelles conditions, n’aurons-nous plus grand-chose à regretter quand on l’adaptera encore mieux aux nécessités de sa circulation marchande : « La brasserie Adelshoffen à Schiltigheim dans la banlieue de Strasbourg lance actuellement de la bière concentrée. Un volume de bière pour cinq volumes d’eau gazeuse. Grâce aux techniques modernes d’ultrafiltration, la bière n’est plus qu’un mécano dont on peut séparer chaque élément : eau, alcool, principes aromatiques… Comme Coca-Cola, Adelshoffen rêve déjà d’expédier d’Alsace vers le monde entier du sirop reconstituable sur place par des embouteilleurs locaux. […] “Cela réduit les coûts de transport et d’emballage puisque les brasseurs sont de plus en plus des revendeurs d’emballages si l’on regarde la part du prix du liquide dans le coût du produit final” explique Michel Debuf. “Le concentré de bière est un projet faramineux aux débouchés planétaires”, s’enthousiasme-t-il. Désormais un simple embouteilleur local pourra casser les monopoles des brasseries. “Avec le concentré il suffit d’une chaîne d’embouteillage pour ajouter l’eau et le gaz carbonique. Tout embouteilleur de sodas, type Coca-Cola, peut le faire.” » (Libération, 29 juillet 1985.)
Cette poursuite insensée de toute économie de temps, et des frais dans la main-d’œuvre ou le matériau (lesquels facteurs diminuent d’autant le profit) tend à faire prévaloir dans toute sa pureté abstraite la logique de la marchandise, qui, avec le temps (par exemple le temps accumulé dans l’histoire humaine pour acquérir le savoir-faire nécessaire à la fabrication d’une bonne bière) prétend ignorer le qualitatif. Lequel ne manque pas de revenir négativement, comme maladie. On y substitue donc diverses réclames idéologiques, des lois étatiques imposées soi-disant au nom de l’hygiène, ou simplement de l’apparence garantie, pour favoriser évidemment la concentration de la production ; laquelle véhiculera au mieux le poids normatif du nouveau produit infect. À la fin du processus, le monopole sur le marché vise à ne laisser de choix qu’entre l’abat-faim et la faim elle-même.
Les États-Unis ont ainsi la Food and Drugs Administration, et ici la consommation abstraite de marchandises abstraites s’est donné visiblement ses lois, quoiqu’elles ne fonctionnent pas trop bien, dans les règlements de ce qui se fait appeler « Marché Commun ». C’est même la principale réalité effective de cette institution. Toute tradition historique doit disparaître, et l’abstraction devra régner dans l’absence générale de la qualité (voir l’article Abstraction). Tous les pays n’avaient évidemment pas les mêmes caractéristiques (géographiques et culturelles) dans l’alimentation. Pour s’en tenir à l’Europe, la France avait de la mauvaise bière (sauf en Alsace), du très mauvais café, etc. Mais l’Allemagne buvait de la bonne bière, l’Espagne buvait du bon chocolat et du bon vin, l’Italie du bon café et du bon vin. La France avait du bon pain, de bons vins, de nombreux fromages, beaucoup de volaille et de bœuf. Tout doit se réduire, dans le cadre du Marché Commun, à une égalité de la marchandise polluée. Le tourisme a joué là-dedans un certain rôle, le touriste venant s’habituer sur place à la misère des marchandises que l’on avait justement polluées pour lui, comme il venait consommer tout ce qui était détérioré du fait même de sa présence. Le touriste est en effet celui qui est traité partout aussi mal que chez lui : c’est l’électeur en déplacement.
L’utilité essentielle de la marchandise moderne, qui s’est développée aux dépens de toute autre, est d’être achetée ; c’est ainsi que par un de ces miracles dont elle a le secret, et par la médiation du capital, elle peut « créer des emplois » ! Quant à son emploi à elle, son usage, il est postulé autoritairement ou évoqué fallacieusement, dans le cas des aliments en leur conservant artificiellement quelques caractéristiques de leur état ancien. Mais ces apparences s’adressent bien sûr aux sens les plus faciles à abuser : « Grâce aux nouvelles méthodes employées pour éviter la dégradation des aliments, on trouve en toute saison des fruits et des légumes qui n’apparaissaient autrefois que quelques semaines par mois sur nos marchés. Les pommes, par exemple, qu’on stocke dans de gigantesques frigorifiques. Seul gros problème, les fruits mis au froid y perdent beaucoup de leur saveur naturelle. » (Cosmopolitan, ibidem.) Autrefois, quand les mois ne comptaient que quelques semaines, il y avait un temps pour chaque chose : aujourd’hui nous manquent à la fois la réalité du temps et celle des choses. Ce sont les sens les plus directement pratiques qui sont sacrifiés : la saveur, l’odeur, le tact, sont abolis au profit des leurres qui égarent en permanence la vue et l’ouïe (voir l’article Abbé). L’usage de certains sens étant brimé (il est certain qu’il vaut mieux perdre l’odorat quand on habite une grande ville), et celui d’autres ainsi égaré, on assiste à un recul général de la sensualité, qui va de pair avec le recul extravagant de la lucidité intellectuelle ; lequel commence à la racine avec la perte de la lecture et de la plus grande partie du vocabulaire. Pour l’électeur qui conduit lui-même sa voiture et regarde la télévision, aucune sorte de goût n’a plus aucune sorte d’importance : c’est pourquoi on peut lui faire manger Findus ou voter Fabius, avaler Fabius ou élire Findus. Ses importantes activités, son envahissante passivité, ne lui laissent en effet pas le temps d’acquérir et de développer des goûts qu’opportunément la production marchande n’a elle-même pas le temps de satisfaire : cette merveilleuse adéquation entre absence d’usage et usage de l’absence définit la perte actuelle de tout critère de valeur. Nous retrouvons ainsi la significative question du temps, de ce temps partout gagné pour ne pas vivre. Ainsi le temps consacré autrefois à la préparation des repas étant aujourd’hui absorbé par la contemplation de la télévision, « les consommateurs sont de moins en moins demandeurs des bas morceaux qui exigent de longues préparations alimentaires ». Ces « bas morceaux », à l’aide desquels on confectionnait naguère nombre d’excellents plats de la cuisine populaire française, doivent maintenant être recyclés sous une apparence plus convenable à une préparation rapide : « À y regarder de (pas trop) près, à y goûter, on s’y tromperait. Cela a tout d’une entrecôte : l’aspect, le fondant, la “tendreté”. Pourtant, cela est fait de gîte, de flanchet, de collier de bœuf, bref, de ces morceaux habituellement réservés à la préparation de braisés ou de ragoûts mitonnés. Le bœuf à braiser transformé en bifteck ? C’est ce que nous préparent les chercheurs et industriels qui détruisent l’architecture de la viande, mélangent des morceaux plus ou moins finement divisés et les remettent en forme créant de la viande “restructurée”. » (Le Monde, 25 septembre 1985.) Ne doutons pas que cette restructuration étendra bien vite son champ d’action bien au-delà du domaine des bovidés : « Que l’on parvienne à confectionner des “biftecks” appétissants et tendres à partir de chair de volaille ou de porc, moins coûteuse que celle du bœuf, et “les bovins auraient leur avenir derrière eux”, comme le souligne M. Dumont. » (Ibidem.) Ce Dumont plein d’avenir est directeur du laboratoire de recherche sur la viande de l’Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) ; c’est donc un spécialiste de l’abat-faim, comme celui qui, à propos de la technique de « cuisson-extrusion » qui permet de fabriquer des « produits à structure alvéolaire », comme ceux destinés aux chiens et aux chats, déclare : « Pour ce qui est des applications de ce procédé en alimentation humaine, “tout reste à faire”. » (Ibidem.) Pour ce qui est de nous faire accéder à une bestialité sans instinct, beaucoup est pourtant déjà fait.
La bourgeoisie avait dit longtemps : « Il y a eu de l’histoire, mais il n’y en a plus. » (Marx.) Quand elle bureaucratise sa domination, elle ajoute : « Il y a eu du goût, mais il n’y en a plus. » Il ne doit même plus y avoir, pour chacun, cette histoire individuelle à travers laquelle il découvrait et formait ses goûts. Il faut accepter tout ce qui est là sans distinction, sans prétendre détenir par devers soi quelque critère de jugement que ce soit. Seules doivent s’entendre les proclamations des experts qui, par exemple, nous dépeignent l’avenir radieux du légume irradié et assènent déjà que « jamais les légumes n’ont été aussi bons » (l’Express, 6-12 septembre 1985). Tel est le dernier « look » de la société du spectacle, et tout « look » individuel, si branché qu’il se veuille, ne peut être branché que sur elle ; car c’est elle qui tient tout le réseau. Et ainsi cette « viande-pâtée » qui est l’abat-faim du salarié pauvre, qu’il ingère debout dans un décor de chiottes de gare, peut même se donner l’allure d’un modernisme de pointe, choisi plutôt que subi par ceux qui mangent Mac Donald et pensent Actuel.
Comment en est-on arrivé là ? Qui a voulu cela ? Autrefois, personne. Depuis les physiocrates, le projet bourgeois a été explicitement d’améliorer, quantitativement et qualitativement les produits de la terre, que l’on savait relativement plus immuables que les produits de l’industrie. Ceci a été effectivement réalisé pendant tout le XIXe siècle et au-delà. Les critiques du capitalisme se sont parfois préoccupés davantage de qualité plus grande. Fourier particulièrement, très favorable aux plaisirs et aux passions, et grand amateur de poires, attendait du règne de l’harmonie un progrès des variétés gustatives de ce fruit. Là comme ailleurs les progrès de la civilisation lui ont donné raison en réalisant le contraire. Aujourd’hui on pourrait décrire très concrètement l’état du problème en prenant une recette classique de la cuisine française et en montrant précisément ce que chacun de ses ingrédients est devenu dans la consommation courante (voir l’article Agro-alimentaire).
Les nuisances de l’abat-faim ne se bornent pas à tout ce qu’il supprime, mais s’étendent à tout ce qu’il apporte avec lui par le fait même qu’il existe, selon un schéma qui s’applique à chaque production nouvelle du vieux monde. La nourriture qui a perdu son goût se donne en tout cas pour parfaitement hygiénique, diététique, saine, par rapport aux aventures risquées dans les formes pré-scientifiques d’alimentation. Mais elle ment cyniquement. Non seulement elle contient une invraisemblable dose de poison, la tristement fameuse Union Carbide usinant par exemple ses puissants produits pour l’agriculture, mais elle favorise toutes sortes de carences dont on mesure les résultats, après la fête, dans la santé publique : comme le disait un médecin avec un sens tout scientifique de l’euphémisme, « il semble que l’intensification de la productivité agricole se réalise sans se préoccuper suffisamment de cette notion de qualité dont les oligo-éléments sont un facteur important » (H. Picard, Utilisation thérapeutique des oligo-éléments). Le licite dans le traitement de l’alimentation, quoique épouvantable, s’accompagne en prime d’une part d’illicite toléré, et du franchement illicite qui existe quand même (doses d’hormones dépassées dans le veau, antigel dans le vin, etc.) On sait que le principal cancer répandu aux États-Unis n’est pas celui qui fait ses délices des poumons du fumeur de tabac pollué ou de l’habitant des villes plus polluées encore, mais celui qui ronge les tripes d’un président Reagan, et des soupeurs de son espèce.
Cette grande pratique de l’abat-faim est également responsable de la famine chez les peuples périphériques plus absolument soumis, si l’on ose dire, au système capitaliste mondial. Le processus est simple : les cultures vivrières sont éliminées par le marché mondial, et les paysans des pays dits sous-développés sont magiquement transformés en chômeurs dans les bidonvilles en expansion galopante d’Afrique ou d’Amérique latine. On n’ignore pas que le poisson que pêchaient et mangeaient les Péruviens est maintenant accaparé par les propriétaires des économies avancées, pour en nourrir les volailles qu’ils répandent là sur le marché. Et pour effacer le goût de ce poisson, sans évidemment restaurer quelque autre goût que ce soit, il faut utiliser l’acroléine, produit chimique fort dangereux, que les habitants de Lyon, au milieu desquels on le fabrique, ne connaissent pas — tant comme consommateurs que comme voisins du producteur — ; mais qu’ils ne manqueront pas de connaître un de ces jours, sous une catastrophique lumière.
Les spécialistes de la faim dans le monde (il y en a beaucoup, et ils travaillent la main dans la main avec d’autres spécialistes qui s’emploient à faire croire qu’ici règnent les délices abondantes d’on ne sait vraiment quelle « grande bouffe ») nous communiquent les résultats de leurs calculs : la planète produirait encore bien assez de céréales pour que personne n’y souffre de la faim, mais ce qui trouble l’idylle, c’est que les « pays riches » consomment abusivement la moitié de ces céréales pour l’alimentation de leur bétail. Mais quand on connaît le goût désastreux de la viande de boucherie qui a été ainsi vite engraissée aux céréales, peut-on parler de « pays riches » ? Sûrement non. Ce n’est pas pour nous faire vivre dans le sybaritisme qu’une partie de la planète doit mourir de la famine : c’est pour nous faire vivre dans la boue. Mais l’électeur aime qu’on le flatte, en lui rappelant qu’il a le cœur un peu dur, à vivre si bien pendant que d’autres pays perdus l’engraissent avec les cadavres de leurs enfants, stricto sensu. Ce qui est tout de même agréable à l’électeur, dans ce discours, c’est qu’on lui dise qu’il vit richement. Il aime à le croire.
Non seulement le médicament, mais la nourriture, comme tant d’autres choses, est devenue un secret de l’État. Une des plus fortes objections contre la démocratie, du temps où les classes propriétaires en formulaient encore, parce qu’elles redoutaient encore, non sans raison, ce qu’une démocratie effective signifierait pour elles, était l’évocation de l’ignorance de la majorité des gens, obstacle effectivement rédhibitoire pour qu’ils connaissent et conduisent eux-mêmes leurs affaires. Aujourd’hui, elles se croient donc bien rassurées par les vaccins récemment découverts contre la démocratie, ou plutôt cette petite dose résiduelle que l’on prétend nous garantir : car les gens ignorent aussi bien ce qu’il y a dans leur assiette que les mystères de l’économie, les performances escomptées des armes stratégiques ou les subtils « choix de société » proposés afin que l’on reprenne la même et que l’on recommence.
Quand le secret s’épaissit jusque dans notre assiette, il ne faut pas croire que tout le monde ignore tout. Mais les experts, dans le spectacle, ne doivent pas répandre des vérités aussi dangereuses. Ils les taisent. Tous y trouvent leur intérêt. Et l’individu réel isolé qui ne se fie pas à son propre goût et à ses propres expériences ne peut se fier qu’à la tromperie socialement organisée. Un syndicat pourrait-il le dire ? Il ne peut dire ce qui serait irresponsable et révolutionnaire. Le syndicat défend en principe les intérêts des salariés dans le cadre du salariat. Il défendait, par exemple, « leur bifteck ». Mais c’était un bifteck abstrait (aujourd’hui, c’est quelque chose d’encore plus abstrait, « leur travail », qu’il défend, ou plutôt qu’il ne défend pas). Quand le bifteck réel a presque disparu, ces spécialistes ne l’ont pas vu disparaître, du moins officiellement. Car le bifteck qui existe encore clandestinement, celui fait d’une viande élevée sans chimie, son prix est évidemment plus élevé, et révéler sa simple existence ébranlerait fort les colonnes du temple de la « politique contractuelle ». Dans la nomenklatura occidentale, on sait cependant assez bien de quoi il retourne pour en général se payer au prix fort des aliments sains.
Dans la période qui précéda immédiatement la révolution de 1789, on se souvient combien d’émeutes populaires ont été déchaînées par suite de tentatives alors modérées de falsification du pain, et combien de hardis expérimentateurs ont été traînés tout de suite à la lanterne avant d’avoir pu expliquer leurs raisons, sûrement très fortes. À cette époque, et pendant tout le XIXe siècle, la falsification, marginale et artisanale, était pratiquée au niveau du détaillant : elle n’était pas encore remontée à la source même de la fabrication des aliments, comme elle allait le faire, avec tous les moyens de l’industrie moderne, à partir de la guerre de 1914, qui devait enfanter l’ersatz. Mais elle suscitait une juste colère. Autre temps, autres mœurs ; ou, pour le mieux dire, les bénéfices que la société de classes tire de son lourd équipement spectaculaire, en appareillage et en personnel, paient largement les frais inévitables pour accompagner l’ersatz de son indispensable complément, le bourrage de crânes. C’est ainsi que lorsqu’on a vu, il y a bientôt dix ans, le pain disparaître en France, presque partout remplacé par un pseudo-pain (farines non-panifiables, levures chimiques, fours électriques), non seulement cet événement traumatisant n’a pas déclenché quelque mouvement de protestation et de défense comme il s’en est récemment produit un en faveur de l’école dite libre, mais littéralement personne n’en a parlé. Et comble de cynisme, après nous avoir de telle manière fait passer le goût du pain, on prétend maintenant en faire un objet d’enseignement pour une nouvelle extension de la bureaucratie de la culture : « Il s’agirait de mettre en œuvre une sorte d’éducation du goût qui, peut-être, commencerait par des choses élémentaires : fabriquer son pain, identifier sa composition. Ce même pain qui pourrait faire l’objet d’une campagne, “le pain considéré comme objet du patrimoine”, comme “trésor national vivant”, diraient les Japonais. » (Jack Lang, cité par le Monde, 7-8 avril 1985.) Avec ce nouveau pain « de campagne », on ne saurait mieux nous signifier que dans ce monde l’authentique n’a plus sa place dans la vie courante et doit finir au musée.
Ce sont ainsi tous les plaisirs autrefois qualifiés de « simples » qui deviennent, par leur disparition, l’objet d’une savante muséographie. L’architecture moderne en a déjà supprimé une bonne part dans sa vaste sphère d’action. Certes, si le plaisir était fait de jouissances spectaculaires, on pourrait dire les consommateurs heureux tant qu’ils trouvent des images à brouter. La dangereuse dialectique revient pourtant par ailleurs. Car on voit bien que tout se décompose des dominations de ce monde. Alors que la critique épargne toute leur gestion, tous les résultats les tuent. C’est le syndrome de la maladie fatale de la fin du XXe siècle : la société de classes et spécialisations, par un effort constant et omniprésent, acquiert une immunisation contre tous les plaisirs. L’effondrement de ses défenses immunitaires contre tous les poisons qu’elle produit n’en sera que plus total.
Guy Debord, Encyclopédie des Nuisances, tome I, fascicule 5 Paris, novembre 1985.

