Le marché extraordinairement lucratif de la publication scientifique est-il mauvais pour la science ? Par Stephen Buranyi
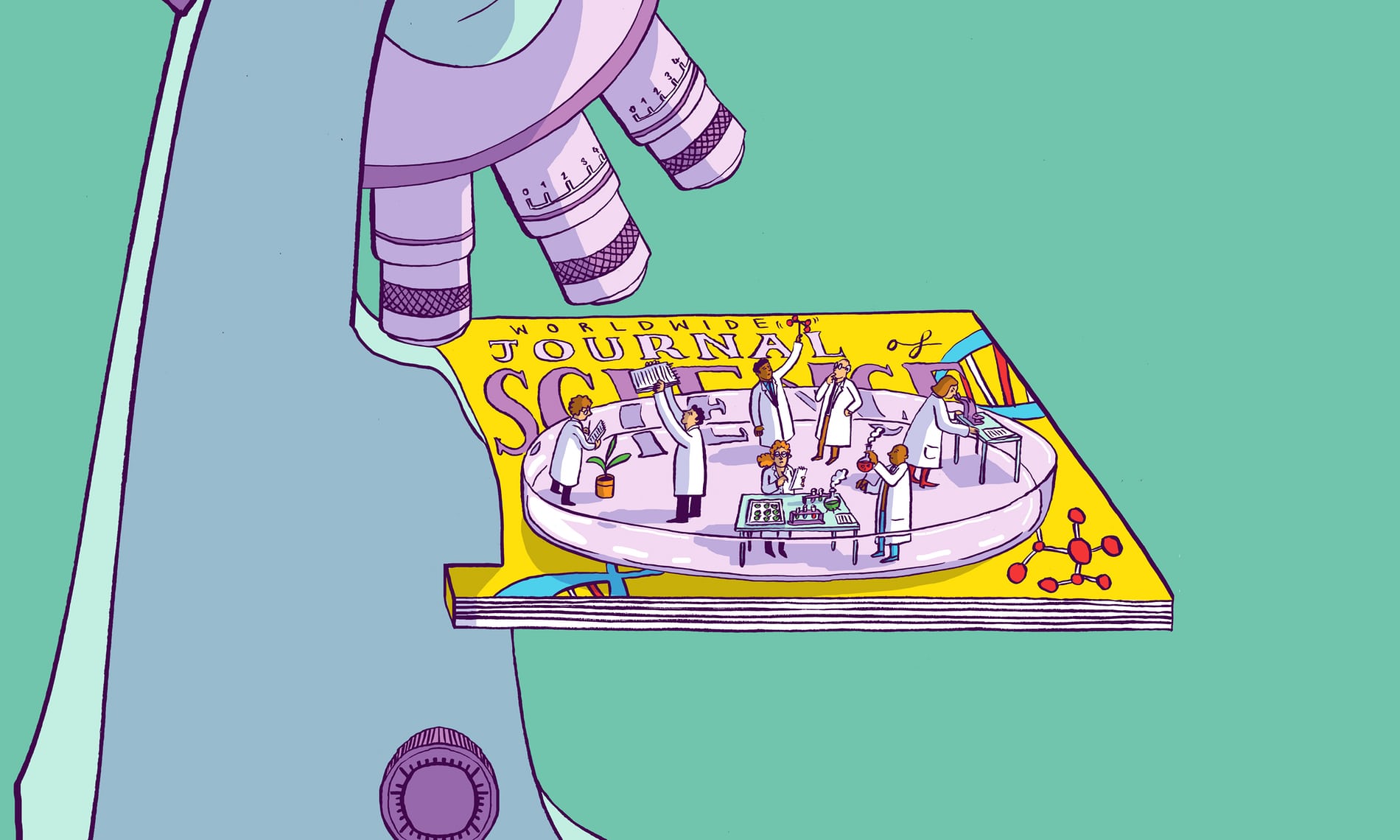
Source : The Guardian, Stephen Buranyi, 27-06-2017
C’est une industrie à nulle autre pareille, avec des taux de marge dignes de Google – et elle a été créée par un des plus célèbres magnats britanniques : Robert Maxwell. Par Stephen Buranyi.
En 2011, Claudio Aspesi, analyste principal en investissement chez Bernstein Research à Londres, avait fait le pari que l’entreprise qui dominait l’une des industries les plus lucratives de la planète allait droit au crash. Reed-Elsevier, un géant mondial de l’édition avec des revenus annuels dépassant les 6 milliards de livres, était le chouchou des investisseurs. C’était un des rares éditeurs ayant réussi la transition vers l’internet et le dernier rapport de la société prévoyait une nouvelle année de croissance. Aspesi avait toutefois des raisons de penser que cette prévision, ainsi que toutes celles des autres principaux analystes financiers, était fausse.
Le cœur des opérations financières d’Elsevier, ce sont les revues scientifiques, les publications hebdomadaires ou mensuelles dans lesquelles les scientifiques partagent les résultats de leurs travaux. En dépit d’un lectorat restreint, la publication scientifique est un marché remarquablement important. Avec des recettes mondiales totales de plus de 19 milliards de livres sterling, ce marché se situe en chiffre d’affaire entre l’industrie du disque et celle du film, mais est beaucoup plus rentable. En 2010, la branche publication scientifique d’ Elsevier déclarait des bénéfices de 724 millions de livres sur des recettes d’un peu plus de 2 milliards de livres. Cela représentait une marge de 36%, plus élevée que celles d’Apple, Google ou Amazon publiées cette année-là.
Mais le modèle économique de Elsevier semblait une chose vraiment étrange. Pour gagner de l’argent, un éditeur traditionnel – un magazine par exemple – doit d’abord couvrir une multitude de frais : il paie les rédacteurs d’articles, il emploie des relecteurs pour commander, mettre en forme et vérifier les articles et il paie la distribution des produits finis aux abonnés et aux détaillants. Tout cela est coûteux et les magazines qui marchent ont en général des marges de profit de 12 à 15%.
La manière de gagner de l’argent en publiant un article scientifique semble très similaire, à la différence que les éditeurs scientifiques parviennent à éviter la plupart des coûts réels. Les scientifiques rédigent leurs travaux sous leur propre direction – largement financés par les gouvernements – et les donnent gratuitement aux éditeurs ; l’éditeur paie des relecteurs scientifiques qui jugent si les travaux méritent d’être publiés et appliquent des corrections grammaticales, mais l’essentiel de la charge éditoriale – vérifier la validité scientifique et évaluer les expériences, un processus qu’on appelle « évaluation par les pairs » est faite par des scientifiques en activité de manière bénévole. Les éditeurs revendent alors le produit aux bibliothèques universitaires et institutionnelles subventionnées par l’État, pour être lu par des scientifiques, qui, pris au sens collectif, sont ceux qui ont créé le produit en premier.
C’est comme si le New Yorker ou The Economist exigeaient que les journalistes écrivent et relisent le travail des uns et des autres gratuitement, et demandaient au gouvernement de régler la note. Les observateurs extérieurs ont tendance à être frappés d’incrédulité quand on leur décrit cette organisation.Un rapport de 2004 de la commission parlementaire sur la science et la technologie observait sèchement que « dans un marché traditionnel les fournisseurs sont payés pour les marchandises qu’ils fournissent ». Un rapport de la Deutsche Bank daté de 2005 le qualifiait de système « bizarre » « à triple profit », dans lequel « l’État finance la plus grande partie de la recherche, paie les salaires de la plupart de ceux qui vérifient la qualité de la recherche, et ensuite achète la plus grande partie du produit publié. »
Les scientifiques sont bien conscients qu’ils semblent conclure un mauvais accord. Le marché de l’édition est « pervers et inutile », écrivait le biologiste de Berkeley Michael Eisen dans un article de 2003 pour The Guardian, déclarant que cela « devrait être un scandale public ». Adrian Sutton, un physicien à l’Imperial College, me confiait que les scientifiques « sont tous esclaves des éditeurs. Quelle autre industrie reçoit ses matières premières de ses clients, fait faire à ces mêmes clients le contrôle qualité de ces matériaux, et ensuite revend ces mêmes matériaux aux clients à un prix qui a subi une très forte inflation ? »
Beaucoup de scientifiques pensent aussi que l’industrie de l’édition exerce trop d’influence sur ce que les scientifiques choisissent d’étudier, ce qui est mauvais au final pour la science elle-même. Les revues attachent beaucoup de valeur aux résultats nouveaux et spectaculaires – après tout, leur métier c’est de vendre des abonnements – et les scientifiques, sachant exactement quels types de travaux sont publiés, alignent leurs contributions en conséquence. Cela produit un flux continu d’articles, dont l’importance est immédiatement apparente. Mais cela signifie aussi que les scientifiques n’ont pas une vision précise de leur champ d’investigation. Les chercheurs peuvent par hasard se retrouver à explorer des impasses auxquelles leurs collègues scientifiques se sont heurtées précédemment, simplement parce qu’aucune place n’a été accordée dans les pages des publications scientifiques sérieuses à l’information sur des échecs précédents. Une étude de 2013, par exemple, rapporte que que la moitié des essais cliniques aux USA ne sont jamais publiés dans une revue.
Selon les critiques, le système des revues freine en réalité le progrès scientifique. Dans un essai datant de 2008, le Dr Neal Young du NIH [Instituts nationaux de la santé], qui finance et mène les recherches médicales pour le gouvernement américain, soutenait que compte tenu de l’importance de l’innovation scientifique pour la société, « il est d’un impératif moral de reconsidérer la manière dont les données scientifiques sont jugées et diffusées. »
Apesi, après s’être adressé à un réseau de plus de 25 scientifiques et activistes de renommée, en est arrivé à penser que le vent commençait à tourner contre le secteur dirigé par Elsevier. De plus en plus de bibliothèques qui achètent les revues pour les universités affirmaient que leurs budgets étaient épuisés en raison de décennies d’augmentation des prix, et menaçaient d’annuler leurs forfaits d’abonnement pesant des millions de livres, si Elsevier ne baissait pas ses prix. Les organismes étatiques tels que le NIH américain ou la DFG (Fondation allemande pour la recherche) s’étaient récemment engagés à rendre disponibles leurs recherches au moyen de revues en ligne gratuites, et Aspesi pensait que les gouvernements interviendraient peut-être pour garantir que toutes les recherches publiquement financées seraient disponibles gratuitement pour tout le monde. Elsevier et ses confrères allaient se retrouver dans la tourmente, les clients se retournant contre eux par le bas, et les réglementations gouvernementales menaçant par le haut.
En mars 2011, Aspesi publiait un rapport recommandant à ses clients de vendre les actions d’Elsevier. Quelques mois plus tard, lors d’une téléconférence entre la direction d’Elsevier et les sociétés de placement, il pressait le président d’Elsevier, Erik Engstrom, au sujet de la dégradation des relations avec les bibliothèques. Il demanda ce qui n’allait pas dans l’entreprise si « vos clients sont si désespérés ». Engstrom évita la question. Les deux semaines suivantes virent la valeur de l’action d’Elsevier dégringoler de plus de 20%. Les problèmes qu’Aspesi avait vus étaient profonds et structurels, et il était convaincu qu’ils entreraient en jeu dans les cinq années suivantes, mais les choses semblaient déjà bouger dans la direction qu’il avait prévue.
Cependant, l’année suivante, la plupart des bibliothèques se rétractèrent et signèrent avec Elsevier, et les gouvernements échouèrent dans une large mesure à introduire un modèle alternatif de diffusion de la recherche. En 2012 et 2013, Elsevier enregistrait des marges de profits de plus de 40%. L’année suivante, Aspesi inversa sa recommandation de vendre. « Il nous a trop bien écoutés, il s’en est un peu brûlé les ailes », me confiait David Prosser, le chef de Research Libraries UK (Bibliothèques de la recherche Royaume Uni), et un acteur de poids dans la réforme de l’industrie de l’édition. Eslevier était là pour durer.
Aspesi n’était pas la première personne à se tromper en prédisant la fin de l’essor de l’édition scientifique, et n’est vraisemblablement pas la dernière. Il est difficile de croire que ce qui est essentiellement un oligopole à but lucratif fonctionnant au sein d’une organisation par ailleurs lourdement réglementée et financée par l’État, puisse échapper l’extinction à longue échéance. Mais l’édition est profondément imbriquée dans la profession scientifique depuis des décennies. Aujourd’hui, tout scientifique sait que sa carrière dépend de la publication de ses travaux, et son succès professionnel se déterminera particulièrement selon que ses travaux apparaissent dans les revues les plus prestigieuses. Le travail long, lent, quasiment sans direction de certains des scientifiques les plus influents du XXe siècle n’est plus une option viable en matière de carrière. Dans le système actuel, le père du séquençage génétique, Fred Sanger, qui ne publia guère durant les vingt années séparant ses deux prix Nobel de 1958 et 1980, se retrouverait probablement sans emploi.
Même les scientifiques qui luttent pour une réforme n’ont souvent pas conscience des origines du système : comment, durant les années prospères après la Seconde Guerre mondiale, des entrepreneurs construisirent leurs fortunes en soustrayant l’édition des mains des scientifiques, développant ainsi l’industrie à une échelle inimaginable auparavant. Et nul n’a été plus créatif et ingénieux que Robert Maxwell qui a fait des revues scientifiques une spectaculaire machine à faire de l’argent permettant ainsi son ascension dans la société britannique. Maxwell deviendra un membre du Parlement, un baron de la presse défiant Rupert Murdoch, et une des figures les plus célèbres de la société britannique. Mais sa véritable importance était bien plus grande que ce que la majorité d’entre nous ne réalise. Aussi improbable que cela puisse paraître, peu de personnes durant le siècle dernier ont contribué davantage à la façon dont la science est traitée aujourd’hui que Maxwell.
En 1946, Robert Maxwell, alors âgé de 23 ans, travaillait à Berlin et jouissait déjà d’une réputation remarquable. Bien qu’il ait grandi dans un village tchèque pauvre, il avait combattu pour l’armée britannique durant la guerre comme membre d’un contingent d’exilés européens, recevant au passage une croix militaire et la nationalité britannique. Après la guerre, il exerça la fonction d’officier du renseignement à Berlin, usant de ses neuf langues pour interroger les prisonniers. Maxwell était grand, bravache et aucunement satisfait de son succès pourtant déjà considérable ; une connaissance de l’époque se souviendra qu’il lui confia son plus grand souhait : « devenir millionnaire ».
Au même moment, le gouvernement britannique préparait un projet improbable qui allait justement lui permettre d’y arriver. Les plus grands scientifiques britanniques (depuis Alexander Fleming qui découvrit la pénicilline jusqu’au physicien Charles Galton Darwin, petit-fils de Charles Darwin) craignaient que bien que la science britannique fût de classe mondiale, sa branche d’édition ne fût lamentable. Les éditeurs scientifiques étaient principalement connus pour être inefficaces et constamment fauchés. Les revues, paraissant souvent sur du papier fin et bon marché, étaient presque reléguées au second plan par les cercles scientifiques. La Société britannique de chimie avait un arriéré de plusieurs mois d’articles à publier, et comptait sur des dons d’argent de la part de la Royal Society pour gérer ses opérations d’impression.
La solution du gouvernement fut d’unir la vénérable maison d’édition britannique Butterworths (aujourd’hui propriété d’Elesvier) à l’éditeur allemand Springer, afin de profiter de l’expertise de ce dernier. Butterworths devait apprendre à créer du profit sur les revues, et la science britannique verrait ses travaux publiés plus rapidement. Maxwell avait déjà créé sa propre entreprise qui aidait Springer à expédier les articles scientifiques vers la Grande-Bretagne. Les gérants de Butterworths, eux-mêmes des anciens du renseignement britannique, engagèrent le jeune Maxwell pour les aider à gérer la société, ainsi qu’un autre ancien espion, Paul Rosbaud, métallurgiste de métier qui transmit durant la guerre des secrets nucléaires nazis aux Anglais au travers de la résistance française et hollandaise, recruté en tant qu’éditeur scientifique.
Ils ne pouvaient pas commencer à un meilleur moment. La science était sur le point d’entrer dans une période de développement sans précédent, autrefois un passe-temps de gentleman fortuné, elle acquérait le statut d’une profession respectée. Dans les années d’après-guerre, elle deviendrait synonyme de progrès. « La science demeurait en coulisse. Elle devrait être amenée au-devant de la scène, car en elle réside une bonne partie de notre espoir pour l’avenir », écrivait l’ingénieur américain et administrateur du projet Manhattan, Vannevar Bush, dans un rapport datant de 1945 adressé au Président Harry S. Truman. Au lendemain de la guerre, le gouvernement s’imposera pour la première fois comme principal mécène des efforts scientifiques, non seulement dans le domains militaire, mais également au travers d’agences fraîchement créées comme la Natural Science Foundation américaine, et du système universitaire en expansion rapide.
Lorsque Butterworths décida en 1951 d’abandonner le projet naissant, Maxwell racheta les actions de Butterworths ainsi que celles de Springer pour treize mille livres (environ 420 mille livres d’aujourd’hui), s’octroyant ainsi le contrôle de la société. Rosbaud y conservait son titre d’éditeur scientifique, et nomma la nouvelle entreprise Pergamon Press, en référence à une pièce de monnaie de la ville de Pergame du temps de la Grèce antique, représentant Athéna, la déesse de la sagesse, qu’ils adaptèrent au logo de la société (un simple trait de dessin représentant judicieusement la connaissance et l’argent).
Dans un milieu fraîchement empli de liquidités et d’optimisme, ce fut Rosbaud qui lança la méthode qui mènera Pergame au succès. Alors que la science se développait, il réalisa qu’il lui faudrait de nouvelles revues pour couvrir les nouveaux secteurs d’étude. Les sociétés scientifiques qui avaient traditionnellement créé les revues étaient des institutions lourdes qui avaient tendance à réagir lentement, ralenties par des débats internes entre leurs membres sur les limites de leur expertise. Rosbaud n’avait aucune de ces contraintes. Il n’avait qu’à convaincre simplement un universitaire de renom que son expertise particulière justifiait l’existence d’une nouvelle revue pour la présenter régulièrement, puis ensuite installer cette personne à sa tête. Pergame lançait ensuite la vente d’abonnements aux bibliothèques universitaires qui se trouvaient soudainement dotées de beaucoup d’argent public à dépenser.
Maxwell apprenait vite. En 1955, il participa avec Rosbaud à la conférence de Genève sur l’énergie atomique pour usages pacifiques. Maxwell loua un bureau près de la conférence et déambula de séminaires en événements officiels, proposant de publier tous les travaux que les scientifiques étaient venus présenter, et leur demandant de signer des contrats d’exclusivité pour éditer les revues de Pergame. Les autres éditeurs étaient choqués par son style impétueux. Daan Frank du North Holland Publishing (aujourd’hui propriété d’Elsevier) se plaindra plus tard que Maxwell était « malhonnête » d’avoir raflé des scientifiques sans considération pour le contenu spécifique.
Rosbaud également était semble-t-il rebuté par l’avidité de Maxwell. Contrairement à l’ancien scientifique modeste, Maxwell préférait les costumes coûteux et les cheveux gominés. Après avoir transformé son accent tchèque en une très chic voix de basse digne d’un présentateur, il avait l’allure et le ton du magnat qu’il rêvait d’être. En 1955, Rosbaud confiera au physicien nobélisé Nevill Mott que les revues étaient ses petites « agnelles », et que Maxwell était le roi David de la Bible, qui les dépècerait pour se faire de l’argent. En 1956, les deux eurent une dispute, et Rosbaud quitta la société.
A l’époque, Maxwell avait transformé le modèle économique de Rosbaud en quelque chose qui n’appartenait qu’à lui. Les conférences scientifiques avaient tendance à être des choses ternes dans des salles bas de plafond, mais lorsque Maxwell retourna à la conférence de Genève cette année-là, il loua une maison à Collonge-Bellerive, une ville voisine pittoresque au bord du lac, où il organisait des soirées pour ses invités leur offrant alcool, cigares et virées en voilier. Les scientifiques n’avaient jamais vu quelqu’un comme lui. « Il disait toujours que la concurrence n’était pas sur les ventes mais sur les auteurs », me confia Albert Henderson, un ancien vice-directeur chez Pergame. « On participait aux conférences précisément pour recruter des éditeurs pour de nouvelles revues ». Des histoires courent sur des fêtes organisées sur le toit du Hilton d’Athènes, des vols offerts sur le Concorde, de scientifiques se voyant embarqués sur une croisière entre les îles grecques pour organiser leur nouvelle revue.
En 1959, Pergame publiait 40 revues. Six ans plus tard, elle en publiait 150. Ce qui plaçait Maxwell bien en tête de la compétition. (En 1959, le rival de Pergame, Elsevier, avait seulement 10 revues en anglais, et la société n’en compterait que 50 dix ans plus tard). En 1960, Maxwell avait pris l’habitude de se faire conduire en Rolls-Royce, et avait déménagé son domicile et les bureaux de Pergame de Londres à la propriété grandiose de Headington Hill Hall à Oxford, qui accueillait également la maison d’édition de livres britannique Blackwell.
Les sociétés scientifiques telles que la Société britannique de rhéologie, voyant comment les choses tournaient, commencèrent même à laisser Pergame prendre le contrôle de leurs revues moyennant une somme modique régulière. Leslie Iversen, ancien rédacteur en chef à la Revue de Neurochimie, se souvient avoir été courtisé avec des dîners somptueux au domaine de Maxwell. « Il était très impressionnant », se souvient Iversen. « Après un dîner arrosé d’un bon vin, il nous présentait un chèque, quelques milliers de livres pour la société. C’était plus d’argent qu’aucun de nous, pauvres scientifiques, n’avions jamais vu. »
Maxwell tenait aux titres solennels — « Revue internationale de » était un de ses préfixes favoris. Peter Ashby, ancien vice-président chez Pergame, décrit cela comme une « astuce de Relations Publiques », mais c’est également le reflet d’une solide compréhension de la façon dont la science, et l’attitude de la société envers la science, avait changé. Collaborer et rendre leur travail visible au niveau international était devenu une nouvelle forme de prestige pour les chercheurs, et à plusieurs reprises Maxwell avait accaparé le marché avant que quiconque ne réalise jusqu’à son existence. Lorsque l’Union soviétique lança Spoutnik, le premier satellite artificiel, en 1959, les scientifiques occidentaux se ruèrent pour rattraper la recherche spatiale russe, et furent surpris d’apprendre que Maxwell, plus tôt dans la décennie, avait déjà négocié un accord exclusif pour publier en anglais les revues de l’Académie russe des sciences.
« Il avait des intérêts partout. Je suis allé au Japon, où il avait mis un Américain qui gérait un bureau tout seul. Je suis allé en Inde, il y avait mis quelqu’un », dit Ashby. Et les marchés internationaux pouvaient être très lucratifs. Ronald Suleski qui géra le bureau japonais de Pergame dans les années 70, me confia que les sociétés scientifiques japonaises, prêtes à tout pour voir leur travail publié en anglais, avaient cédé à Maxwell les droits des travaux de leurs membres sans contrepartie.
Dans une lettre fêtant les 40 ans de Pergame, Eiichi Kobayashi, directeur de Maruzen, le distributeur japonais de longue date de Pergame, écrivait en se souvenant de Maxwell : « chaque fois que j’ai le plaisir de le rencontrer, cela me fait penser aux mots de F. Scott Fitzgerald qu’un millionnaire n’est pas un homme ordinaire ».
L’article scientifique est essentiellement devenu la seule façon pour la science d’être systématiquement représentée dans le monde. (Comme le dit Robert Kiley, chef des services numériques à la bibliothèque du Wellcome Trust, la seconde source de financement mondiale de la recherche bio-médicale : « Nous dépensons un milliard de livres par an, et en échange, nous avons des articles. ») Il est la source première de notre domaine de compétence le plus respecté. « La publication est l’expression de notre travail. Une bonne idée, une conversation ou une correspondance, même de la part de la personne la plus brillante du monde… ne compte pour rien si vous ne la faites pas publier », explique Neal Young du NIH. Contrôler l’accès à la littérature scientifique, c’est comme, à tous égards, contrôler la science.
Le succès de Maxwell s’est construit sur un aperçu de la nature des revues scientifiques que d’autres mettront des années à comprendre et reproduire. Pendant que ses concurrents se plaignaient qu’il diluait le marché, Maxwell savait qu’en fait le marché n’avait pas de limite. En créant la Revue de l’énergie nucléaire, la revue de l’éditeur concurrent North Holland, Physiques nucléaires, n’en perdait pas d’activités pour autant. Les articles scientifiques parlent de découvertes uniques : un article ne peut pas se substituer à un autre. Si une nouvelle revue sérieuse apparaît, les scientifiques demanderaient simplement à leur bibliothèque universitaire de s’y abonner aussi. Si Maxwell créait trois fois plus de revues que ses concurrents, il gagnait trois fois plus d’argent.
La seule limite possible était un ralentissement du financement public, mais il y avait peu de risque que cela arrive. Dans les années 60, Kennedy finança le programme spatial, et au début des années 70, Nixon déclarait « la guerre au cancer », alors qu’au même moment le gouvernement britannique développait son propre programme nucléaire avec l’aide des Américains. Peu importe le climat politique, la science se voyait stimulée par de grandes vagues de deniers publics.
A ses débuts, Pergame s’est trouvée au centre de débats virulents sur l’éthique de l’introduction des intérêts commerciaux au monde de la science supposé désintéressé et anti-profits. Dans une lettre datant de 1988 célébrant le 40e anniversaire de Pergame, John Coales de l’université de Cambridge remarquait qu’initialement, beaucoup de ses amis « considéraient [Maxwell] comme le plus grand bandit pas encore pendu ».
Mais à la fin des années 60, l’édition commerciale se présentait comme le statu quo, et les éditeurs étaient considérés comme un partenaire nécessaire aux avancées de la science. Pergame a permis d’amplifier le grand essor de ce domaine en accélérant le processus d’édition et en le présentant sous un ensemble plus élégant. Malgré leurs réserves quant au renoncement à leurs droits d’auteurs, les scientifiques appréciaient davantage la commodité de faire affaire avec Pergame, l’éclat que cela procurait à leurs travaux, et la force de la personnalité de Maxwell. Les scientifiques semblaient bien heureux avec le loup qu’ils avaient laissé entrer.
« C’était un tyran, mais je l’aimais bien », au dire de Denis Noble, un physiologiste de l’université d’Oxford et l’éditeur de la revue Progrès en biophysique et biologie moléculaire. De temps en temps, Maxwell invitait Noble chez lui pour une réunion. « Souvent c’était la fête, il y avait un bel ensemble musical, il n’y avait pas de séparation entre son travail et sa vie personnelle », explique Noble. Maxwell alternait ensuite entre intimidation et charme pour le faire scinder la revue semestrielle en une publication mensuelle ou bimensuelle, laquelle permettrait l’augmentation des cotisations d’abonnement.
En fin de compte, Maxwell s’inclinait presque toujours face aux scientifiques, et les scientifiques avaient fini par apprécier sa personnalité imposante. « Je dois avouer, même en réalisant très tôt ses ambitions d’entrepreneur prédateur, il m’a néanmoins beaucoup plu », écrira Arthur Barret, alors éditeur de la revue Vacuum, dans un article datant de 1988 sur les premières années de la revue. Et le sentiment était partagé. Maxwell adorait ses liens avec les célèbres scientifiques qu’il traitait avec une déférence peu habituelle. « Il a réalisé très tôt que les scientifiques étaient essentiels. Il faisait tout ce qu’ils voulaient. Ça rendait le reste des employés fous », me confia Richard Coleman, qui avait travaillé à la production des revues chez Pergame vers la fin des années 60. Lorsque Pergame a fait l’objet d’une tentative de prise de contrôle hostile, un article du Guardian en 1973 nous apprenait que les éditeurs de revues menaçaient de « désertion » plutôt que de travailler pour un autre PDG.
Maxwell avait transformé le domaine de l’édition, mais le travail quotidien de la science était resté le même. Les scientifiques pouvaient toujours proposer leurs travaux à n’importe quelle revue qui convenait le mieux au domaine de leurs recherches — et Maxwell était heureux de publier toutes recherches que ses éditeurs jugeaient comme suffisamment rigoureuses. Mais au milieu des années 70, les éditeurs ont commencé à se mêler de la pratique de la science elle-même, s’engageant ainsi sur un chemin qui emprisonnera la carrière des scientifiques dans le système de l’édition, imposant ainsi à la direction des recherches les règles propres à l’édition. Une revue devint le symbole de cette transformation.
« Au début de ma carrière, peu importait vraiment où nous étions publiés, mais tout a changé en 1974 avec Cell [cellule] », me confia Randy Schekman, biologiste moléculaire à Berkeley et prix Nobel. La revue Cell (aujourd’hui propriété d’Elsevier) fut créée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans le but de présenter un domaine fraîchement dominant, celui de la biologie moléculaire. Elle était éditée par un jeune biologiste du nom de Ben Lewin qui abordait son travail avec acharnement et un talent presque littéraire. Lewin préférait les articles longs et rigoureux qui traitaient de grandes questions (souvent représentant des années de recherches qui auraient fourni plusieurs articles dans d’autres revues) et faisant un trait sur l’idée que les journalistes étaient des instruments passifs utiles de communication scientifique, il a rejeté bien plus d’articles qu’il n’en a publié.
Il avait créé une revue pour les « superproductions » scientifiques, et les scientifiques ont commencé à modeler leurs travaux selon ses règles. « Lewin était malin. Réalisant que les scientifiques sont très vaniteux, ils voulaient êtres membres de ce club select ; Cell était LE club, et il fallait y avoir son article », explique Schekman. « Moi aussi je subissais cette sorte de pression ». Il a fini par publier dans Cell certains de ses travaux qui furent cités pour son prix Nobel.
Subitement, l’espace où l’on était publié était devenu extrêmement important. D’autres éditeurs suivirent une démarche activiste similaire dans l’espoir de renouveler le succès de Cell. Les éditeurs avaient également adopté un indicateur appelé « facteur d’impact », inventé dans les années 60 par Eugene Garfield, un bibliothécaire et linguiste, destiné à calculer sommairement la fréquence avec laquelle un article paru dans une revue en particulier est cité dans d’autres revues. Il devint le moyen pour les éditeurs de classer et promouvoir la portée scientifique de leurs produits. Les nouvelles versions des revues, mettant l’accent sur les grandes trouvailles, se retrouvèrent très rapidement au sommet de ces nouveaux classements, et les scientifiques qui publiaient dans les revues à « fort impact » se voyaient récompensés par des emplois et des financements. Presque du jour au lendemain, une nouvelle monnaie du prestige fut créée dans le monde scientifique. (Garfield plus tard dira de sa création qu’elle était « comme l’énergie nucléaire… un bienfait tout relatif »).
On ne peut surestimer l’influence que l’éditeur d’une revue avait désormais sur le cours de la carrière d’un scientifique, et sur la direction même de la science. Schelman explique : « Les jeunes me disent tout le temps : si je ne publie pas dans CNS [un acronyme commun pour Cell/Nature/Science, les revues les plus prestigieuses en biologie], je ne trouverai pas d’emploi ». Il comparaît la recherche de publications à fort impact à un système d’incitation aussi pourri que les bonus bancaires. Il poursuit : « Ils ont une influence énorme sur la où va la science. »
Ainsi la science est-elle devenue une étrange coproduction entre les scientifiques et les éditeurs de revues, ces derniers recherchant de plus en plus les découvertes qui impressionneront les premiers. De nos jours, s’il a le choix des projets, un scientifique refusera presque toujours aussi bien le travail prosaïque de confirmer ou d’infirmer des études passées que les recherches qui dureraient des dizaines d’années pour risquer de ne rien donner, et préférera plutôt un compromis ; un sujet qui soit populaire auprès des éditeurs et qui ait des chances d’être régulièrement publié. « Les universitaires sont incités à produire des recherches qui répondent à ces demandes », avançait le biologiste et prix Nobel Sydney Brenner dans une interview en 2014, qualifiant le système de « corrompu ».
Maxwell avait compris la façon dont les revues étaient désormais les faiseurs de rois de la science. Mais son souci principal était toujours de se développer, fort de sa vision perçante de la direction qu’avait prise la science et des nouveaux domaines de recherches qu’il pouvait coloniser. Richard Charkin, ancien PDG de l’éditeur britannique Macmillan, et qui était en 1974 éditeur chez Pergame, se souvient de Maxwell brandissant un rapport d’une page fait par Watson et Crick sur la structure de l’ADN, lors d’une réunion éditoriale, et déclarant que l’avenir était dans la science de la vie et dans la multitude de ses petites questions, chacune propice à sa propre revue. « Je crois que nous avons lancé une centaine de revues cette année-là », se souvient Charkin. « Je veux dire, bordel… »
Pergame a également étendu ses activités aux sciences sociales et à la psychologie. Une série de revues commençant par « Ordinateurs et » suggère que Maxwell avait repéré l’importance grandissante de la technologie numérique. Comme me le dit Peter Ashby, « C’était sans fin. Oxford polytechnic [aujourd’hui Oxford Brookes University] a ouvert un département Réceptions avec un chef cuisinier. Il a fallu qu’on aille chercher qui dirigeait le département et lui faire lancer une revue. Et paf, Revue internationale de la gestion de réceptions. »
A la fin des années 70, Maxwell avait également affaire à un marché plus encombré. « A l’époque j’étais à Oxford Univerity Press », m’explique Charkin. « On s’est assis et dit : Bon sang, ces revues rapportent beaucoup d’argent ! » Au même moment, aux Pays-Bas, Elsevier avait commencé à développer ses revues en anglais, absorbant la concurrence domestique grâce à une série d’acquisitions et croissant à raison de 35 titres par an.
Comme Maxwell l’avait prédit, la concurrence n’a pas eu l’effet de diminuer les tarifs. Entre 1975 et 1985, le prix d’une revue a doublé. Le New York Times nous informe qu’en 1984, un abonnement à la revue Brain Research coûtait 2 500 dollars; en 1988, il coûtait plus de 5000 dollars. La même année, la bibliothèque de Harvard avait dépassé son budget pour les revues de recherches d’un demi-million de dollars.
Même si les scientifiques remettaient en question occasionnellement l’équité de ce commerce immensément rentable auquel ils fournissaient leurs travaux gratuitement, les bibliothécaires universitaires furent cependant ceux qui prirent conscience du piège que Maxwell avait construit dans le marché. Les bibliothécaires utilisaient les fonds universitaires pour acheter les revues au nom des scientifiques. Maxwell en était bien conscient. « Les scientifiques ne sont pas aussi sensibles aux prix que d’autres professionnels, principalement parce qu’ils ne dépensent pas leur propre argent », confie-t-il dans une interview de son édition Global Business en 1988. Et vu qu’il n’était aucunement possible d’échanger une revue pour une autre moins chère, le résultat fut, continue Maxwell, « une machine à financement perpétuel ». Les bibliothécaires se trouvèrent prisonniers d’une série de milliers de petits monopoles. Avec désormais plus d’un million d’articles scientifiques publiés par an, ils devaient les acheter tous au tarif défini par les éditeurs.
D’un point de vue commercial, c’était une victoire absolue pour Maxwell. Les bibliothèques étaient un marché captif, et les revues s’étaient invraisemblablement placées comme les gardiennes du prestige scientifique — c’est-à-dire que les scientifiques ne pouvaient pas simplement les abandonner s’il advenait une nouvelle méthode de partage des découvertes. « Si nous n’avions pas été aussi naïfs, nous aurions depuis longtemps compris notre position réelle : que nous sommes assis sur une montagne d’argent que des malins de tous bords tentent de transférer vers leurs montagnes », écrivait le bibliothécaire de l’Université du Michigan, Robert Houbeck, dans une revue professionnelle en 1988. Trois ans plus tôt, en dépit d’une baisse des financements scientifiques qui était la première depuis des décennies à durer autant d’années, Pergame enregistrait une marge bénéficiaire de 47%.
Maxwell ne continuerait pas de s’occuper de son empire victorieux. La nature avide qui a permis le succès de Pergame sera également ce qui l’amènera à effectuer une pléthore d’investissements exubérants mais douteux, comme ceux des équipes de football de Oxford United et Derby County FC, les chaînes de télévisions autour du globe, et en 1984, le groupe de presse anglais Mirror où il passa de plus en plus de son temps. En 1991, afin de financer l’acquisition imminente du New York Daily News, Maxwell vendait Pergame à son discret concurrent hollandais Elsevier pour 440 millions de livres (919 millions de livres aujourd’hui).
Beaucoup d’anciens employés de Pergame m’ont confié individuellement qu’ils savaient que c’en était fini pour Maxwell lorsqu’il signa avec Elsevier, car Pergame était la société qu’il aimait vraiment. Plus tard la même année, il se trouva empêtré dans des scandales en relation avec ses dettes croissantes, des pratiques comptables douteuses, et une accusation explosive de la part du journaliste américain Seymour Hersh selon laquelle il était un espion israélien lié à des trafiquants d’armes. Le 5 novembre 1991, on retrouvait Maxwell noyé près de son yacht dans les îles Canaries. Tout le monde en fut choqué, le lendemain, le journal à scandale rival du Mirror soulevait la question que tout le monde avait en tête : « EST-IL TOMBÉ … A-T-IL PLONGÉ ? » criaient les titres. (Une troisième explication, qu’on l’avait poussé, sera aussi évoquée).
L’histoire a dominé la presse anglaise pendant des mois, la thèse du suicide prenant de l’ampleur après qu’une enquête avait révélé qu’il avait volé plus de 400 millions de livres au fonds de retraite du Mirror pour éponger ses dettes. (En décembre 1991, le rapport d’un médecin légiste espagnol déclara sa mort comme accidentelle.) Les spéculations étaient sans limite : en 2003, les journalistes Gordon Thomas et Martin Dillon ont publié un livre affirmant que Maxwell avait été assassiné par le Mossad dans le but de dissimuler ses activités d’espionnage. Maxwell, à cette époque, était mort depuis longtemps, mais l’entreprise qu’il avait lancée continuait de prospérer chez son nouveau propriétaire, pour atteindre de nouveaux niveaux de bénéfice et de puissance globale dans les décennies a suivre.
Si le génie de Maxwell résidait dans le développement, celui d’Elsevier était dans la consolidation. Avec l’acquisition de Pergame et son catalogue de 400 revues, Elsevier contrôlait désormais plus de 1 000 revues scientifiques, en faisant ainsi de loin le plus grand éditeur scientifique du monde.
Lors de la fusion, Charkin, l’ancien PDG de Macmillan, se souvient avoir prévenu Pierre Vinken, PDG d’Elsevier, que Pergame était une entreprise arrivée à maturité, et qu’Elsevier l’avait achetée trop cher.Mais Vinken n’avait aucun doute, se souvient Charkin : « Il disait : vous n’avez aucune idée à quel point ces revues sont rentables une fois que vous arrêtez de faire quoi que ce soit. Lorsque vous préparez une revue, vous y passez du temps pour créer de bons comités éditoriaux, vous les choyez, vous leur offrez des dîners. Ensuite vous lancez le truc sur le marché et vos vendeurs partent vendre des abonnements, ce qui est lent et difficile, et vous tentez de faire de cette revue la meilleure possible. C’est ce qui s’est passé chez Pergame. Après, on l’achète et on arrête de faire tout ça, et donc l’argent ne fait que se déverser et vous n’y croyez pas tellement c’est merveilleux. Il avait raison, et j’avais tort. »
En 1994, soit trois ans après l’acquisition de Pergame, Elsevier avait augmenté ses tarifs de 50 %. Les universités se plaignaient que les budgets étaient poussés à la limite — le Publishers Weekly américain faisait état de bibliothécaires parlant d’une « machine apocalypse » dans leur industrie — et pour la première fois, ils commencèrent à annuler leurs abonnements au profit de revues moins populaires.
At the time, Elsevier’s behaviour seemed suicidal. It was angering its customers just as the internet was arriving to offer them a free alternative. A 1995 Forbes article described scientists sharing results over early web servers, and asked if Elsevier was to be “The Internet’s First Victim”. But, as always, the publishers understood the market better than the academics.
A l’époque, l’attitude d’Elsevier paraissait suicidaire. Leurs clients étaient furieux, juste quand internet faisait son entrée en leur offrant une alternative gratuite. Un article du Forbes en 1995 décrivait des scientifiques partageant leurs recherches sur les premiers serveurs web et se demandait si Elsevier allait être « la première victime du net ». Mais comme toujours, les éditeurs saisissaient le marché mieux que les universitaires.
En 1998, Elsevier déployait son plan pour l’ère de l’internet qu’elle appellera « The Big Deal » [le grand plan]. Il offrait l’accès électronique à des forfaits de centaines de revues à la fois : une université payait un tarif fixé chaque année (selon un rapport fondé sur des requêtes de liberté d’information, la facture en 2009 de l’université de Cornell s’élevait à peine 2 millions de livres) et tout étudiant ou professeur pouvait télécharger toute revue qu’il souhaitait à partir du site web d’Elsevier. Les universités adhérèrent en masse.
Ceux qui avaient prédit la chute d’Elsevier avaient présumé que les scientifiques qui s’essayaient au partage en ligne gratuit de leurs travaux pourraient doucement surpasser les titres d’Elsevier en les remplaçant, un par un. En réponse, Elsevier a créé un interrupteur qui fusionnait en un seul les milliers de petits monopoles de Maxwell, si énorme qu’au même titre qu’une ressource de base (comme l’eau ou l’électricité) il était impossible pour les universités de s’en passer. Soit ils payaient, et les lumières scientifiques restaient allumées, soit ils refusaient, et presque un quart de la littérature scientifique se retrouvait dans le noir dans chaque institution. Un pouvoir immense se trouvait concentré entre les mains des plus grands éditeurs, et les profits d’Elsevier connurent une nouvelle montée en flèche qui atteignaient des milliards dans les années 2010. En 2015, le Financial Times consacrait Elsevier comme « l’entreprise qu’Internet n’a pas réussi à tuer ».
Les éditeurs se sont tellement immiscés dans les divers organes du corps scientifique qu’aucun effort n’a pu les en déloger. Dans un rapport de 2015, un informaticien de l’université de Montréal, Vincent Larivière, démontrait qu’Elsevier possédait 24% du marché des revues scientifiques, tandis que Springer, les anciens partenaires de Maxwell et ses rivaux dans son secteur Wiley-Blackwell en contrôlaient chacun 12%. Ces trois sociétés représentaient la moitié du marché. (Un représentant d’Elsevier au fait du rapport me confiait que selon leur propre estimation ils publient à peine 16% de la littérature scientifique.)
« Malgré les conseils que je donne partout dans le monde à ce sujet, le règne des revues semble encore plus important qu’auparavant », me confiait Randy Schekman. Cette influence, plus que les profits qui ont permis l’expansion du système, est ce qui frustre le plus les scientifiques aujourd’hui.
Selon Elsevier, son objectif principal est de faciliter les travaux des scientifiques et autres chercheurs. Un commercial d’Elsevier remarquait que la société recevait un million et demi de soumissions d’articles l’an passé, et en publiait 420 000 ; 14 millions de scientifiques confiaient à Elsevier la tâche de publier leurs résultats, et 800 000 scientifiques font don de leur temps pour aider à la relecture et à l’évaluation par les pairs. « Nous aidons les chercheurs à être plus productifs et efficaces », me disait Alicia Wise, vice-présidente directrice des réseaux stratégiques globaux. « Et c’est un gain pour les institutions de recherche et pour les sources de financement de la recherche comme les gouvernements ».
Quant à savoir pourquoi tant de scientifiques sont aussi critiques vis-à-vis des éditeurs de revue, Tom Reller, vice-président des relations d’entreprise chez Elsevier, explique : « Ce n’est pas à nous de parler des motivations des autres. Nous nous fions aux nombres [de scientifiques qui confient leurs résultats à Elsevier] et cela montre que nous faisons du bon travail ». Interrogé au sujet des critiques relatives au modèle économique d’Elsevier, Reller écrivait dans un e-mail que ces critiques ne prenaient pas en compte « tout ce que les éditeurs font pour ajouter de la valeur — bien au-delà des contributions apportées par les financements du secteur public ». Voilà, dit-il, ce qu’ils facturaient.
Dans un sens, ce n’est la faute d’aucun éditeur si le monde scientifique semble se plier à la force de gravité de l’industrie. Si des gouvernements comme ceux de la Chine et du Mexique offrent des bonus financiers pour publier dans des revues à fort impact, ce n’est pas parce qu’ils répondent à une demande d’un éditeur, mais parce qu’ils suivent les avantages d’un système extrêmement complexe qui se doit de satisfaire les idéaux utopiques de la science face aux objectifs commerciaux des éditeurs qui la dominent. (« Les scientifiques que nous sommes n’avons pas abondamment réfléchi sur les eaux dans lesquelles nous nageons », me confia Neal Young).
Depuis le début des années 2000, les scientifiques défendent une alternative à la publication par abonnement appelée « accès libre ». Cela résout la difficulté d’équilibrer les impératifs scientifiques et commerciaux simplement en faisant fi de l’élément commercial. En pratique, cela prend habituellement la forme de revues en ligne, auxquelles les scientifiques versent une commission initiale couvrant les frais de d’édition, ce qui assure ensuite la disponibilité des travaux accessibles à tous gratuitement et à perpétuité. Cependant, malgré l’appui de quelques-unes des plus grosses agences de financement au monde, comme la fondation Gates et le Wellcome Trust, à peine un quart des articles scientifiques sont rendus accessibles gratuitement au moment de leur publication.
Le concept selon lequel les recherches scientifiques devraient être gratuitement disponibles pour tous se démarque nettement du système actuel, le menace même — il se fonde en effet sur la capacite des éditeurs à restreindre l’accès à la littérature scientifique afin de maintenir son immense rentabilité. Ces dernières années, l’opposition la plus radicale au statu quo s’est concrétisée autour d’un site web controversé appelé Sci-Hub — une sorte de Napster pour la science qui permet à chacun de télécharger gratuitement des articles scientifiques. Sa créatrice, Alexandra Elbakyan, une kazakh, vit dans la clandestinité, accusée de piratage et de violation de droits d’auteur aux États-Unis. Elsevier a récemment obtenu une injonction de 15 millions de dollars (le montant autorisé maximal) contre elle.
Elbakyan est une utopique invétérée. « La science devrait appartenir aux scientifiques et non aux éditeurs », m’a-t-elle écrit dans un e-mail. Elle citait dans une lettre adressée au tribunal, l’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme, faisant valoir le droit « de profiter de l’avancement scientifique et de ses bénéfices ».
Quel que soit le sort de Sci-hub, il semble que la frustration à l’égard du système actuel prenne de l’ampleur. Mais l’histoire montre que parier contre les éditeurs scientifiques est une opération risquée. Après tout, si l’on se remémore 1988, Maxwell avait prédit qu’à l’avenir il ne resterait qu’une poignée de maisons d’édition, et qu’elles exerceraient leurs activités dans une ère de l’électronique sans aucun coût d’impression, menant ainsi presque à « un pur profit ». Ça ressemble beaucoup au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Illustrations par Dom McKenzie
Source : The Guardian, Stephen Buranyi, 27-06-2017




