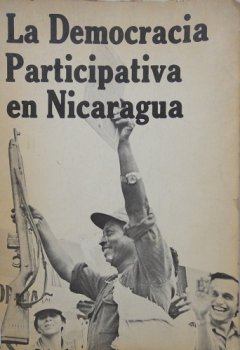Les thèmes et les usages de la démocratie participative sont aujourd’hui d’actualité. Plusieurs sont les diplomates et personnalités latino-américaines qui interviendront au cours de ce colloque sur les formes que celle-ci prend à Cuba ou au sud du Rio Bravo, au Venezuela, en Bolivie et dans d’autres parties du continent sud.
Par conséquent, nous ne répéterons pas ce qui a déjà été dit ou ce qui sera dit à propos de ces pays. Notre discours explorera donc d’autres horizons, en particulier l’horizon français et, plus brièvement, l’horizon nicaraguayen. Nous devons également renoncer à rappeler le rôle exemplaire joué par les conseils d’ouvriers, de soldats et de paysans pauvres (les soviets) de 1917 jusqu’au début des années 1950 dans les républiques soviétiques : une expérience qui constitue un jalon capital pour tout ce qui concerne la dialectique politique de la représentation et la participation. Un essai sur la question de la démocratie participative soviétique fera l’objet d’une publication ultérieure dès que nos multiples engagements nous le permettront.
Nous nous proposons d’abord d’éclaircir quelques points théoriques avant de replacer la question qui nous occupe dans le temps de la longue durée, principalement en ce qui concerne la France.
Nous nous arrêterons ensuite sur la situation actuelle dans ce pays, en essayant de voir dans quelle mesure les différentes modalités de participation des citoyens à la Res Publica peuvent signifier une avancée humaine et sociopolitique à condition qu’elles ne se limitent pas à un consensus interclassiste et provincialiste comme les classes dominantes le souhaitent et que, au contraire, elles s’articulent sur cette ultime et insurmontable réalité qu’est la lutte des classes en régime capitaliste, comme on a pu le voir avec le récent mouvement des gilets jaunes.
Nous terminerons en montrant comment la “démocratie participative” peut devenir une arme meurtrière contre la souveraineté d’un pays lorsque l’impérialisme s’en empare, lorsqu’il la manipule et la finance. À cet égard, nous commenterons brièvement la récente tentative de coup d’état au Nicaragua [1].
I
En France, les notions de “démocratie représentative, participative, délibérative, d’opinion, consultative, consultative, directe, populaire…” sont en vogue aujourd’hui. Depuis de nombreuses années, avec une accélération remarquable de 1968 à nos jours, elles ont donné lieu à une avalanche de commentaires, de controverses, de proclamations, de manifestes, d’ouvrages, d’essais ou de thèses qui rendent problématique toute tentative d’offrir un panorama général sur ces sujets. D’autre part, ces discours vont de pair avec une myriade de pratiques où interviennent non seulement les gens que l’on dit ordinaires, mais aussi des sociologues, des politiciens, divers organismes gouvernementaux. Ce qui signifie que ces notions sont souvent déterminés par les versions officielles qu’en donne la classe dominante. En particulier, il en résulte un caractère largement indéfini de l’idée de démocratie participative comme beaucoup de ceux qui se sont penchés sur la question l’ont déjà observé.
Bien sûr, on ne peut mettre entre parenthèses ce que nous appellerons les démocraties participatives de la convivialité, la prolifération d’associations qui ont un lien très lointain avec les luttes sociopolitiques et qui se consacrent exclusivement à des activités culinaires, sportives, artistiques, touristiques, folkloriques, etc. Inutile de dire que nous n’avons nullement l’intention de sous-estimer la façon dont les gens organisent les hauts et les bas de leur existence, les mille et un intérêts de leur vie quotidienne.
Mais si l’on laisse de côté ces formes conviviales qui n’ont rien à voir avec la démocratie participative au sens politique du terme, sinon marginalement et par un abus de langage, il est possible de distinguer des motifs récurrents qui acquièrent une validité toujours plus grande. Parmi ceux-ci, se détache celui de la crise actuelle de légitimité d’une démocratie représentative, au bord de la faillite. Celle-ci, à son tour, se confond avec d’autres crises : crise parlementaire, crise des élites sociopolitiques, crise d’une souveraineté nationale de plus en plus aliénée à une Union européenne ultraréactionnaire, attachée aux canons du pire du néolibéralisme et, comme si cela ne suffisait pas, étroitement dépendante de l’impérialisme américain du fait de ses relations étroites avec l’OTAN. Ces crises se projettent – consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement et à travers des médiations complexes – sur la vie concrète des citoyens qui se sentent privés de tout accès aux décisions qui affectent leur vie quotidienne.
Face à une telle situation, une partie de la population, la classe moyenne supérieure avant tout, s’est tournée vers ce qu’on appelle les nouveaux mouvements sociaux dont la mission serait de contribuer à la construction d’une société postmatérialiste (post-industrielle, post-consommation, post-patriarcale…) qui pourrait ignorer le capitalisme impérialiste ou, du moins, trouver un refuge sur ses marges, dans une sorte de coexistence plus ou moins pacifique qui mettrait entre parenthèses le affrontements de classes.
Selon cette conception, la démocratie participative devrait être organisée sur la base de relations interpersonnelles entre les travailleurs, les patrons, les employés, les notables de province, la bourgeoisie riche mais progressiste”, les chômeurs, la crème des professions libérales, les immigrés vivant dans des banlieues dites “défavorisées”, les paysans ayant un revenu inférieur au SMIC, les spécialistes des médias, les amateurs de tout type de divertissement… Bien sûr, tous ces gens, dans cette vision multi-classiste de la démocratie participative, seraient invités à déposer les armes de la lutte des classes.
C’est dans ce sens, par exemple, que de nombreuses plates-formes en ligne se développent pour un grand nombre d’utilisateurs. Nombre d’entre elles se spécialisent dans l’organisation de débats, dans le vote de propositions en temps réel, par le biais des nouvelles techniques de communication : ordinateurs, dispositifs cellulaires… Leurs projets sont présentés comme des laboratoires démocratiques où tous les citoyens sont censés prendre une part active et saine à la vie publique ; ceci sans que le sang ne coule jusqu’au fleuve, c’est-à-dire dans le respect d’une règle consensuelle où les interlocuteurs échangent pacifiquement et amicalement des avis et des propositions mais où il serait du dernier mauvais goût de mettre en cause les fondements sur lesquels repose la domination du grand capital. Voir par exemple le néolibéralisme du site social-démocrate « Rue 89 », appendice du Nouvel Observateur, où “rue” est un endroit où « on aime bien être » et où 89 est un « chiffre plein de valeur », car « c’est la liberté, c’est la chute du mur [de Berlin] » »[2]
Ces mécanismes de communication soi-disant “directe”, en plus d’être une garantie pour la survie pacifique de la grande bourgeoisie, ont souvent des objectifs essentiellement mercantiles. À cet égard, on a pu parler d’un marché de la démocratie participative, d’une ingénierie de la « participation en kit »[3] fonctionnant sur le modèle du conseil en management.
Il n’est pas surprenant que des universitaires et des commentateurs proches du réformisme de type social-démocrate, social-libertaire ou libertaire applaudissent ces initiatives. En général, ce que l’on cherche, c’est un renouvellement anodin de la démocratie bourgeoise, que ce soit dans le domaine de l’environnement, à travers des études émergentes sur les questions de genre, ou encore par le biais de problèmes liés aux minorités ethniques, sexuelles ou sociales. D’autre part, les classes dirigeantes, la bourgeoisie bohème, les “bobos”, les médias aux ordres, l’officialisme[4] intellectuel et académique, sont beaucoup plus réticents envers les formes de démocratie participative qui tendent à affronter directement le pouvoir politique. De telles appréhensions peuvent se transformer en haine pure et simple, ainsi qu’on a pu le constater lors des grandes grèves en France en 1995[5]. Il en a été de même avec la rébellion des “bonnets rouges” en Bretagne en 2013 qui, malgré plusieurs ambiguïtés et certaines intrusions de la classe patronale, traduisait souvent, à sa manière, une réelle mobilisation populaire contre une situation économique catastrophique, surtout en ce qui concerne de nombreux petits agriculteurs dont la survie tient actuellement du miracle.
Plus révélateur encore est le récent mouvement des gilets jaunes, systématiquement qualifié de “populiste”, un joker passe-partout et péjoratif qui permet de discréditer tout ce qui pourrait menacer la politique imposée par la dictature antidémocratique de l’Union européenne. D’une protestation contre la hausse des prix du carburant par le gouvernement Macron, les manifestations ont pris une ampleur qui a remis en cause l’injustice fiscale, la perte du pouvoir d’achat, la réforme des retraites.
Enfin, victimes d’une répression policière brutale, les larges fractions des gilets jaunes se sont orientées vers une stratégie de rupture avec le néolibéralisme du président Macron, exigeant sa démission et celle de ses ministres. De plus, la partie la plus avancée du mouvement, bien qu’encore minoritaire, en vient à dénoncer l’impact dévastateur de l’Union Européenne pour les classes populaire. D’où la fureur de la nébuleuse macronienne et des médias aux ordres pour qui refuser l’Europe et son élite bourgeoise donneuse d’ordre pour le compte du grand capital impérialiste, c’est illico rejoindre une horde sauvage.
A travers la rébellion des gilets jaunes, on perçoit clairement un divorce fondamental entre l’État et ses organes représentatifs, le plus souvent aux mains de la bourgeoisie, et le commun des mortels, c’est-à-dire “l’immense majorité”, comme le disait le poète espagnol Blas de Otero, qui est celle des ouvriers, des salariés, des victimes du chômage galopant, des retraités modestes, réduits à la portion congrue, des jeunes en situation de grande précarité, des paysans en situation plus que précaire qui mène certains au bord du suicide. Enfin, encore actif aujourd’hui malgré les certificats de décès répétés, le mouvement des gilets jaunes est porteur d’une rupture de classe entre une “France d’en haut” et une “France d’en bas”, ou plus exactement, entre le capitalisme et ce qu’on nomme traditionnellement le prolétariat.
Sur la base de ce constat, certains tentent d’inscrire le mouvement dans un schéma qui fonctionnerait sur la base d’antagonismes entre verticalité (c’est-à-dire partis ou syndicats) et horizontalité (c’est-à-dire des personnes sans appartenance idéologique). En d’autres termes, l’hégémonie culturelle entretenue par la classe dirigeante s’efforce d’opposer aux militants organisés des individus vêtus de vêtements fluorescents qui agiraient de manière totalement autonome et spontanée. De telles dichotomies tendent, sans aucun doute, à perpétuer le statu quo social, politique et économique. Le maintien classique de l’ordre exige une masse informe et désorganisée qui, malgré ses colères – cette “grogne” que radios et télévisions nous baillent sans trêves –, ne constituerait pas une menace vraiment inquiétante pour la classe dirigeante.
Malheureusement pour elle, ces désirs se voient contredits par la réalité de la lutte des classes. En témoigne l’appel récent des gilets jaunes pour que le mouvement rejoigne la grande mobilisation syndicale prévue pour le 5 décembre 2019. Cela montre qu’un fonctionnement démocratique populaire “à la base” n’est pas en contradiction avec un combat organisé et structuré contre cette mondialisation néolibérale que nous préférons, avec Vladimir Illitch Lénine, continuer à appeler l’impérialisme, stade suprême du capitalisme.
D’autre part, dans le vaste corpus qui traite de la démocratie participative, même lorsque ses aspects sociopolitiques sont abordés, son extension et son action sont généralement limitées au niveau local du district régional ou du petit recoin provincial. Au contraire, la démocratie représentative est considérée comme étant l’apanage de l’État et d’une caste de technocrates grassement payés, les seuls qualifiés pour intervenir au niveau régional, national ou international. Toujours selon la vulgate bourgeoise de la démocratie participative, il est tenu pour acquis que cette dernière serait vouée à ne regrouper que des citoyens n’ayant aucune compétence théorique, seulement des aptitudes utilitaristes, ce qui les empêcherait d’exercer leur influence sur des domaines tels que les grandes options concernant l’économie ou la politique internationale. Il serait donc entendu que la démocratie participative, en se concentrant sur les seuls problèmes de la vie quotidienne locale, régionale ou suburbaine, n’aura pour acteur des citoyens apolitiques, ne pouvant et ne devant avoir aucune forme d’engagement anticapitaliste ou révolutionnaire.
De tout cela émerge un autre présupposé : à savoir qu’une telle démocratie participative ne serait rien de plus qu’un palliatif, une sorte de patch pour adoucir les éventuels dysfonctionnements, l’arbitraire et autres excès autoritaires du pouvoir au service du grand capital.
II
Ceci étant dit, on ne saisirait pas la portée profonde de la vraie démocratie participative en France en tant que mouvement indissociable de la lutte des classes si on ne le réintégrait pas dans la longue durée.
Si l’on remonte l’histoire de la formation du capitalisme, on rencontre inéluctablement les principaux et les premiers penseurs du libéralisme et de la démocratie dont les œuvres coincident avec le développement des forces productives aux XVIIe et XVIIIe siècles. Or, dans leurs travaux, ceux-ci rejettent catégoriquement toute idée de démocratie directe. Aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, depuis la déclaration de leur indépendance en 1776, le programme politico-économique des premiers théoriciens du capitalisme s’écarte considérablement de l’idée de démocratie représentative au sens moderne du terme. Leurs aspirations, sans équivoque, vont vers une démocratie des élites – une contradiction dans les termes puisque le mot “démocratie” porte une idée de majorité –“dêmos” & “kratein” : le peuple, l’ensemble de citoyens [qui] gouvernent – alors qu’“élites” suppose la notion de minorité.
La préférence des pères du libéralisme va vers un gouvernement des hommes et des choses par des personnalités éclairées qui seraient les seules capables d’appliquer la grande loi de leurs théories économiques, le sacro-saint principe de la libre concurrence : « laissez faire, laissez passer ». Si les philosophes anglais du XVIIe siècle, John Locke ou James Harrington, sont souvent considérés comme des précurseurs pour la proposition d’une démocratie sévèrement limitée, entièrement acquise aux intérêts de la classe des riches privilégiés, c’est sans doute Montesquieu qui, dans un texte célèbre de 1748, s’exprime le plus explicitement sur le fondement nécessairement antipopulaire de son idéal “(anti)démocratique. En effet, la démocratie parfaite, selon lui, est par essence et par nature, absolument contraire à toute idée d’ingérence du vulgum pecus, c.-à-d. de ceux qui ne possèdent pas, dans les affaires de l’État :
Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie (…).Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir, en général, si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres[6]
Aux XVIIIe et XIXe siècles, les disciples de Montesquieu affirment que l’intervention du peuple dans les affaires de l’État équivaudrait à introduire le loup dans la bergerie ou, ce qui revient au même, à transformer le vil troupeau en une meute d’animaux féroces. C’est pourquoi les honnêtes gens, les gens de bien, en d’autres termes ceux qui ont des biens, qui possèdent, ne devraient pas offrir le pouvoir à des masses ignorantes, incapables de prendre sagement les décisions qui affectent la Res Publica.
Or, on sait aussi que ces discours, qui annoncent l’avènement d’une nouvelle aristocratie bourgeoise après la chute du Grand Comité du Salut public en 1794, ont été principalement contredits par l’idéologie politique de Jean-Jacques Rousseau.
En fait, Rousseau a été le premier penseur à considérer que la seule forme authentique de démocratie était celle de la démocratie directe. Dans le Contrat social, la souveraineté s’égalise à une volonté générale qui ne peut être aliénée au profit d’un groupe restreint. Le Souverain n’a le droit d’exister qu’en tant qu’entité populaire collective dans laquelle il trouve sa légitimité. Comme tel, ce dernier ne sera représenté que par lui-même[7].
Bien que le rousseauisme politique ait eu une influence énorme à la veille de la Révolution française et tout au long de son développement, ce sont ses adversaires qui triomphèrent en 1789. Parmi eux, l’abbé Siéyes, père et inspirateur d’un recensement électoral qui divisa la population en citoyens actifs, ayant accès au vote, et en citoyens passifs privés du même droit. Les “passifs” – les pauvres, les insolvables, les domestiques, les femmes – étaient exclus d’emblée du jeu démocratique. Les “actifs” étaient des hommes pouvant payer une contribution fiscale égale à trois jours de travail. Par surcroît, chez ces derniers, la plupart n’étaient que des “moins pauvres” n’ayant d’autre droit que celui d’élire une minorité de représentants fortunés. Il ne fait aucun doute que ce que l’on cherchait, c’était une mise hors la loi politique d’une partie considérable du Tiers-État. Sous les grands gestes ostentatoires qui accompagnèrent la déclaration universelle des droits de l’homme de 1789, non seulement la division entre citoyens actifs et passifs fut laissée intacte, mais aussi le régime esclavagiste dans les Antilles françaises.
De même, les déclarations ostentatoires de l’Assemblée constituante dans la nuit du 4 août de la même année en faveur de l’abandon des privilèges hérités de l’ancien régime et de l’abolition du système féodal en France, n’allèrent pas au-delà d’un « festival du mime, une mise en scène, une plaisanterie », comme le rappelle le grand historien Henri Guillemin[8].
En fait, à ce stade précoce de la révolution, on chercherait en vain la moindre trace de démocratie participative, populaire, représentative ou comme on voudra l’appeler. Ce qui s’enracine sur les ruines de la monarchie absolue, c’est tout le contraire : une Assemblée Constituante dominée par des affairistes, des spéculateurs et des boursicoteurs sans scrupules, comme les frères Lameth, Antoine Barnave, Alexandre Duport, Mirabeau, les Roland, la femme et le mari… De plus, l’imposition du nouvel ordre bourgeois peut compter, en cas d’urgence, sur des généraux comme Lafayette, dont la mission serait d’assurer un pouvoir personnel sur une monarchie.
On nous rétorquera qu’un semblant de “représentativité” semble surgir avec les premières sociétés populaires à l’automne 1989, dans les principales villes de France. Ces premiers moments de la révolution sont marqués par la création de multiples clubs. Mais, dans la plupart des cas, ceux-ci étaient aux mains de riches hommes d’affaires, de spéculateurs et, assez fréquemment, de nostalgiques de l’ancien régime. La Société de la Révolution, la Société des Amis de la Constitution (qui deviendra plus tard le Club Jacobins), ne signifièrent nullement la fin de l’exclusion de la scène révolutionnaire des segments les plus modestes de la population. Il fallait qu’ils demeurent en marge de l’échiquier politique.
Un changement intervient avec la deuxième révolution, organisée par la Commune insurrectionnelle le 10 août 1792. La trahison des députés de la Gironde et la montée en puissance dans l’Assemblée de la Convention des députés de la Montagne, c’est-à-dire du Parti de Robespierre, Saint-Just, Couthon, Jean Paul Marat et autres, sont les principaux facteurs qui permirent à la classe des artisans, de la petite bourgeoisie et à un prolétariat encore en formation de prendre en charge les affaires de la république. C’est alors, enfin, que ces classes populaires purent s’emparer des clubs pour y exercer une véritable activité participative au niveau politique, notamment au sein du club des Jacobins, purgé de ses éléments contre-révolutionnaires et aristocratiques.
Évidemment, la marche vers la démocratie participative et directe eut ses limites. Ainsi lorsque le club des cordeliers fut vaincu en mars 1794 par les robespierristes et lorsque quelques mois plus tard le Grand Comité du Salut public commença à purger toutes les sociétés populaires. De là, l’élimination des éléments les plus radicaux, les “enragés” , dont certains étaient les plus proches des masses populaires sur le chemin de la prolétarisation : chômeurs et indigents, artisans modestes, travailleurs des premières industries modernes.
Cependant, malgré les purges, Robespierre, Saint Just et leurs partisans au sein de la Convention restèrent les « authentiques représentants des forces révolutionnaire c’est-à-dire de la seule classe authentiquement révolutionnaire : la masse innombrable » (Marx, L’idéologie allemande), n’en déplaise aux sieurs François Furet, Michel Onfray et consorts. Ce furent eux qui permirent à ces sociétés de survivre et, malgré un contrôle assez sévère, de devenir une force populaire opérant dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Une force, certes encore (très) petite-bourgeoise étant donné les conditions objectives de l’époque caractérisée par une croissance des forces productives insuffisantes pour permettre la formation d’un prolétariat ouvrier organisé et conscient de ses intérêts de classe.
Avec ses propres limites, ce premier pas historique vers la démocratie participative directe s’acheva avec le coup d’Etat du 9 Thermidor (27 juillet 1794). Le club Jacobin fut définitivement fermé quelques mois plus tard, le 21 Brumaire an III (11 novembre 1794). D’autres clubs survécurent, tant mal que bien, jusqu’aux répressions sauvages contre les insurrections populaires du 14 Prairial (2 juin 1795) et leur fermeture définitive le 6 Fructidor an III (23 août 1795).
Cette année-là, Gracchus Babeuf réussit encore à créer un nouveau club, le “Club Panthéon”, où il essaya de mettre en œuvre la Constitution Robespierriste de 1793, tout en la complétant avec la perspective d’une troisième révolution à caractère social-communiste, basée sur une dictature des pauvres. Sa “Conjuration des Égaux” fut dénoncée en 1796 et Babeuf et ses compagnons furent exécutés en février de l’année suivante.
Pionniers en matière de démocratie directe et participative, les jacobins Robespierristes de la deuxième révolution française, anéantie par Buonaparte, ont inspiré tout au long de la première moitié du XIXe siècle d’autres soulèvements qui tentèrent de donner de nouvelles impulsions à la prise de contrôle des affaires publiques par un prolétariat qui émerge conjointement avec un le développement capitaliste des forces productives. Mais une révolution comme celle de 1848 ne fut qu’une brève éclaircie au milieu de la tempête réactionnaire aristocratique-bourgeoise, bientôt replongée dans une nuit sanglante par la terrible répression du général Cavaignac, au service de la clique des cléricaux et des possédants.
La même mouvement émancipateur se reproduisit avec la commune de Paris en 1871. Après avoir ouvert, durant quelques mois, un horizon décisif et toujours d’actualité concernant l’accès des classes populaires au gouvernement de la cité et de la nation, la Commune fut impitoyablement exterminée. Il convient de rappeler les centaines de milliers de communards, exécutés, mutilés, emprisonnés, déportés ou persécutés que calomnièrent, de la manière la plus abjecte, tous les écrivains de l’époque, exception faite du comportement honorable d’un Jules Valles ou d’un Victor Hugo.
Un Barbey d’Aurevilly tonne contre la « la haine inconséquente, folle et plus souvent bête de la démocratie [des communards] »[9]. Georges Sand, modèle d’émancipation des femmes selon plusieurs associations féministes, n’hésita pas à déclarer que la démocratie de la commune n’était que
[…] le résultat d’un excès de civilisation matérielle jetant son écume à la surface, un jour où la chaudière manquait de surveillant. La démocratie n’est ni plus haut ni plus bas après cette crise de vomissements [ … ]. Ce sont les saturnales de la folie[10]Zola, lui-même, hélas, on l’oublie trop souvent, lorsqu’il écrit Germinal, ne fait pas de différence entre un communard et un criminel.[11]
Dans un livre écrit quelques mois après le massacre de la commune, Renan écrit pour sa part que
L’égoïsme, source du socialisme, la jalousie, source de la démocratie, ne feront jamais qu’une société faible, incapable de résister à de puissants voisins. Une société n’est forte qu’à la condition de reconnaître le fait des supériorités naturelles, lesquelles au fond se réduisent à une seule, celle de la naissance, puisque la supériorité intellectuelle et morale n’est elle-même que la supériorité d’un germe de vie éclos dans des conditions particulièrement favorisées[12].
Quant à Adolphe Thiers, à qui l’Assemblée de Versailles a donné le titre provisoire de “Président de la République” – une assemblée qui, après le massacre de la Commune, est entièrement dominée par les monarchistes et les partisans bourgeois du grand capital – il convient de citer ici un passage essentiel d’un discours parlementaire qu’il prononce en 1872 :
Dans la monarchie, en principe du moins, c’est un seul homme qui commande. Tel quel, il est vulnérable, et l’on s’en est suffisamment apercu. Ses sujets peuvent se rebeller au nom de “la liberté”, et la force — cette ultima ratio — n’est pas garantie au souverain. En revanche, qu’est-ce que la République ? Le regime qui repose sur la volonté du peuple et ou l’autorité tire son pouvoir contraignant du fait qu’elle émane de cette “volonté nationale”, la représente, et commande en son nom. Mesurez, en conséquence […], l’incomparable avantage, quant à son ampleur et a sa légitimité, dont dispose l’autorité républicaine par rapport a l’autorité royale. Dans la réalité des choses, ce que l’on baptise volonté du peuple, c’est ce que préfère la majorité des citoyens. Et n’avez-vous pas vu, deux fois déjà, à quel point cette majorité peut nous être propice, et tout ce qu’il nous est loisible, a nous gens de bien, a nous les possédants, d’obtenir de ceux qui ne possèdent pas ? Ils nous ont plébiscites ; ils nous ont délègues par centaines au pouvoir ; et nous avons été dotés par eux de cette toute-puissance que confère le système républicain a ceux qu’a désigné la volonté nationale pour gérer les affaires de l’État. Sous la République, c’est la liberté elle-même qui règne, et toute rébellion est un attentat à la démocratie. L’avez-vous assez répété contre les criminels de la Commune ? Faisons donc la République, messieurs, une République, cela va de soi, socialement et économiquement conservatrice[13]
Il va sans dire que ces paroles sont encore d’actualité aujourd’hui, avec la circonstance aggravante d’une cinquième république dont le régime présidentiel autoritaire réussit à combiner le noyau conservateur et antidémocratique de la république de Thiers avec une restauration déguisée de l’absolutisme monarchique.
Il convient également de noter que de nombreuses personnes continuent aujourd’hui à louer les “valeurs” de cette république bâtie sur des monceaux de cadavres et qui, malgré les vicissitudes de l’histoire, aurait transmis ces mêmes “valeurs” jusqu’à nos jours (égalité démocratique des citoyens, multipartisme, laïcité…). Sans la moindre pudeur, on ferme les yeux sur les holocaustes coloniaux commis par la troisième république, sur les grèves farouchement réprimées, sur les travailleurs, les syndicalistes, les militants politiques harcelés ou emprisonnés. Qui plus est, comme on a pu le voir encore il y a peu lors des commémorations de l’armistice du 11 novembre, on met au crédit du régime républicain le crime impardonnable d’avoir envoyé des millions d’hommes périr dans un effroyable carnage durant la Première Guerre mondiale.
Une nouvelle aube démocratique et participative paraît s’ouvrir avec le Front Populaire de 1936, mais elle fut à nouveau rapidement occultée par le retour de la droite au pouvoir qui mèna la République à sa méprisable déchéance, lorsque la majorité de ses députés, après avoir proscrit les communistes, donna carte blanche au fascisme de Vichy et au maréchal Pétain.
L’espoir renaît lorsque l’action des mouvements de résistance, notamment les FTP, conduit au programme du Conseil national de la Résistance en 1944, ouvrant ainsi la voie à une Quatrième République où travailleurs et salariés acquirent la possibilité de défendre leurs intérêts de classe, que ce soit au niveau participatif, syndical ou représentatif. Mais encore une fois, ce ne fut qu’une brève parenthèse qui prend fin trois ans plus tard avec le début de la guerre froide, l’exclusion des ministres communistes et la répression impitoyable des grèves par le gouvernement Ramadier. La bourgeoisie française accepta de brader les acquis de la résistance française pour offrir ses services au maître nord-américain, aidée en cela par une énième trahison de la social-démocratie, avec.
À la suite de cette reprise en mains de la République par les forces réactionnaires, un régime parlementaire qui n’eut rien de participatif ni même de représentatif fut mis en place durant onze ans. En fait, dans les meilleurs moments des différentes législatures de la période, les députés appartenant aux classes populaires ne dépassèrent jamais les 20% de la totalité des parlementaires. Il s’agissait essentiellement de représentants d’un parti communiste systématiquement harcelé par les majorités au pouvoir, socialistes, radicales, centristes ou droitières, et en outre marginalisé au niveau des décisions et des commissions au parlement. Résultat : une Assemblée Nationale très peu “nationale” et encore moins représentative du monde du travail. Faisant un pas de plus vers la trahison, la quatrième République n’hésita pas à suivre les traces de la troisième avec de nouvelles guerres coloniales (Madagascar, Indochine, Algérie), bien que de vastes secteurs de la population manifestèrent leur refus de s’associer à ces désastreuses et criminelles aventures bellicistes.
III
Finalement, la IVe République capitula honteusement et docilement face à un nouvel assaut de la droite française : le coup d’État militaro-parlementaire du général de Gaulle en 1958.
Depuis lors, le peuple français vit sous un régime quasiment monarchique, avec un président omnipotent, un parlement aux pouvoirs très limités, sauf celui de dériver vers des questions secondaires qui ne portent pas à conséquence. La représentativité parlementaire reste particulièrement élitiste. Les 4 % de travailleurs et d’employés parmi les parlementaires de l’Assemblée Nationale de 1958 se réduisent même à 2,6 % lors des élections présidentielles françaises de 2012. Le pourcentage de 4,6% de députés ouvriers ou salariés de base qui entrent à l’Assemblé Nationale à la suite des législatives de 2017, indique que le déficit colossal de la représentation populaire se perpétue.
Cette situation déplorable s’est considérablement aggravée avec la soumission des gouvernements successifs à une Union européenne fondamentalement antidémocratique puisque la plupart de ses organes de décision, n’étant pas soumis au suffrage universel, privent le Parlement français des rares pouvoirs dont il dispose pour les transférer aux technocrates de Bruxelles.
Pour couronner le tout, les secteurs majoritaires de l’Union Européenne ne cachent plus leurs tendances néo-fascistes. En témoigne, le vote négationniste du Parlement européen le 19 septembre 2019, qui place le nazisme et le communisme sur le même plan… Cet euro-fascisme soutient l’agressivité de l’impérialisme américain. Il bénéficie de la complicité les majorités droitières ou social-démocrates qui dominent les institutions parlementaires françaises, sans que les simples citoyens n’aient, bien sûr, leur mot à dire. Sans honte ni pudeur, elles se font les relais des agressions de l’Oncle Sam aussi bien lors du putsch fasciste en Ukraine qu’à l’occasion des coups tordus et des guerres de “basse intensité” contre les gouvernements progressistes en Amérique Latine (golpes contre le Nicaragua sandiniste, le Venezuela Bolivarien et tout récemment contre le gouvernement légitime d’Evo Morales). On se souvient que le président Macron et de nombreux autres gouvernements de l’Union européenne ont rompu leurs relations diplomatiques avec le gouvernement légitime de Nicolas Maduro lors du coup d’État au début de 2019 après s’être précipités pour reconnaître le président fantoche du Venezuela, Juan Guaidó, que le département d’État américain a tenté d’installer, sans grand succès d’ailleurs.
Actuellement, en ce qui concerne la France plus spécifiquement, la gestion politique bourgeoise des quartiers populaires, ainsi que les misérables remèdes participatifs proposés par les experts proches des partis ultra-libéraux au pouvoir depuis près d’un demi-siècle, ont toujours été marqués par une forme de paternalisme. En guise de “démocratie participative”, les partis inféodés au grand capital n’offrent aux citoyens qu’une participation minimale et fallacieuse à la prise des décisions politiques. Il en va de même pour l’introduction dans les quartiers du concept nébuleux d’empowerment. Dans les mains de la grande bourgeoisie, la démocratie participative devient une escroquerie linguistique et idéologique. Elle ne vise qu’à garantir les votes et la paix sociale, sans renoncer à une politique réactionnaire antipopulaire avec des tendances fascistes, sans céder même un millimètre de ce qu’il leur reste de pouvoir en raison de leur situation de dépendance qui les fait se soumettre aux diktats de l’impérialisme américain et de sa succursale européenne.
Ce n’est pas un hasard si la bourgeoisie capitaliste française met tout en œuvre pour faire disparaître les communes, lesquelles sont essentielles pour le plein développement d’une démocratie participative et représentative qui ne réduise pas à une mystification. Héritière de la révolution française, la commune est aujourd’hui la cible d’agressions continues tendant à les absorber dans des instances supra-municipales, les communautés de communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) où elles perdent leur autonomie. À terme, la commune finit par être englobée et disparaître dans la Région qui, à son tour, établit des partenariats transfrontaliers avec d’autres Régions, l’ensemble étant chapeauté par les instances d’une Union Européenne désireuse régenter seule l’avenir des peuples et des nations qu’elle tient sous sa coupe, ceci pour mieux imposer sa politique de liquidation des services publics, de privatisations tous azimuts, de propagande fascisante et de contrôle strict sur la vie ordinaire des citoyens.
Le slogan euro-capitaliste à la mode est de “rassembler”, “agglomérer”, et peu importe si ce seront les communes les plus riches, celles des classes privilégiées, qui imposeront leur loi. Avec l’ingérence accélérée de l’Union européenne antidémocratique et la complicité servile du capitalisme français, l’espoir d’une participation communale véritablement populaire s’éloigne, la souveraineté des travailleurs et des couches populaires s’évanouit dans tous les domaines, aussi bien celui de leur vie quotidienne et locale que ceux ayant une portée nationale : éducation, préservation de l’environnement, capacité à faire entendre, au niveau gouvernemental, la voix des ouvriers, des employés, des travailleurs agricoles, des retraités et des jeunes…
Pour les ”mandataires” du grand capital transnational, la commune est un obstacle : il faut lui “serrer la vis” comme on le fait avec les classes populaires qui, à l’exception des municipales, s’éloignent de plus en plus des autres scrutins, se méfiant d’une domination du grand capital, unique sous ses multiples travestissements et toujours à lui-même pareil. Qu’il prenne les costumes de l’extrême droite, de la droite ou de la fausse gauche, les classes populaires se lassent des doubles jeux, des mensonges, des reniements de ces caméléons qui se proclament leurs représentants.
Selon l’idéologie dominante, le monde du travail souffre d’un syndrome inquiétant : celui du fameux “populisme”, une pathologie qui sert à tout et, d’abord, à mettre aux oubliettes toute critique du modèle ultra-libéral. Tout au plus, les classes bourgeoises au pouvoir tolèrent un questionnement très modéré de certaines de leurs options antipopulaires, auquel elles se gardent de donner suite. En revanche, elles se montrent intransigeantes sur ce qu’elles considèrent comme leur chasse gardée : le peu qu’elles conservent de ce que furent dans le passé les espaces régaliens du pouvoir et qui sont chaque fois davantage transférés à l’Union européenne (grandes orientations économiques, diplomatie, monnaie, armée).
C’est dans la même logique qu’elles s’opposent à l’exigence d’un référendum d’initiative populaire (RIC) pour une nouvelle “république sociale, fraternelle et souveraine” : une aspiration croissante qui s’inscrit cette fois dans une réelle perspective de démocratie participative et directe[14].
En France, la demande du RIC fait chaque semaine son chemin chez une frange non négligeable des gilets jaunes et dans les secteurs les plus combatifs du mouvement syndical. La revendication du RIC reflète l’intensification de la lutte des classes en France, au grand mécontentement de tous les groupes, associations, partis, médias qui agissent en véritables chiens de garde de l’ordre établi. De même, la volonté de créer de nouvelles institutions qui garantissent la viabilité d’une république démocratique, pacifique et sociale a un contenu de classe incontestable. Les projets d’une démocratie véritablement participative se répandent au fil des manifestations (gilets jaunes, personnel hospitalier, travailleurs des transports, nombreuses sections syndicales de la CGT et de Sud…) pour la mise en œuvre de mesures concrètes : augmentation des salaires, des pensions, indemnisation des chômeurs, rétablissement de la santé gratuite… En même temps, l’idée d’imposer largement le grand capital, l’expatriation fiscale, les grandes fortunes fait son chemin. “Faire payer les riches” n’a rien d’un consensus démagogique comme tentent de le faire croire l’Institut Montaigne et une kyrielle de think tanks qui barbotent dans l’optimisation fiscale pour milliardaires au nom de la “bonne gouvernance”. C’est au contraire une absolue nécessité pour reconstruire les services publics mis en piteux état par la politique euro-libérale qui gouverne les destins de ce pays depuis près de 70 ans.
La démocratie participative conçue dans ce sens aura la possibilité d’intervenir efficacement dans tous les secteurs, qu’ils soient sociaux, économiques, institutionnels et même dans celui d’une politique étrangère de paix, de coopération entre les nations. Une authentique démocratie participative devra aussi lutter contre les menaces fascistes et néofascistes qui prennent des proportions inquiétantes dans presque tous les pays de l’Union européenne et, bien sûr, aux États-Unis avec ses satellites sud-américains (type Bolsonaro au Brésil, Iván Duque en Colombie, Luis Fernando Camacho le milliardaire néo-nazi qui a été l’éminence grise du récent coup d’Etat en Bolivie et qui a installé Jeannine Áñez, une “présidente” raciste et autoproclamée, hors de toute légalité).
Une véritable participation populaire ne peut se satisfaire d’un erzatz, d’un succédané de référendum baptisé “populaire”, bricolé à la hâte et recroquevillé sur quelques réformes pseudo “sociétales” (à quand un “référendum ” pour ou contre le foie gras et les marrons glacés….). De jour en jour, les classes ouvrières et salariées se tournent vers une démocratie sinon révolutionnaire, du moins déjà en rupture avec l’ultra-libéralisme imposé par le grand capital, notamment financier. Elle seule permettra de rompre avec les dénis de démocratie. Tel celui du référendum sur le traité de Maastricht en 1992, qui a pris force de loi malgré l’abstention de 30% des inscrits et 49% des voix négatives. D’où une consultation aussi importante – on devrait dire aussi négative –, non seulement pour ce qui est des grandes options internationales mais aussi pour ce qui a trait à la vie journalière des individus, qui n’a été approuvée que par 21% de la population française, et ce, après un intense matraquage dans les médias en faveur d’un vote positif.
En 2005, encore une fois, tous les discours, débats, tables rondes… prônant la démocratie participative et même de la démocratie représentative ont été balayés lorsque 55% des électeurs ont rejeté le projet de Traité constitutionnel de l’Union européenne. La volonté populaire a été ignorée et trahie avec le traité de Lisbonne signé en 2007 par Jacques Chirac et Lionel Jospin, le leader socialiste, qui a bénéficié de l’abstention massive des députés de son parti lors de la ratification du traité.
La forfaiture de 2007 s’inscrit dans cette lutte des classes que d’aucuns considèrent comme un reste archaïque qui serait la maladie honteuse d’une plèbe tour à tour ignorante, haineuse, incompétente, “complotiste”, rancunière, intolérante…Un troupeau d’ânes qui aurait donc bien besoin de recevoir quelques bonnes leçons de comportement “démocratique”. Or c’est bien une claire manifestation de l’essence profondément démocratique de la lutte des classes qui ressort des 74% des travailleurs de l’industrie et des 62% de salariés ayant voté contre le contenu du référendum sur le traité alors qu’environ 60% des cadres supérieurs des entreprises et des professions libérales se sont prononcés en faveur du oui.
Un autre exemple serait celui des élections législatives de 2017 où le parti de Macron (LREM) a monopolisé 80% des sièges à l’Assemblée nationale, tandis que 56% des électeurs se sont abstenus d’aller voter. Résultat : une assemblée nationale où, malgré une présence féminine accrue, il n’y a pas un seul représentant de la classe ouvrière, homme ou femme, et, a contrario, une représentation pantagruélique de la haute bourgeoisie et des classes supérieures.
Tout cela, met en évidence un système représentatif caractérisé par la quasi-absence du monde du travail qui constitue 90% de la population active en France.
Quant à la démocratie participative proprement dite, comment jeter un voile pudique sur le traitement que lui a réservé la bourgeoisie macronienne lors de la répression féroce qui s’est abattue sur les gilets jaunes ? Le bilan est connu : des centaines de blessés graves, des milliers d’arrestations par la police, plus de cinq cents personnes emprisonnées et le vote de lois liberticides pour empêcher la répétition de mouvements similaires. La seule compensation, presque une aumône, qui a été offerte aux manifestations populaires de cette année et de l’année dernière, a été un “Grand Débat” dont rien n’est sorti si ce n’est un entêtement à poursuivre dans la voie de la “casse” néolibérale. On a joué une mauvaise pièce aux citoyens, un mauvais vaudeville dont le verbiage n’a convaincu personne. “Relookées” sous la rubrique “Réformes”, les brutales attaques, déjà en cours ou annoncées, contre des acquis sociaux durement conquis depuis des générations ont été écartées du “grand débat” et n’ont jamais été remis en cause. Tout était prévu d’avance avec la publication de la lettre présidentielle du 13 janvier 2019 pour donner l’impression, comme dans le Guépard, le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que tout allait changer alors que Macron, fondé de pouvoir du grand capital et de son personnel de confiance, faisait tout pour que rien ne change[15].
Le 16 janvier 2019, Alice Mazeaud, une chercheuse universitaire qui est apparemment loin de partager les objectifs de l’avant-garde syndicale (une grande partie de la CGT, du Sud…) ou des secteurs les plus clairvoyants des gilets jaunes, a publié dans le journal Le Monde un article intitulé « Grand débat national, les pièges de l’improvisation ». Dans son texte, elle analyse cette consultation qualifiée de “populaire” en soulignant sa tonalité très généraliste et la profusion des sujets à débattre.
Le “grand” débat de Macron, écrit encore Alice Mazeaud, s’inscrit dans une volonté d’encadrer et de contrôler les revendications populaires afin de sortir vainqueur de la crise. En fait, le “grand” débat n’est qu’une énième tentative de la part de la droite, de la fausse gauche et des médias gouvernementaux depuis les années 1960 pour canaliser et neutraliser les protestations. En d’autres termes, il s’agit d’un “déjà vu” dont la tactique s’énonce en quatre points.
D’abord, c’est le gouvernement qui prend l’initiative du “grand” débat comme s’il était le seul à avoir la légitimité pour l’organiser.
Ensuite, on annonce que participeront aux discussions une multitude d’associations, de personnalités “qualifiées”, de groupes proches des intérêts patronaux, de syndicats dits “réformistes”, de groupuscules spécialisés dans la propagande néolibérale. En fait, il s’agit, comme on dit, de noyer le poisson contestataire dans un vaste marécage d’où il ne pourra en aucun cas sortir. Au final, on proclamera urbi et orbi que les rebelles vêtus de jaune ou de rouge ne représentent qu’une infime minorité.
Troisièmement, malgré l’annonce d’un large éventail de questions, ne sont acceptées que celles qui s’inscrivent dans un espace de tolérance accordé par le pouvoir et les institutions qu’il contrôle.
Un quatrième et dernier moment intervient lorsqu’on présente le bilan des discussions sur les “réformes”. On apprend alors que les concessions se réduisent au mieux à modifier dans un avenir indéfini certaines situations problématiques ou intolérables qui font l’objet de rejets consensuels et qui n’affectent que tangentiellement les intérêts des grands groupes financiers et des grandes entreprises capitalistes. Dans les pire des cas, qui sont les plus fréquents, les réformes qui ont provoqué les protestations sont purement et simplement reprises en octroyant, pour seule consolation, de prétendue améliorations pour certains secteurs qui se réduisent à “déshabiller Paul pour habiller Pierre”. Chez les princes qui nous gouvernent, on ne saurait enfreindre le onzième commandement de la Bible européenne : tu ne donneras aux pauvres que ce qui est autorisé par la règle inviolable du “budget constant”.
Ainsi s’installe un espace de bavardage et de palabres insipides, étroitement délimité, dans lequel aucune des “réformes”, déjà adoptées ou en cours d’adoption, n’est discutée. Pas de réflexion sur la possibilité pour la France de sortir d’une Union européenne qui glisse toujours plus vers l’extrême droite. Pas de débat sur son intégration dans une OTAN, particulièrement belliciste. Un silence assourdissant sur les 11.000 soldats français présents en Afrique. Rien sur la politique néocoloniale du gouvernement et des gouvernements précédents concernant ce continent (mais aussi les Dom‑Tom), politique qui est la cause principale d’une paupérisation qui s’étend de jour en jour, avec ses conséquences dramatiques pour des populations qui ne trouvent souvent d’autre remède qu’une émigration contrainte, dangereuse et chaotique. Interdit de parler de l’imposition désastreuse du franc CFA dans de nombreux pays de la Francophonie africaine afin de perpétuer la politique bien connue de la France-Afrique héritée de feu Jacques Foccart, un homme de l’ombre qui ne repose pas en paix.
IV
Parlant de démocratie participative, nous voudrions terminer en rappelant brièvement à quel point l’impérialisme peut s’en emparer pour fomenter des déstabilisations et des coups d’État dans des pays qui sont déterminés à défendre leur souveraineté. On prendra ici l’exemple du Nicaragua où des “protestations” en avril 2018 ont donné lieu à une tentative de coup d’État, avec l’objectif avoué de mettre fin au gouvernement légitime des Sandinistes et de Daniel Ortega, malgré leurs succès électoraux en 2006, 2011 et 2016[16].
On ne reviendra pas sur les circonstances qui ont servi de prétexte à l’offensive anti-sandiniste, en particulier la réforme des services médicaux et une réduction de 5% des pensions, motivée par un déficit croissant du budget de la santé. Il ne fait aucun doute que ce fut une erreur, mais une erreur minime, car Daniel Ortega venait de rejeter des mesures beaucoup plus drastiques recommandées par le FMI. En fait, le gouvernement sandiniste mettait principalement à contribution les hommes d’affaires les plus riches du pays pour rétablir un bon état des comptes publics. Le fait que Daniel Ortega ait rapidement annulé la réforme n’a pas empêché d’innombrables organisations, se revendiquant de la “ société civile” et se présentant comme les champions de la démocratie participative au Nicaragua, de se lancer à l’abordage du gouvernement pour tenter de renverser une fois pour toutes le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN).
Le coup d’État fut préparé par les filles et les fils à papas de l’Université Centraméricaine (jésuite) et de l’Université Polytechnique du Nicaragua (baptiste). Ce sont ces étudiants, issus de la grande et moyenne bourgeoisie nicaraguayenne qui, les premiers, lancèrent une série de manifestations très violentes « en solidarité avec leurs aînés » ( !). Obéissant à des consignes venant directement des États-Unis et de son ambassade à Managua, ces rejetons des classes les plus aisées de la société nicaraguayenne rassemblèrent es milliers de manifestants qui appartenaient également à une bourgeoisie désireuse de récupérer son hégémonie perdue lors du triomphe du FSLN en 1979 et de son retour au pouvoir en 2006 après la défaite électorale de 1990 et une longue absence dans l’opposition.
Rapidement, les “protestations” prirent une tournure excessivement violente et criminelle. Il y eut des incendies de magasins et de supermarchés. De nombreux tranques, c’est-à-dire des barrages de rues et d’autoroutes, devinrent des pièges mortels pour les voitures, les camions ou les passants qui refusaient de hurler avec les loups et de faire le coup de feu contre les sandinistes. De nombreux actes de vandalisme furent commis, contre les locaux du Front et ses militants dont plusieurs furent même mis à mort ou brûlés vifs. D’où les mesures prises par les sandinistes visant à mettre fin au coup d’Etat contre-révolutionnaire. Les militants du FSLN s’organisèrent pour résister aux assauts des groupes néo-fascistes. Aux côtés de la police anti-émeute, ils durent faire face aux putschistes et à leur violence extrême.
Comme il fallait s’y attendre, les antisandinistes entamèrent une guerre de (dés)informations. Ils se précipitèrent auprès des médias locaux et étrangers pour accuser les autorités légitimes des crimes les plus horribles. Certains allèrent jusqu’à parler de « génocide » ( !!!!!) sans tenir compte des terribles agressions subies par ceux qui décidèrent de rester fidèles aux idéaux sandinistes, idéaux que le gouvernement de Daniel Ortega avait maintenu et maintenait au milieu d’innombrables difficultés.
Toute cette violence antisandiniste était préparée, justifiée par de nombreuses organisations nationales issues des différents horizons de la fausse gauche. Parmi eux se trouvaient des groupes créés pour promouvoir la démocratie – la démocratie made in USA – comme la fondation Hagamos Democracia (Faisons la Démocratie), dont le titre est en soi ressemble à une mauvaise plaisanterie, le Nicaraguan Center for Human Rights, le groupe Fundemos, l’Association nicaraguayenne pour les droits humains, la Commission permanente des droits de l’homme (CPDH), le Centre des droits constitutionnels (CDC), l’Institut pour le développement et la démocratie (IPADE), le Réseau nicaraguayen pour la démocratie et le développement local, la Fondation Rubén Darío pour le développement humain, le Groupe Civique Éthique Et Transparence….
Une autre fondation importante qui ouvrit la voie au coup d’Etat d’avril, heureusement déjoué, est celle créée par Violeta Barrios de Chamorro, l’ancienne présidente du Nicaragua, sous prétexte de « travailler pour la défense et la consolidation de la liberté d’expression et d’information » et pour « le développement social et l’exercice des valeurs démocratiques ».
Tous ont été rejoints par les médias d’opposition nicaraguayens (journaux et médias comme La Prensa et El Confidencial, Grupo Radial Romance…) en collaboration avec des organisations prétendant défendre la pluralité de l’information, tel l’important Centre d’information et de communication (CINCO) ou le Centre des programmes de communication (CPC).
Le coup d’Etat antisandiniste fut également été préparé par certains groupes féministes, tel le Mouvement Des Femmes Autonomes (MAM) et du Parti de la gauche érotique (PIE), par les groupes LGBT du Sexual Diversity Branch Network. Plusieurs organisations étudiantes et de nombreux jeunes de la bourgeoisie et de la classe moyenne furent également été embrigadés dans la croisade putschiste antisandiniste : le Réseau nicaraguayen de la jeunesse, la Jeunesse pour la démocratie au Nicaragua (JUDENIC), la Fondation de la Jeunesse Pour Le Développement Socio-Économique, le groupe Nouvelle génération. Le secteur de l’environnement ou de la santé a également participé à plusieurs entreprises de désinformation visant à discréditer le mouvement sandiniste, parmi lequel se distinguèrent : l’Association pour la survie et le développement local, la Fondation Jinotegana pour le développement durable ou le Center for Information and Advice on Health Services (CISAS), l’Association for Survival and Local Development (ASODEL). De même, les milieux académiques para-académiques furent infiltrés : l’Institut d’études Stratégiques et de Politiques Publiques (IEEPP), le Centre d’Analyse Socioculturelle de l’Université d’Amérique Centrale (CAS – UCA).
Il faudrait encore évoquer les nombreuses églises baptistes, les groupes évangéliques plus ou moins ouvertement liés aux services déstabilisateurs de Washington (Centre Œcuménique Antonio Valdivieso, l’Association Religieuse de l’Eglise Pentecôtiste du Nom de Jésus Christ du Nicaragua…).
La guerre de basse intensité déclenchée contre le gouvernement sandiniste pouvait compter sur la participation active et agressive de l’épiscopat et des prêtres catholiques à l’occasion d’actes subversifs : églises utilisées comme arsenaux, évêques et prêtres appelant du haut de leurs chaires à la rébellion et la mort des “diables sandinistes”. D’importantes fractions de l’église nicaraguayenne jetèrent par-dessus bord le message de paix évangélique. Un Silvio Báez, évêque auxiliaire de Managua ou un Abelardo Mata, évêque du diocèse d’Estelí n’hésitèrent pas à inciter à la pire des violences contre les Sandinistes et à faire appel à l’intervention directe des États-Unis dans le pays. Dans un tweet du 31 mai 2018, un autre curé de “choc” et prêt à prendre les armes (de armas tomar comme dirait l’espagnol), Rolando José Álvarez, évêque de Matagalpa, fit l’éloge du coup d’état antisandiniste dans un style qui n’avait rien à envier à celui de l’époque des plus sinistre de l’Inquisition, avec une rhétorique empruntée à celle des fascistes de l’époque de Franco : « Nous ne luttons pas contre des forces humaines. C’est contre les forces du mal que nous combattons. Va-t’en Lucifer, retourne aux abîmes infernaux où se trouve ta place. Vive le Christ Roi » ( !)[17].
Énumérer tous ces groupes contre-révolutionnaires nicaraguayens, déguisés en défenseurs des droits de la soi-disant « société civile » mais financés et contrôlés par la CIA à travers sa couverture civile, la NED, et ses branches du NDI et de l’IRI[18] serait une histoire sans fin. L’action de ce loups déguisés en moutons, leurs relations avec l’impérialisme n’ont plus besoin d’être démontrées depuis que Wilileaks a rendu publiques un nombre considérable d’informations provenant des communications entre la Maison Blanche ou le Département d’Etat et les ambassades des États-Unis au Nicaragua, au Venezuela, en Bolivie et dans tous les pays de l’Amérique Latine (« Notre Amérique », disait José Martí).
Toutes ces cinquièmes colonnes et ces groupes subversifs reçurent des renforts non seulement de l’oligarchie nicaraguayenne, mais aussi d’anciens commandants dissidents et renégats du FSLN, qui avaient déjà retourné leurs vestes pour revêtir les habits de la droite réactionnaire après l’échec électoral du FSLN et la victoire de Violeta Barrios de Chamorro et de l’extrême droite en 1990. L’action infâme du Secrétaire général de l’OEA, l’Uruguayen Luis Almagro, totalement subordonné au Département d’État américain, a également favorisé, sans la moindre vergogne, la tentative de coup d’État commanditée par les États-Unis et les élites nicaraguayennes converties à un néolibéralisme ouvertement déclaré. Ils purent en outre compter sur le soutien de plusieurs de leurs homologues occidentaux, d’une grande partie du monde académique et de l’“intelligentsia” du monde dit “libre” et, bien sûr, de l’immense appareil médiatique qui dirige l’impérialiste au niveau mondial.
En conclusion : le récent coup d’Etat de 2018 au Nicaragua, heureusement avorté, est un exemple particulièrement riche d’enseignements sur la manière avec laquelle l’impérialisme américain et ses satellites tentent de s’approprier les multiples formes de démocratie participative (ONG, organisations de la société civile…), en les créant de toutes pièces ou en les transformant dans le but de renverser des gouvernements progressistes et révolutionnaires afin d’en finir avec leur souveraineté, de les remplacer par des régimes de pantins, des marionnettes entièrement à leur service.
Daniel Vives Simorra