L’Atelier paysan, « Reprendre la terre aux machines »
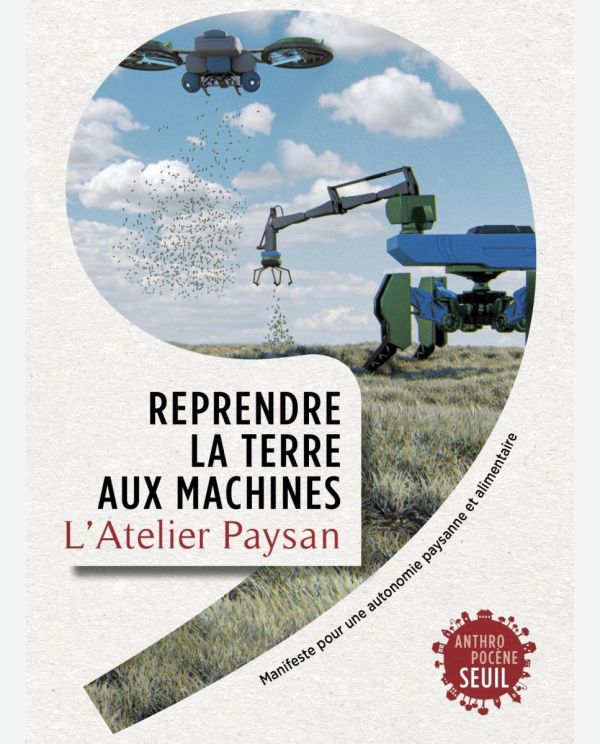
Version imprimable de Reprendre la terre aux machines
L’Atelier paysan
Reprendre la terre aux machines
(Extrait du chapitre 2 : Les ingrédients d’un verrouillage)
Le complexe agro-industriel…
Ces difficultés sont à la mesure des organisations qui dominent depuis plusieurs décennies les exploitants agricoles soi-disant indépendants, clients ou fournisseurs captifs de ces géants. On parle communément de complexe militaro-industriel, en premier lieu aux États-Unis, pour désigner l’ensemble formé par les industries de l’armement, l’armée elle-même, et les décideurs publics qui promeuvent les intérêts des deux premières. Il paraît justifié de parler dans les mêmes termes d’un complexe agro-industriel à propos des industries de l’agroalimentaire, de la grande distribution, des engrais, pesticides et semences, des machines agricoles ; des banques ; des organisations syndicales dont les figures dirigeantes sont de gros exploitants et des décideurs publics (ministres, hauts fonctionnaires, organisations internationales) qui promeuvent l’intérêt de ces industries et des agriculteurs les plus prospères.
Rappelons d’abord l’asymétrie de taille et de pouvoir entre un exploitant agricole ordinaire, en France de nos jours, et les entreprises dont il est généralement dépendant. Cinq acteurs majeurs dominent le marché mondial de l’agroéquipement : John Deere, CNH Industrial (avec les marques New Holland, CASE IH, STeyr, IVECO, Unie, Magirus), Kubota, AGCO (Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Valtra) et Claas. Ces géants représentent environ 60 % d’un marché mondial estimé à 131 milliards de dollars en 2016. Même logique oligopolistique dans le secteur des semences : cinq groupes contrôlent les deux tiers d’un marché mondial de près de 40 milliards de dollars (1), après les rachats-fusions des dernières années. Après l’absorption de Syngenta par ChemChina, le mariage de Dow Chemical et DuPont (donnant naissance à Corteva Agrisciences), l’acquisition de Monsanto par Bayer, amenant ce dernier groupe à céder son activité semences à BASF, le Français Vilmorin fait figure de challenger dans ce quintette. Cette concentration concerne aussi l’agrochimie, où Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, FMC et BASF s’approprient les deux tiers du marché mondial des pesticides, estimé à 57,6 milliards de dollars en 2018 (2).
À l’emprise sur les agriculteurs que produit ce gigantisme économique, s’ajoute celle qui découle de la présence de ces grandes firmes à tous les stades de la production agricole et alimentaire. Le cas du mastodonte états-unien Cargill (113 milliards de chiffre d’affaires en 2019) est à cet égard caractéristique. Géant de l’aval, il domine mondialement le négoce des céréales, dont il possède une partie des infrastructures (fret, ports, stockage), c’est aussi un acteur majeur de la transformation agroalimentaire. Mais Cargill nourrit également le bétail, négocie des semences, après avoir longtemps commercialisé des engrais : c’est donc également un géant de l’amont du monde agricole. Sur ces bases, il a étendu son domaine d’activités à la « santé » et la pharmacie, à l’électricité et au gaz, ainsi qu’à la gestion des risques industriels et financiers – la boucle est bouclée (3).
En France, un groupe peu connu de l’opinion publique a acquis au tournant du XXIe siècle une envergure comparable – même si son chiffre d’affaires est bien plus modeste, « seulement » 6,2 milliards d’euros en 2017 (4). C’est la holding Avril, qui s’appelait initialement Sofiprotéol. Fondée dans les années 1980 par des producteurs français de colza et de tournesol pour s’assurer des débouchés, Sofiprotéol a progressivement étendu son activité à l’huile de palme, aux agrocarburants, à l’élevage et à la méthanisation. L’enquête dont nous tirons les éléments qui suivent décrit dans le détail comment cette pieuvre de l’agro-industrie française, de longue date premier producteur d’œufs (propriétaire de Matines) et leader français des huiles de cuisine (propriétaire de Lesieur et Puget), a pu se constituer. Sur la base d’un rapport de la Cour des comptes du début des années 2000, les journalistes de Reporterre mettent d’abord en évidence l’existence de contributions volontaires obligatoires [sic] versées par les producteurs d’oléagineux-protéagineux français à l’établissement financier qu’était initialement Sofiprotéol. Cette sorte de taxe professionnelle privée prélevée auprès des producteurs a joué un rôle important dans la capacité qu’a acquise l’entreprise à investir dans des secteurs aussi variés que la nutrition animale, les semences, les biotechnologies, « des fonds d’investissement diversifiés » (dixit la Cour des comptes) ou encore la presse (La France agricole, l’agence d’information Agra Presse et même Le Monde).
L’étape suivante fut la montée en puissance de Sofiprotéol dans les agrocarburants, par la fabrication d’un biodiesel à base de colza, le Diester. Cette production a été, en l’espace de quelques années, formidablement profitable grâce à des dispositions légales propres à la France, où Sofiprotéol était en situation de monopole sur ce marché-là : d’abord, le taux d’incorporation légal d’agrocarburant dans les carburants fossiles a été fixé à un niveau plus élevé en France qu’ailleurs (7 %) ; ensuite, l’État a défiscalisé ce carburant dont le coût de production était plus élevé – la taxe intérieure sur la consommation d’agrocarburant, payée à la pompe, était même reversée à Sofiprotéol ! Une subvention publique de 153 euros pour chaque tonne de graines de colza destinée à la production de Diester. Puis, quand la cote médiatique et financière des agrocarburants a brusquement chuté, autour de 2010, Sofiprotéol, devenu un groupe puissant, s’est reconverti, diversifié encore plus. Il s’est notamment concentré sur la production de tourteaux de colza (et de tournesol), à partir des déchets de la trituration des graines. D’où l’insistance pour mettre les éleveurs sous contrat avec les coopératives pour qu’elles leur vendent les aliments des animaux. D’où l’investissement dans les fermes-usines, à mille vaches, mille truies ou 250 000 poules. D’où, en complément, l’intérêt pour la méthanisation, car valoriser les effluents d’élevage est une des seules façons de rentabiliser les élevages géants. Comme le disent les communicants du groupe dans la préface du livre édité pour ses trente ans, « tout se tient dans une filière ».
L’enquête de Reporterre a été menée en 2014-2015, au moment où Xavier Beulin, PDG du groupe rebaptisé Avril, était aussi président de la FNSEA (et vice-président du syndicat agricole européen Copa-Cogeca). Ce cumul de mandats venait couronner l’intense utilisation de ressources publiques et étatiques pour constituer un empire privé. Et la composition du conseil d’administration de la nouvelle holding illustre à quel point une entreprise née comme une coopérative interprofessionnelle en 1983 a pu devenir dans les années 2000 un fleuron du capitalisme français.
Que peuvent effectivement valoir les intérêts d’un éleveur breton piégé dans une filière hyperintégrée, ou d’un maraîcher provençal tentant de gagner sa vie sans utiliser de pesticides, face à ce complexe (agro)-industriel ? L’industrialisation de l’agriculture n’est pas un point de détail pour l’oligarchie au pouvoir elle est un processus économique qui crée de nouveaux oligarques.
… ses machines syndicales…
Si cette réalité écrasante n’est pas claire pour grand monde et notamment au sein du milieu agricole lui-même, la FNSEA y est pour beaucoup. La bureaucratie syndicale historique joue un rôle capital d’unification de la corporation agricole, et transfigure les clivages et les mécanismes d’exploitation pourtant manifestes.
La « Fédé » est née en mars 1945 dans l’ambiance de la Libération, marquée par le double pouvoir gaulliste et stalinien. Elle était donc initialement ouverte à des personnalités issues de la Résistance et des syndicats de salariés, ce qui certes n’avait rien d’incompatible avec le parti pris productiviste et industrialisateur. Mais dès 1950, des anciens de la Corporation paysanne de Pétain, tenants de la vieille idéologie agrarienne, entrèrent dans l’appareil et la FNSEA devint « un club de notables conservateurs, bien introduits dans les allées du pouvoir et proches du CNPF [Conseil national du patronat français, ancêtre du Medef] (5) ». Comme sous Vichy, il s’agissait d’un conservatisme fort tolérant avec le pouvoir croissant de la technocratie et nullement opposé à de profonds bouleversements économiques. L’éloge du paysan pilier de « la France éternelle des champs » y servait essentiellement de paravent à une modernisation éliminant les plus petits (ou inadaptables).
Pour être précis, la greffe moderniste sur le tronc « socialement conservateur » sera l’œuvre du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA), à la fin des années 1950 : de jeunes exploitants, issus de la Jeunesse agricole catholique (JAC, socialement progressiste), dont les leaders ont pu visiter des fermes modèles aux Pays-Bas ou aux États-Unis dans le cadre du plan Marshall, vont se poser en interlocuteurs de l’État au moment où de Gaulle reprend le pouvoir (1958). Ce sont eux qui donnent le la de la modernisation et pour longtemps, au sein de la « Fédé », que Michel Debatisse dirigera de 1966 à 1978, après avoir dirigé le CNJA. Ils donnent même le la au-delà, au sein de l’appareil d’État. On parle unanimement de cogestion, à propos de la troïka ministère de l’Agriculture-FNSEA-CNJA, formée dans les années 1960 (celles du ministère Pisani).
Le discours actuel des syndicats agricoles sur leur rôle historique suggère qu’ils ont fait ce qu’ils ont pu dans le contexte d’alors, en obtenant des compromis au bénéfice des agriculteurs. En réalité, le « contexte » c’était eux. La FNSEA et les JA n’ont jamais défendu les intérêts de tous les agriculteurs. Ils en ont organisé, avec le concours des gouvernements successifs, l’élimination progressive, tout en accompagnant de manière cynique les inévitables explosions de colère. En 1968, Debatisse déclarait à la revue Entreprise : « Les deux tiers des entreprises agricoles n’ont pas, en termes économiques, de raison d’être. Nous sommes d’accord pour réduire le nombre d’agriculteurs (6). » Cela n’empêcha pas du tout son syndicat, dont certaines directions départementales étaient proches de la base avant la scission des « Paysans Travailleurs », de soutenir les différents mouvements de protestation au sein de la profession, avant et après cette date, y compris une lutte ancrée à gauche comme celle des éleveurs du Larzac contre l’installation d’un camp militaire sur leur plateau. Plus récemment, la FNSEA, tout en soutenant la signature du Ceta (7), un traité de libre-échange permettant notamment à Lactalis de s’ouvrir le marché laitier au Canada, organisait la colère des éleveurs, pour mieux la contenir, contre les perspectives d’importation massive de viande bovine en France. La stratégie est toujours de se poser en représentant « naturel » auprès de l’État pour « négocier » des mesures apparemment protectrices, mais qui, au fond, préparent les étapes ultérieures de la purge.
Si la FNSEA parvient contre toutes les évidences à jouer ce rôle d’unificateur symbolique de la profession et de paravent du complexe agro-industriel auquel elle livre les exploitants, c’est qu’elle a modelé de façon très poussée l’environnement institutionnel de ces derniers (8). La « Fédé » contrôle encore aujourd’hui 84 des 89 chambres d’agriculture départementales. Elle est omniprésente dans les Safer, qui autorisent ou refusent les achats de terres agricoles ; dans les banques, qui accordent ou non les prêts. La FNSEA domine aussi les assurances (Groupama) ; la presse agricole ; la Mutualité sociale agricole, la Sécu des agriculteurs ; les agences de l’eau ; sans oublier les organismes de formation, l’enseignement agricole, la recherche dite publique, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des biotechnologies…
Ce pouvoir bureaucratique tentaculaire permet d’exercer une emprise à la fois financière et idéologique sur une grande partie des agriculteurs. Les enquêtes successives sur la FNSEA révèlent des prélèvements comparables à ceux qu’on a déjà mentionnés à propos de Sofiprotéol : les « cotisations volontaires obligatoires », introduites dans une loi de 1975, prélevées entre autres sur les livraisons de céréales aux coopératives ont largement contribué au train de vie des différentes composantes du syndicat. Une fois ces pratiques condamnées par la Cour des comptes et même le Tribunal de grande instance de Paris, la « Fédé » s’est empressée (en 2002) de créer une ressource complémentaire sous la forme d’un fonds nommé Provea, chargé de la « gestion prévisionnelle de l’emploi agricole » : alimenté par un prélèvement de 0,2 % sur les salaires dans l’agriculture, soit environ 10 millions d’euros par an, les trois quarts en reviennent à la FNSEA et ses satellites, le reste aux syndicats de salariés.
Cette emprise financière va de pair avec l’emprise morale qu’exerce la FNSEA sur ses administrés. Le syndicat, on l’a vu, est présent dans toutes les institutions auxquelles a affaire un exploitant agricole dans sa vie de tous les jours ; il est derrière tous les services qui lui sont rendus, gracieusement ou pas, derrière la plupart des courriers qu’il reçoit en lien avec son travail, quel que soit le logo de l’expéditeur. Le syndicat incarne la grande famille agricole. Il défend la famille à Bruxelles, aux négociations européennes ; il la défend à Paris, où il décide pour une bonne part du nom du ministre de l’Agriculture (9) ; il la défend aussi dans les médias et dans le débat d’opinion, contre toutes les « calomnies » que le reste de la société peut proférer à l’égard de la profession. Ce dernier aspect prend une importance cruciale depuis vingt ans, à mesure que le poids de l’agriculture industrielle dans la dégradation des milieux naturels et dans les problèmes de santé publique devient plus évident.
… sa machine identitaire…
Au fil des années, la stratégie de la « Fédé » autour de cet enjeu s’est affinée. On peut dire à ce stade qu’elle orchestre la rupture entre agriculteurs incompris et autres groupes sociaux : elle attise la crispation identitaire des agriculteurs « historiques », c’est-à-dire les exploitants qui ont toujours joué le jeu de la modernisation sans jamais en tirer de fruits durables et qui vivent très mal leur mise en cause dans le désastre écologique et sanitaire en cours. C’est ce qui s’est passé dans la forêt de Sivens (Tarn) en 2015, où des FDSEA de tout le Sud-Ouest ont envoyé leurs troupes, armées de bâtons, chasser les zadistes qui s’opposaient à la construction d’une retenue d’eau destinée à irriguer du maïs-semence. Et c’est ce qui se passe depuis 2019 avec la campagne nationale contre « l’agribashing », c’est-à-dire contre la critique des pratiques intensives pour leur impact sur la santé des sols, des animaux et des humains. En diffusant cette notion, la FNSEA force chez les agriculteurs la confusion entre des modes de production qu’elle a largement contribué à leur imposer et ce qu’ils sont en tant que groupe social. Elle les pousse à un conflit de nature identitaire avec le reste de la société, alors même que ce sont ses choix politiques à elle, et ceux des gouvernements depuis l’après-guerre, qui sont mis en question dans le débat public – lorsqu’ils le sont. Pour l’État, le surgissement de la notion d’« agribashing » est une aubaine. En isolant les agriculteurs, elle le préserve d’un débat démocratique potentiellement très accusateur. Alors l’État promeut cette notion et la décline très concrètement : c’est ainsi qu’est née la cellule Déméter en 2019 au sein de la Gendarmerie nationale, à l’initiative conjointe des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur. La cellule Déméter est chargée d’un traitement distinct des délits réels ou supposés subis par les agriculteurs, aussi bien à l’occasion de vols de matériel sur les fermes que d’actions militantes autour du thème agricole. Traductions institutionnelles et policières de la notion d’« agribashing », cette cellule illustre à nouveau, s’il était besoin, l’éternelle complicité de l’État et de la FNSEA dans l’instrumentalisation idéologique des agriculteurs, leur isolement social, et l’empêchement démocratique sur les questions agricoles. Et cela marche.
On prend rarement la mesure de l’humiliation ressentie par les survivants de la grande purge paysanne : que se passe-t-il dans la tête de ces enfants et petits-enfants des paysans qui s’étaient vu infliger une leçon de modernisme, il y a soixante ou soixante-dix ans ? Peut-on espérer qu’ils acceptent tranquillement la volte-face des « attentes sociétales » vis-à-vis de l’agriculture, ces quinze dernières années, compte tenu de la dévastation induite par les attentes de l’époque précédente, dans leur groupe social ? Comment s’étonner de leur défiance, quand notre société, qui se pense de moins en moins comme telle, fait porter la responsabilité des conséquences écologiques ou sanitaires des politiques productivistes aux individus qui n’en sont que les exécutants ? Comment s’en étonner quand, de surcroît, les discours environnementalistes évacuent largement les aspects économiques du problème, alors que nombre d’agriculteurs français sont réduits à une précarité financière dramatique ?
La situation leur est d’autant plus insupportable que la leçon d’aujourd’hui, comme celle d’hier, semble donnée par les mêmes urbains diplômés. La réalité est en fait plus complexe dans la mesure où, comme on l’a vu au premier chapitre, l’impulsion de la modernisation a aussi été donnée par des paysans, et sa critique est également partie de ruraux refusant le productivisme ou constatant son échec. Mais le discours typique des classes moyennes urbaines ou néorurales, qui dénoncent les conséquences du productivisme sans reconnaître ses racines sociopolitiques, nourrit le sentiment de dévalorisation. Et pousse les « agriculteurs historiques », ceux qui se perçoivent comme gardiens du monde rural, à s’identifier à ce qui les détruit : les pesticides, les grosses machines et les leaders syndicaux nationaux.
Dans ce contexte, la « Fédé » n’a donc pas trop de mal à maintenir son emprise sur ces paysans, à préempter leurs colères et à s’en prémunir. Mais cette fuite en avant sur le terrain identitaire, pendant inévitable de la fuite en avant dans l’ethnocide industriel, est un jeu dangereux qui lui échappe d’ores et déjà par endroits. Ainsi, dans le Lot-et-Garonne, où la Coordination rurale (CR (10)) lui a pris la Chambre d’agriculture en 2001, l’expression de la colère paysanne a franchi un cap dans l’affrontement tous azimuts en 2018. Le conflit a commencé à la suite d’une volte-face de l’État vécue comme une trahison : l’autorisation de creuser une retenue d’eau à Caussade (20 hectares, 220 000 m3), sur la commune de Pinel-Hauterive, avait d’abord été accordée par les services de l’État ; mais elle fut invalidée à la suite des protestations d’organisations environnementalistes auprès des ministères concernés. Le projet pouvait être amélioré et ses impacts réduits, même s’il n’impliquait pas des dégâts écologiques comparables à la retenue de Sivens. La Chambre d’agriculture et la CR47 ont alors décidé de démarrer le chantier en dépit de son illégalité. La perte des financements publics initialement obtenus serait compensée par la Chambre d’agriculture et par l’engagement des paysans de la CR eux-mêmes sur le chantier. On a alors vu des dizaines d’entre eux, durant des semaines, se relayer aux manettes de tractopelles de location et creuser leur lac, envers et contre tout.
Il faut se figurer ce qu’a pu être pour ces paysans historiques, survivants de communautés soumises, fragmentées puis décimées par soixante-dix ans de productivisme et de compétition, le fait de vivre ensemble une telle aventure. Il faut imaginer le poids de cette histoire sociale dans leur perception de l’État et la charge symbolique de ses injonctions à évacuer le chantier. La volte-face des autorités centrales sur l’autorisation de ces travaux est à leurs yeux l’expression diffuse des « attentes sociétales » erratiques et contradictoires à leur endroit, dont ils font les frais depuis l’après-guerre. Comment attendre d’eux, qu’on a contraints à remembrer leur terre et qu’on a plongés dans un bain de pesticides, qu’ils se soumettent sans broncher aux injonctions exactement contraires au nom pourtant du même « intérêt général » ? Le combat de l’État pour restaurer son autorité dans cette affaire était perdu d’avance, à moins de recourir au saut dans le vide d’une militarisation du conflit. Il a finalement fallu la menace de démission de la préfète en poste pour que Paris renonce à une fuite en avant qui se serait à coup sûr très mal terminée.
Fin février 2019, le chantier illégal n’était pas achevé quand les élections professionnelles ont eu lieu. Dans le Lot-et-Garonne, ce fut un plébiscite pour la Coordination rurale, qui passa de 43 % des suffrages en 2013 (scrutin précédent) à 60 % cette année-là, la victoire la plus massive au plan national, tous syndicats et départements confondus. Là où, dans les ministères et les journaux parisiens, on ne voulait voir que la radicalisation d’une poignée de desperados réactionnaires, on avait affaire en réalité au sursaut de tout un monde social qu’on croyait enseveli. Avec le recul, les ressorts communs de cette lutte et de celle des Gilets jaunes, exactement contemporaine, sautent aux yeux : le sentiment légitime d’une dépossession collective – de n’« être rien » –, le rejet des logiques technocratiques qui le nourrissent, le besoin de refaire communauté pour reprendre en main son destin, fût-ce symboliquement, la force et la fierté qui en découlent.
Pour autant, ces deux mouvements ne se sont pas réellement rencontrés, malgré les tentatives des Gilets jaunes et l’engagement de certains agriculteurs sur les deux fronts. C’est là, en creux, que résident les traits identitaires, séparatistes pourrait-on dire, du mouvement paysan autour du lac de Caussade, bien plus que dans le rejet de la loi commune et de décisions de justice versatiles et illisibles. Dans les années 1950 à 1970, les catégories sociales dont on retrouve les descendants sur les ronds-points en 2018-2019 avaient progressivement renoncé à leur existence politique, en échange de la garantie tacite par l’« élite » d’un accès à l’abondance matérielle nouvelle des « Trente Glorieuses ». Mais pendant ce temps-là, les paysannes et paysans devaient abandonner leur monde désigné comme arriéré et s’entre-dévorer pour répondre à l’exigence de l’époque : nourrir à vil prix cette société en mutation, soutenir économiquement sa conversion consumériste. Ce sont donc deux histoires sociales bien distinctes que cette tumultueuse année 2019 a mises en présence dans le Lot-et-Garonne. D’un côté, les catégories populaires décidées à dénoncer un compromis de dupes avec une élite dont la trahison est désormais manifeste, de l’autre, ce qu’il reste d’un monde paysan historique, sacrifié lui semble-t-il confusément au confort provisoire des premiers. « Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler ! », fut en substance la réponse qu’ils adressèrent à l’invitation des Gilets jaunes. C’est le message qu’ils avaient affiché quelques années plus tôt, au bord de leurs champs, adressant déjà les mêmes mots au gouvernement et aux automobilistes.
Ces agriculteurs-là ne comptent plus que sur eux-mêmes. Tout ce qui vient de l’extérieur est suspect de dissimuler une menace à leur encontre. Ils ne supportent pas, et on les comprend, d’être tenus pour responsables des nuisances de l’agriculture à laquelle ils ont été contraints. Nier désespérément la réalité de ces nuisances, c’est pour eux d’abord le moyen de rejeter cette inculpation injuste. C’est aussi le moyen de s’éviter l’examen rétrospectif, probablement insupportable, de la dévastation dont leur monde a été l’objet et dont de fait ils se sont rendus complices. Et c’est, enfin, résister comme ils le peuvent à l’achèvement de leur élimination, que pourrait bien dessiner l’arrivée de tous ces néopaysans « écologisants » venus des villes sous les hourras médiatiques pour les remplacer, comme l’avaient fait plus tôt les ingénieurs, les concessionnaires et les banquiers. Il est clair qu’on a là un élément de blocage moral, culturel et politique de tout premier ordre et qu’il est difficile d’imaginer un changement du modèle agricole et alimentaire qui ne cherche à défaire ce nœud identitaire.
… sa machine à segmenter l’alimentation…
D’une certaine façon, ce morcellement sociologique et culturel de l’agriculture est à l’image du morcellement de notre alimentation elle-même. Dans le jargon commercial, on désigne une offre structurée en gammes, hiérarchisée selon la « qualité » et le prix, par la notion de segmentation.
L’alimentation issue de l’agriculture biologique est un segment de marché. Il s’est constitué autour d’un cahier des charges qui a permis à une demande et à une offre de produits distincts de l’offre dominante de « se trouver » sur le vaste marché. Il a sécurisé économiquement une partie des agriculteurs qui entendaient poursuivre une agriculture paysanne dans un contexte extrêmement difficile d’industrialisation galopante. Une quarantaine d’années plus tard, le succès commercial de l’agriculture biologique est indéniable. On peut voir dans ce succès une inflexion dans l’industrialisation de l’agriculture, un caillou dans la chaussure du complexe agro-industriel triomphant. Il nous semble au contraire que le système alimentaire s’est formidablement adapté à l’éclosion de cette forme de contestation interne, et qu’il y a gagné en stabilité. Car ce qu’a permis l’agriculture biologique – sauver des milliers d’agriculteurs de l’élimination, libérer une partie du territoire de l’épandage de pesticides –, elle l’a permis en se passant des politiques publiques. Et ce précédent pèse aujourd’hui très lourd. Il pèse dans les représentations des milieux critiques, où l’idée s’est répandue d’un « consommateur » qui détiendrait la clé de la transformation de l’agriculture. Il pèse dans les discours et stratégies gouvernementaux face à la critique des politiques productivistes : « Si vous voulez une autre agriculture, inutile d’en changer les règles. Créez des labels, séduisez les consommateurs, ce sont eux qui trancheront. » Ou bien encore : « Interdire ce pesticide sur tout le territoire ? Les producteurs et les consommateurs ont pourtant déjà le choix ! »
Il est clair pour nous que dans un tel contexte, l’agriculture biologique ne peut renverser l’ordre agricole et alimentaire en place. Elle est plutôt devenue, comme Charbonneau l’avait prédit, le complément de gamme de l’agriculture industrielle.
Bernard Charbonneau est un des premiers à avoir anticipé cette impasse, à avoir identifié le caractère fonctionnel, pour la société capitaliste industrielle, de l’éclosion de « niches » à la périphérie de l’offre alimentaire dominante. Précurseur de l’écologie politique, mais contempteur précoce de son accommodement avec le système économique, Charbonneau prit dès les années 1960 la mesure du désastre de l’industrialisation de l’agriculture tout en s’inquiétant aussitôt du rôle de caution que pourrait jouer une agriculture biologique dans ce processus.
Lui aussi espérait que la bio soit une « activité de pointe, rassemblant l’avant-garde qui percera[it] la digue par où passera[it] un jour la mer ». Mais c’était pour souligner aussitôt que « sa tentation, c’est le ghetto, la secte, où la société globale ne manquera pas d’enkyster le corps étranger qui la menace (11) ». Voilà comment il anticipait cette dynamique d’extension du « désert agrochimique », au milieu duquel « quelques ghettos verts produi[raient] des produits biologiques pour des épiceries de luxe », qui les vendraient deux à cinq fois plus cher que leurs ersatz d’hypermarché (12) :
L’agriculture « sans sol », la « zéro pâture », c’est la clôture du système industriel […]. C’est la fin des dernières nourritures, des derniers bocages remplacés par la chienlit du plastique et de la tôle dans les ruines et les ronces, car la loi de l’industrie veut que tôt ou tard l’on substitue à l’entreprise indépendante des ensembles automatisés et intégrés gérés par ordinateur. […] Mais ce ne sera pas un fait pour tout le monde, car l’élite échappera à cette grande mue opérée pour le bonheur du peuple. […] Le temps de l’ersatz est celui du produit « naturel ».
Ces lignes de 1973 annoncent la formation d’un clivage de classe autour de l’alimentation, largement avéré aujourd’hui, et d’autant plus puissant qu’après la parenthèse des Trente Glorieuses, les inégalités de revenus sont reparties à la hausse dans les sociétés occidentales. Charbonneau montre combien l’existence d’un secteur produisant une alimentation « de qualité garantie » pour une minorité de la population est consubstantielle d’un ordre économique et social inégalitaire. À l’image des dignitaires du Parti communiste chinois se réservant les produits de fermes bio créées à leur intention, les couches aisées des sociétés européennes et américaines ont accès à une nourriture moins frelatée et nocive que celle destinée aux masses. Elles préservent ainsi leur santé tout en satisfaisant leur besoin de distinction sociale, pendant que la course à la baisse des coûts de production peut continuer sur le reste du marché. Cette course est rendue indispensable par l’érosion continue du revenu disponible de populations de salariés et de chômeurs toujours plus nombreux, et ce pour deux raisons : d’une part, en maintenant au plus bas la part du budget des ménages consacrée à l’alimentation, on libère du « pouvoir d’achat » au bénéfice des autres secteurs de l’économie dont la croissance, on le sait, est indispensable au régime économique en vigueur. D’autre part, il s’agit de maintenir l’accessibilité de l’alimentation le plus largement possible, sans quoi c’est l’ordre social dans son ensemble et ceux qui y dominent qui sont menacés, comme les Printemps arabes ont pu le rappeler. « Reconnaissez au moins ce mérite à l’agriculture industrielle de permettre l’accès des populations modestes à l’alimentation ! » C’est ce qu’avait opposé Stéphane Le Foll à la Confédération paysanne lors de la bataille autour de l’usine des 1 000 vaches en Picardie, où le syndicat paysan avait mené une série d’actions en 2014 et 2015. Les riches chez Naturalia, les pauvres chez Aldi. Stéphane Le Foll venait de réintroduire la question sociale dans les orientations du syndicat paysan : quelques années plus tard, celui-ci s’engageait, avec d’autres, dans la conception d’une Sécurité sociale de l’alimentation.
Il est un segment de l’offre alimentaire situé au-delà du hard discount, et qu’à tort on classe généralement à part des autres : c’est le continent en pleine expansion de l’aide alimentaire. Rappelons que l’aide alimentaire concerne près de 7 millions de personnes en France en 2020 ; et que ce chiffre est en progression constante depuis plus de dix ans. Cette distribution de colis de nourriture gratuits aux plus démunis ne relève plus du tout d’une situation d’urgence temporaire. Elle est devenue un dispositif structurel qui a une fonction dans l’économie : écouler les surplus d’une production agricole pléthorique, qui, sans elle, perd toute efficience économique. La chose est manifeste aux États-Unis, lieu d’élection de l’idéologie néolibérale mais où, parmi mille entorses à la théorie, l’État organise le soutien à la consommation des produits de l’agriculture nationale, y compris par une politique d’aide alimentaire d’envergure. Ainsi pas moins de 15 % des citoyens américains vivaient grâce à des bons alimentaires, en 2011, soit 45 millions de personnes (13).
En France aussi, ce système d’aide est devenu une industrie à lui tout seul (un milliard et demi d’euros de chiffre d’affaires chaque année (14)). Il repose sur la collecte des invendus de la grande distribution par des associations, qui stockent, trient puis mettent à disposition les denrées alimentaires dans les délais les plus courts. Une évolution capitale des années 2010 fut la défiscalisation aussi bien des invendus des grandes surfaces alimentaires que des dons industriels et agricoles, mise en place par les lois Garot (2016) et Egalim (2018) au nom de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Comme le souligne la journaliste Sophie Chapelle, « la défiscalisation de l’aide alimentaire profite en premier lieu aux grandes et moyennes surfaces. […] Non seulement les distributeurs ne paient plus pour la destruction de leurs invendus grâce aux associations caritatives, mais ils bénéficient d’une réduction fiscale sur des denrées inutilisées [dont une partie] fini[t] à la poubelle (15) », parce que mise à disposition trop tard par rapport à la date de péremption. Ce système de l’aide alimentaire en pleine expansion convient donc très bien à l’industrie agroalimentaire et plus largement au complexe agro-industriel : si la distribution aux plus démunis est gratuite, la mise à disposition de cette nourriture est abondamment financée par l’argent public. À un niveau, d’ailleurs, qui reste indéfini : le rapport de l’Igas (précédemment cité) de 2019 souligne l’inaccessibilité des données fiscales en question, ce qui l’amène à qualifier l’État de « payeur aveugle » en la matière. Et ce n’est pas tout : on estime à 600 millions d’euros la valeur du temps passé par l’ensemble des bénévoles qui assurent la distribution des colis — dit autrement : qui assurent gratuitement l’écoulement des surplus de l’agro-industrie (16).
En 2008, l’un d’entre nous participait aux réunions de concertation et de préparation de la future loi d’orientation agricole Le Maire. Lors de l’une d’entre elles, un représentant de la FNSEA se leva et déclara : « Pour produire assez, il nous faut produire trop ; et nous avons besoin [du législateur] pour écouler ce trop ». Pour nous ce fut une révélation, et pour l’État aussi, semble-t-il, puisque l’idée fit son chemin jusqu’à se déployer dans la loi Garot (du nom du maire de Laval, la ville de Lactalis), qui permet de transformer les déchets en réductions d’impôt et en paix sociale, via les colis alimentaires. Cette « solution » conjure les questions qui dérangent : à quoi rime une agriculture qui produit trop, alors que tant d’exploitants ne s’en sortent pas économiquement ? Comment ignorer que la nourriture si charitablement fournie participe à la dégradation de la santé de ces populations précaires, parce qu’elle présente souvent tous les défauts et les excès de la production agroalimentaire frelatée qui domine l’offre ? Que penser d’une industrie qui doit sa viabilité économique au développement de la pauvreté ? Tout est cul par-dessus tête, mais pourquoi s’en faire puisque, de cette façon, la société tient, n’explose pas. C’est évidemment la priorité des élites dirigeantes du monde industriel.
… ses machines bureaucratiques à normaliser et déréguler
La technicisation de la société moderne ne se résume pas à la prolifération de machines toujours plus complexes et puissantes. Elle consiste aussi en une « surorganisation » de toute la vie sociale par des normes techniques, qui nourrissent le phénomène bureaucratique (17). L’agriculture est un domaine où la normalisation de l’activité et l’emprise des administrations sur les travailleurs vont très loin ; en tout cas, c’est peu dire que celles-ci interrogent la réalité du statut d’« indépendants » des agriculteurs.
Dans les années 2010, des groupes d’agriculteurs, agissant en marge des syndicats, ont attiré l’attention sur cette normalisation et cette emprise administrative, en les dénonçant comme des facteurs essentiels de l’industrialisation. Ce lien a d’abord été affirmé par le collectif d’éleveurs tarnais « Faut pas pucer », formé autour du refus du puçage électronique des moutons et des chèvres. L’identification des bêtes par des puces RFID (radio-identification) était rendue obligatoire, à partir de 2011, par une réglementation européenne, elle-même étant le résultat du lobbying de la Fédération nationale ovine, branche de la FNSEA. Cette obligation fut perçue par quelques poignées d’éleveurs comme une étape symbolique importante de l’industrialisation de l’élevage et ceux qui entrèrent en résistance ouverte contre cette mesure l’inscrivaient dans un processus de bureaucratisation entamé de longue date et insuffisamment questionné par le milieu agricole.
Si aujourd’hui nous nous opposons au puçage, c’est que ce dernier nous fait sentir encore une fois le poids d’une administration qui se veut toujours plus englobante et totale. Une part grandissante de notre travail est consacrée à remplir des formulaires qui justifient notre respect des règles. Nous recevons sans cesse des injonctions qui nous commandent de faire telle chose à tel moment pour telle raison, sous peine de perdre nos primes, nos allocations, nos droits et jamais ne nous est laissée la liberté d’évaluer une situation par nous-mêmes. Nous sommes ainsi considérés comme suspects. […]
Jadis, l’identification des animaux n’était rien d’autre que le moyen choisi par l’éleveur de reconnaître ses bêtes. Le choix des méthodes de reconnaissance restait donc particulier à chacun, et il ne regardait que le berger et son troupeau. Mais quand cette connaissance devient l’« identification » au sens de l’administration, elle se transforme en formulaire à porter devant un tiers pour justifier de ses actes. Ce qui était un geste propre à un métier devient un numéro, puis un code-barres, puis une puce, qui vont être assimilés à d’autres numéros pour créer des statistiques, gérer et labelliser de la marchandise, et en retour pour définir de nouvelles règles de conduite, de nouvelles normes, de nouvelles attitudes qui servent à gouverner des millions de brebis et leurs bergers (18).
La lutte contre le puçage électronique est venue illustrer très concrètement cette emprise bureaucratique, puisque les administrations départementales n’ont pas hésité à infliger de lourdes sanctions financières aux désobéissants, à la suite de contrôles sur les fermes : amendes, retraits de primes et parfois des dossiers transmis à la justice, pour faire appliquer une réglementation industrialisante.
Pourtant, ce n’est pas forcément avec ces éleveurs pratiquant une désobéissance ouverte et en général soutenus par des voisins, des collègues, des personnes d’autres professions et d’autres régions sensibles à leur cause que l’administration est la plus sévère – les sanctions contre les insoumis au puçage auraient pu être plus nombreuses, massives et rapides mais l’administration agricole, sans doute surprise par cette résistance marginale mais têtue, a temporisé pour ne pas risquer d’envenimer l’affaire. Les éleveurs isolés, ou vivant dans des territoires moins ouvertement militants, ont subi parfois des persécutions plus poussées. C’est ce qui est arrivé à un éleveur de vaches de Saône-et-Loire, Jérôme Laronze, entré en conflit au long cours avec l’administration vétérinaire et ses contrôleurs. Les tenant pour responsables de la mort de plusieurs bêtes lors d’un contrôle très brusque, choqué qu’ils reviennent plusieurs fois avec des gendarmes sur sa ferme, Laronze prit la fuite en mai 2017 et se cacha aux alentours de chez lui. Trouvé endormi dans sa voiture par des gendarmes, il fut abattu, alors que rien n’indique qu’il eût été menaçant avec eux.
Dans deux textes écrits peu avant sa mort, on trouve des analyses et des positions très proches de celles des groupes dénonçant en divers coins de France le rôle des administrations dans la poursuite forcenée de l’industrialisation.
Quelques jours plus tard, en entretien téléphonique avec une agent de la DDPP, j’exposais mes réticences à justifier que la meumeu 9094 est bien la mère du veauveau 4221 par des méthodes relatives à l’identification criminelle. Cette personne me récita alors son catéchisme administratif et bafouilla quelques arguments que je mis facilement à mal, ce qui me valut d’entendre que ce n’était pas grave et que si je refusais de me conformer à ses exigences, mes animaux entreraient en procédure d’élimination (entendez « abattus ») à mes frais et collectés par le service d’équarrissage puis de clore en déclarant cette phrase qui me revient quotidiennement en tête : « Moi je m’en fiche ce ne sont pas mes bêtes (19). » L’hyperadministration n’apporte rien aux agriculteurs, sinon de l’humiliation et des brimades. Cela ne rapporte qu’aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique, mais il illustre l’ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans (20).
Suite à la mort par balles de cet éleveur de trente-sept ans, un Collectif national des agriculteurs « contre les normes » se forme. Connu sous le nom de « Hors-norme », ce groupe poursuit le travail d’amplifier les pratiques de solidarité entre paysans face aux administrations. Hors-norme avance que les normes sanitaires et environnementales qui se multiplient depuis trente ans ne visent pas à protéger la nature et la santé des humains, mais à « écrémer la population agricole pour concentrer la production et les profits ». La combinaison de réglementations pointilleuses et de mise sous perfusion des agriculteurs par les subventions donne selon eux à l’industrie « les conditions et les moyens de sa prospérité (21) ».
Ainsi Yannick Ogor, membre de ce collectif, propose-t-il l’hypothèse, dans Le Paysan impossible, qu’une gestion de la population d’agriculteurs par les normes a succédé, ou plutôt s’est superposée, à la gestion par les crises économiques (surproduction ou baisse des cours). Il interprète la création d’un second pilier de la Pac, au tournant des années 1990 et 2000, comme un simple renouvellement des modalités de modernisation par la bureaucratie agricole : ce sont désormais la dégradation des milieux naturels et les scandales sanitaires qui serviraient de prétexte pour imposer des normes industrielles et pousser à l’agrandissement, en particulier dans l’élevage et les produits laitiers.
Nous rejoignons le constat selon lequel la prolifération normative, y compris de normes dites « environnementales », s’ajoute au libre-échange et à diverses politiques publiques, délibérées ou pas, dans la purge agricole en cours. Il arrive tous les jours, en effet, que le fait de devoir renouveler le pulvérisateur à pesticides qui fuit et qui a donc perdu son autorisation lors du contrôle régulier institué par l’administration en 2009 s’ajoute à d’autres difficultés pour décider un agriculteur à cesser son activité. Pour autant, en tant qu’ensemble, les normes en agriculture nous paraissent plus ambivalentes que ce que suggère le collectif Hors-normes. Si les normes environnementales ne sont que des ruses de l’industrialisation, comment expliquer l’acharnement des agro-industries elles-mêmes, dans un lobbying tous azimuts, à obtenir le démantèlement de telles normes ? C’est d’ailleurs l’une des visées principales des accords de libre-échange dits de deuxième génération, tels Ceta avec le Canada ou Tafta avec les États-Unis, que les agro-industries ont poussés de toutes leurs forces auprès de leurs gouvernements respectifs. En l’occurrence ces accords, qui visent à libérer les flux de marchandises de toute entrave, désignent les normes de production comme des « barrières non tarifaires » (par opposition aux droits de douane qui constituent des « barrières tarifaires »), à abattre, donc : l’interdiction en Europe de la ractopamine, une hormone de croissance pour les porcs, entrave les exportations américaines vers l’Europe ; les normes sanitaires américaines compliquent méchamment l’exportation des fromages européens ; les limites maximales de résidus de pesticides (LMR) autorisées sur les fruits de notre côté de l’Atlantique interdisent aux Américains l’accès au marché européen… « Moderniser » toutes ensemble ces fâcheuses vieilleries par une harmonisation « probusiness », c’est-à-dire par le bas, tel est l’objet de la « coopération réglementaire » engagée par ces traités. L’intérêt de l’agro-industrie dépend donc des normes en agriculture de deux manières : d’une part leur prolifération élimine les agriculteurs, auxquels l’industrie se substitue. D’autre part leur démantèlement augmente la profitabilité de l’industrie en réduisant ses coûts de production et étend le domaine de l’export. Difficile donc de concevoir les normes en agriculture comme un tout cohérent et univoque dans leur contribution à l’industrialisation.
Le champ des normes en agriculture nous apparaît plutôt comme un champ de bataille où les belligérants (agro-industries, syndicats agricoles, administrations, environnementalistes…) défendent des visées et intérêts antagonistes. De notre point de vue, il est un champ de bataille par défaut, situé sur le terrain de l’adversaire. Celui de la logique technocratique, de la négation de la complexité, du déni politique et démocratique. Les organisations syndicales ou environnementalistes qui pratiquent ce combat le défendent souvent comme relevant d’une stratégie des « petits pas ». En réalité, combattre l’agro-industrie sur le terrain des normes, c’est l’affronter lorsqu’elle a déjà gagné. Car c’est acter, au risque de l’entretenir, la faiblesse d’une activité démocratique à même de redéfinir nos besoins alimentaires et les moyens normatifs d’y répondre qui soit lucide sur sa légitimité et par conséquent déterminée à imposer non pas ses préférences, mais ses choix.
Par exemple, il nous semblerait opportun de prôner l’institution d’une norme qui plafonnerait la puissance technologique déployée par hectare cultivé, ou par actif agricole. Mais pour que la mise en place d’une telle norme participe effectivement à la généralisation de l’agriculture paysanne, elle devrait être précédée, ou sous-tendue, ou entourée de quantité d’autres transformations (réforme agraire, installation massive de nouveaux agriculteurs, refondation des politiques commerciales aux frontières, politiques alimentaires) sans lesquelles elle ne conduirait à rien d’autre qu’à l’effondrement de l’agriculture française. C’est pourquoi il ne nous viendrait pas à l’esprit de défendre cette idée comme une « solution » en soi à l’emballement technologique en agriculture. Pour qu’une telle norme puisse produire dans la réalité des effets cohérents avec notre intention politique, nous n’avons d’autre choix que de porter le projet d’une transformation démocratique de l’agriculture et de l’alimentation, dans tous leurs aspects.
À proprement parler, il n’y a pas de « bonne norme » ou de mauvaise « norme ». Il n’y a que des normes imposées par des pouvoirs dominants, publics ou privés, et des normes issues de l’usage populaire ou de la délibération autonome. Il en va de même avec la technique et les technologies : nos sociétés existent moyennant la technique, comme elles existent moyennant des systèmes normatifs, à l’instar du langage. Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » technologie : il y a des technologies issues d’un faire social au long cours, sélectionnées, éprouvées, questionnées, améliorées – ou abandonnées – par les mille gestes quotidiens d’agriculteurs ou artisans. Et puis il y a les autres…
Notes
1. Selon les chiffres compilés par Unigrains dans sa publication « Semences – Chiffres clés », novembre 2019 (https ://www.unigrains. fr/wp-content/uploads/2019/11 /UNlGRAlNS_Chiffres_semences_2019. pdf).
2. Antoine de Ravignan, « Les pesticides, poisons sans frontières », Alternatives économiques, 25 février 2020.
3. Même si les données chiffrées sont dépassées, on peut consulter avec intérêt le numéro spécial de la revue Solidaire de 2014, « Agropoly. Ces quelques multinationales qui contrôlent notre alimentation », éditée par l’association suisse Public Eye (https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Agrarrohstoffe/2014_PublicEye_Agropoly_Brochure_thematique.pdf).
4. Source Wikipédia.
5. Erwan Seznec, « Quand les syndicats verts font la loi dans les campagnes françaises », op. cit., p. 310.
6. Ibid., p. 312.
7. En anglais : Comprehensive Economie and Trade Agreement.
8. Dans La Forteresse agricole. Une histoire de la FNSEA, (Paris, Fayard, 2004), Gilles Luneau souligne que le syndicat majoritaire a d’autant mieux colonisé et verrouillé l’organigramme agricole français qu’il l’a pour une bonne part créé.
9. Voir, par exemple, les déclarations à ce sujet de Dominique Bussereau, ministre sous la présidence de Jacques Chirac, dans l’enquête de l’émission de France 3, Pièces à conviction, du 18 janvier 2017 : « FNSEA : enquête sur un empire agricole ».
10. La Coordination rurale est issue d’une scission avec la FNSEA suite à des désaccords sur la Pac, au début des années 1990.
11. « De l’urgence d’ouvrir la gueule pour la défense du Cantal, de tout ce qu’il reste de fromages, d’agriculture et d’agriculteurs », La Gueule ouverte, n° 115, 21 juillet 1976, reproduit dans Bernard Charbonneau, Le Totalitarisme industriel, Paris, L’Échappée, 2019.
12. « L’agrochimie détruit le paysage… et le paysan », Combat nature, n° 16, novembre 1974, reproduit dans Bernard Charbonneau, ibid., p. 176.
14. Calcul maison, qui porte d’ailleurs moins sur un chiffre d’affaires à proprement parler que sur une somme de valeur économique mise en jeu pour permettre cette distribution massive de nourriture « gratuite ».
15. Sophie Chapelle, « Distribuer de la malbouffe aux pauvres tout en défiscalisant : les dérives de l’aide alimentaire », Bastamag, 8 septembre 2020 (https://www.bastamag.net/Les-derives-de-l-aide-alimentaire-defiscalisation-hypermarches-surproduction-agro-industrie-grande-distribution).
16. Une très bonne synthèse sur les ressorts et le fonctionnement du système de l’aide alimentaire en France est proposée par Nicole Darmon, Catherine Oomy et Doudja Saïdi-Kabeche, dans « La crise du COVID-19 met en lumière la nécessaire remise en cause de l’aide alimentaire » (29 juin 2020), article de la revue en ligne The Conversation, (https :// theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-necessaire- remise-en-cause-de-laide-alimentaire-140137).
17. C’est ainsi que Jacques Ellul souligne dans l’immédiat après-guerre que la technique est devenue « l’enjeu du siècle » (La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 2008 [1954]).
18. Lettre du groupe « Faut pas pucer » aux autres collectifs locaux de lutte contre le puçage électronique, « À propos de la demande de dérogation concernant le puçage des brebis et des chèvres » (décembre 2012), reproduite dans Aude Vidal (dir.), On achève bien les éleveurs…, op. cit, p. 128.
19. Jérôme Laronze, « Chroniques et états d’âme ruraux » (printemps 2017), publié dans L’Empaillé, n° 6, automne 2019 (http://lempaille.fr/jerome-laronze). Les guillemets sont de Laronze.
20. Extrait d’un entretien accordé pendant sa « cavale » de mai 2017 au Journal de Saône-et-Loire.
21. « L’État élimine les agriculteurs. Refusons les normes ! Évitons les balles ! », appel fondateur du collectif reproduit dans L’Inventaire n° 6, automne 2017, revue diffusée par les éditions La Lenteur, p. 84 et 85.
L’Atelier paysan
Reprendre la terre aux machines.
Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire
Le Seuil, 2021, rééd. en poche en 2023
Source : L’Atelier paysan, « Reprendre la terre aux machines | «Les Amis de Bartleby

