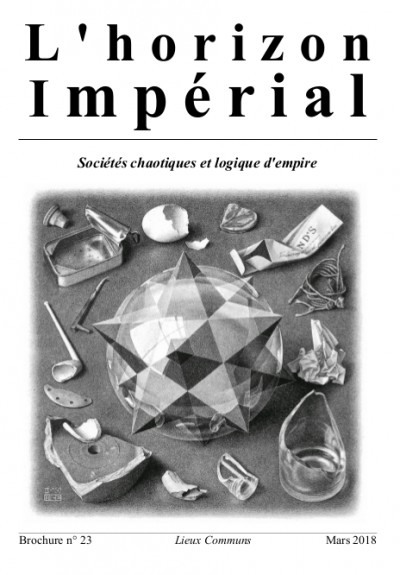parler et, pour tout dire, nous n’avons presque pas de lectorat… Donc, lorsqu’on nous demande d’intervenir, c’est courageux, c’est encourageant, et ça fait plaisir.
Présentation de « Lieux Communs »
Alors je dis « nous », mais ce soir je suis seul. Notre collectif traverse une mauvaise passe, à l’image du monde, et subit une sorte d’éparpillement mou, de désertion muette depuis maintenant plus d’un an. S’y substitue de fait une sorte de réseau informel dont il n’est pas abusif de dire que j’occupe le centre, ou la tête. Ce n’est pas une situation confortable, alors ça peut être amené à changer, mais ça m’étonnerait.
Il y aurait plusieurs choses à dire à ce propos, mais la plus intéressante, et qui me permet de présenter brièvement notre travail, est que durant cette petite dizaine d’années d’existence, notre parcours a été nourri par les mouvements de la société, on va dire depuis le mouvement social de 2003, jusqu’à celui de 2010 contre la réforme des retraites qui a été l’occasion de nos premiers tracts et d’une première brochure conséquente, qui ramasse nos positions sur feu la « question sociale ». Les soulèvements arabes qui ont suivi ont été l’occasion d’un voyage auprès des camarades tunisiens sur place et d’une autre brochure, et puis d’une autre série, écrite avec les copains grecs, sur le beau mouvement grec du printemps 2011. Je reparlerai un peu de ces expériences.
Notre composition est assez atypique dans le monde militant, que nous avons tous quitté par dégoût, qu’il s’agisse des situationnistes, de la nébuleuse anarchiste, altermondialiste ou humanitaire-sociale, ou encore de Lutte Ouvrière… Nous nous sommes rencontrés, et retrouvés sur la base de l’œuvre de Cornelius Castoriadis, ce qui nous a valu l’accusation immédiate de fétichisme – aujourd’hui on nous reprocherait presque de le trahir… Nous avons fait beaucoup de choses, mais on a surtout écrit, d’abord parce que les perspectives d’action sont assez indigentes et surtout parce que, partant d’une insatisfaction pratique profonde, notre objectif était de prétendre viser comme une refondation de quelque chose qui serait de l’ordre de la politique, au centre duquel nous avons peu à peu mis le thème de la démocratie directe, thème de ce soir. Nous avons sorti trois brochures conséquentes sur cette question qui forme un des piliers de notre engagement, si on veut le simplifier, avec la redéfinition des besoins, c’est notre formulation du thème de la décroissance, et l’égalité des revenus , qui nous semble indispensable mais que nous sommes les seuls, à notre connaissance, à porter explicitement. Ces trois points s’impliquant mutuellement, pour nous.
Sur notre composition encore, nous étions tous aussi d’origines différentes, puisque parmi nous il y avait des origines tunisienne, française, algérienne, grecque, antillaise, ukrainienne, corse, juive, chrétienne, musulmane… Tous athées, bien sûr. Je dis ça parce que la question de l’identité, à laquelle nous avons consacré une brochure, s’arrime pour nous à celle du projet : ce qui définit, ce n’est pas tellement d’où l’on vient, mais où on va, ce qu’on veut être et faire, pour soi et pour la société. C’est aussi de cette diversité interne que l’on aborde, dans notre dernière brochure en deux parties, l’islamisme, qui a en ce moment d’ailleurs, et malheureusement, beaucoup de succès.
Introduction
La question que l’on nous a demandé de développer ce soir, c’est la démocratie directe, et particulièrement à partir des travaux de C. Castoriadis, à partir ou à l’intérieur d’un thème plus global qui est « Penser à présent, penser le présent », c’est donc dans cette direction que je vais orienter mon intervention.
Je vais procéder en trois temps : d’abord une présentation assez classique de ce qu’on entend par démocratie directe, et je vais m’appuyer explicitement sur C. Castoriadis – ceux qui connaissent peuvent en profiter pour feuilleter les brochures ou les tracts qui circulent…
La seconde partie sera plus liée à l’actualité mais moins enthousiasmante, puisque je vais aborder les obstacles fondamentaux, les grandes lignes de force historiques qui se dressent aujourd’hui face à un tel projet.
Et enfin, dernière partie, je tenterai de percevoir dans notre situation très singulière ce qu’il est possible de faire pour nous, aujourd’hui, à partir de tout ça.
I – Présentation de la démocratie directe
Le terme de démocratie directe est évidemment un pléonasme : la démo-cratie, c’est le pouvoir du peuple. Une démocratie où ce n’est pas le peuple qui décide, où ce sont par exemple ses représentants, ce n’est pas une démocratie, contrairement à ce que tout le monde croit : c’est une oligarchie. C’est une confusion récente, qui date de la fin du XIXe siècle, qui a recouvert un choix qui s’est fait pourtant très clairement lors des révolutions française et américaine : les acteurs de l’époque ont décidé, explicitement, qu’il n’était pas souhaitable de donner le pouvoir au peuple et qu’il devait rester entre les mains avisées de quelques-uns, les représentants. Donc ils ont opté pour un régime représentatif, là-dessus les travaux de B. Manin [1] sont très clairs : si nous faisions revenir ces gens-là aujourd’hui, ils hurleraient de rire de nous entendre fiers de vivre en « démocratie ». Pour eux la démocratie c’était, et à raison, le règne du tirage au sort et cela était hors de question : ils ont instauré en toute connaissance de cause l’élection et la représentation.
Aujourd’hui, nous vivons dans une oligarchie libérale. L’expression est de C. Castoriadis : oligarchie, ça veut dire que c’est une minorité qui nous gouverne ; libérale parce que nous bénéficions d’énormément de droits, conquis par la lutte au fil des siècles, le droit de choisir des gouvernants, le droit d’expression libre, un droit de la défense, le droit d’association, le droit de manifester, etc.
Nous ne vivons donc pas en démocratie, mais il nous faut tout de même accoler le terme de « directe » pour que les gens comprennent de quoi l’on parle.
1 – Fondements théoriques de la démocratie directe
Ce terme de démocratie directe n’a pas vraiment d’histoire, c’est pour cela qu’il est facilement utilisable, il ne connote ni ne dénote pas grand-chose. On peut, en première approche, y associer d’autres termes, qui ont été utilisés dans l’histoire : celui d’émancipation sociale, par exemple, ou de socialisme ou de communisme – au sens primitif, bien entendu, ce sont des mots qui dégoulinent de sang depuis le XXe siècle – même s’ils sont marqués par l’économisme de l’époque, l’esprit du capitalisme. Le terme d’anarchisme, aussi, la démocratie directe est un anarchisme bien compris, à condition de bien discuter… Plus près de nous, entre les deux guerres, c’était plutôt la république des conseils, la coordination d’assemblées générales, pour le courant conseilliste, puis celui d’autogestion généralisée, durant les années 70, ou d’auto-gouvernement, peu usité, ou celui d’auto-organisation, même s’il porte à confusion – puisque sans transcendance, tout est toujours auto-organisé, même si c’est la survie du plus fort ; il n’y a alors pas de finalité. Et enfin, depuis les « Indignés » de 2011, on entend les termes de démocratie radicale, réelle ou vraie, etc.
Le pouvoir exercé par le peuple
La démocratie directe, c’est donc lorsque le pouvoir est exercé par le peuple, directement, sans représentants de sa volonté. Il y a des délégués bien entendu, tout le monde ne peut pas tout faire tout le temps : on peut désigner une personne, de différentes manières – l’élection, le tirage au sort, la rotation… – qui ira dire à une autre assemblée ce qui s’est décidé ici et inversement. Mais on ne va jamais lui demander de décider pour nous.
Cela veut dire que la politique n’est pas une affaire de spécialistes, de professionnels, d’experts, mais bien l’affaire de tout le monde, de n’importe qui. En ce sens, il ne peut pas y avoir de spécialistes en politique ; les sciences politiques sont un oxymore, une imposture : il peut y avoir des experts en histoire, en sociologie, en anthropologie, en psychologie sociale ou en économie, ils sont même indispensables, il faut les consulter, les confronter entre eux, mais ce ne sont pas eux qui décident. La politique, ce n’est pas un régime de savoir, elle repose sur les opinions, au sens noble, la doxa en grec, les avis, les volontés, les désirs, les projets, ce que l’on veut vivre. Par exemple, je veux une égalité stricte des revenus, que l’argent cesse d’être une obsession et un différenciateur social : des sociologues, des historiens ou des économistes peuvent venir et me dire ce qui s’est déjà vu, ce que cela impliquerait sous tels ou tels aspects, ils vont m’obliger à me questionner, à approfondir, mais ce n’est pas à eux de décider. C’est à nous, en fonction de ce que l’on veut. Je peux, on peut se tromper, mais c’est notre choix. Donc, le pouvoir ne peut résider entre quelques mains ou des institutions séparées comme l’État : il doit être partagé par le plus grand nombre.
Démocratie directe : l’autonomie collective
Affinons un peu l’approche : la démocratie c’est lorsque le peuple fait ses propres lois. Ces lois reposent sur des principes, des valeurs, une culture, une histoire, des désirs qui sont ceux des gens. Autrement dit, l’ensemble d’une société singulière façonne ses propres règles, pour elle, à ce moment. C. Castoriadis parle d’auto-institution de la société : les règles en vigueur émanent des gens dont le collectif anonyme, à une période de l’histoire, forme la société et qui sont réunis à un endroit, à un moment, pour délibérer et décider. On parlera, en reprenant les catégories kantiennes, d’autonomie : d’« autos », soi-même, et « nomos », les règles, les lois, les limites. Nous faisons nous-mêmes nos lois, en opposition à l’hétéronomie, où les lois émanent d’un en-dehors, d’un « autre » pour nous fantasmé, de la société : les Dieux, les Traditions, les Ancêtres, les Lois de la Nature ou du Marché, les Lois de l’Histoire ou de la Science, le Parti, le Roi ou l’Émir, etc. Cette hétéronomie, c’est 95 % de l’histoire humaine, et la démocratie rompt avec ça : nos lois n’ont pour seule source et légitimité que les gens réunis et délibérant, nous le savons et l’assumons. C’est la porte ouverte à l’auto-transformation de la société, évidemment, l’histoire en marche.
Auto-nomie : c’est aussi l’auto-limitation. Ça veut dire que nous posons nous-mêmes nos propres limites à ce que nous faisons. Il n’y a plus beaucoup de pétrole, ou de bois, ou d’eau : nous devrions limiter nous-mêmes notre consommation et aviser sans qu’un Dieu ou un Sacré ne nous y oblige. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : nous nous comportons comme des enfants en absence de Père, parce qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité. Et inversement, si nous sommes irresponsables, nous ne sommes pas libres. Donc une société démocratique, c’est une société qui s’interdit, qui ne s’autorise pas à tout faire : nous ne massacrons pas les minorités, nous ne parquons pas les femmes, ni n’avortons les anormaux, etc.
Mais auto-limitation des individus aussi, nécessairement : n’importe quel régime politique et social exige et forme un individu qui lui correspond, qui l’incarne, ce sont les deux faces d’une même chose. Il y a un type d’individu, des types anthropologiques, qui correspondent à une société féodale et qui seraient incapables de vivre en démocratie et inversement. Il n’y pas de démocratie sans individus habités par ces réflexes et ces habitudes, et qui n’émergent pas tout habillés dans l’histoire, mais qui se forment au cours de siècles. Donc auto-limitation individuelle : je ne m’autorise pas à violer ou à tuer, alors que je pourrais le faire. Et je me l’interdis, moi, pas à cause du code pénal ou de la colère divine, mais parce que je veux vivre dans un monde où ce n’est pas permis et que je suis l’égal des autres. C’est ce que vise explicitement la psychanalyse, qui en procède. Auto-limitation de l’individu et du collectif, donc autonomie individuelle et collective.
Ce sont les humains qui font l’histoire
Pour résumer, ce sont les humains qui font l’histoire. Nous cherchions, dans notre collectif, notre postulat fondamental et nous nous sommes reconnus dans cette phrase de Marx. Ce ne sont ni les puissants, ni les minorités, ni les gènes, ni les ressources naturelles, ni les forces productives (Marx contre Marx !) mais, fondamentalement, en dernier ressort, les humains qui font, élaborent, créent, à partir d’une infinité de contraintes, ce qu’ils sont et ce qu’ils deviennent. Et la démocratie, c’est lorsque tout cela se sait et devient explicite pour les gens.
Tout ça a été magistralement synthétisé par Castoriadis, et repris aujourd’hui par quelques personnes, M. Abensour, S. Latouche, J.-C. Michéa ou J.-P LeGoff, etc., et cela provient d’un courant philosophique, ténu mais très consistant, qui, pour faire vite, se réclame plutôt de Rousseau et de La Boétie que de Hobbes, Machiavel ou Spinoza. C’est le discours de la servitude volontaire : si la société est ce qu’elle est, c’est que les gens l’acceptent, fondamentalement. C’est l’acceptation, l’assentiment ou la passivité des citoyens, dans tous les cas c’est leur attitude foncière qui maintient l’état de fait ou le transforme radicalement. C’est ce qu’on a vu en Tunisie, où Ben Ali était maître incontestable, et en quelques semaines, il a pris ses jambes à son cou : le peuple avait jugé que cela suffisait. Pourquoi là et pas avant ou après ? Il y a des facteurs lourds, des déterminismes, des mécaniques qui jouent, on les évoque dans notre brochure, mais pour nous, en dernier recours, en dernière analyse, notre postulat philosophique est que l’individu libre choisit les fers ou la liberté – et quelles que soient les situations : on a vu des révoltes dans les camps de concentration ou des goulags.
2 – Histoire de la démocratie directe
Mais la démocratie directe n’est en rien une construction philosophique. C’est une praxis, un aller-retour entre des pensées et des pratiques, des réalisations historiques.
Dans l’histoire de l’humanité, les périodes sont rares où les gens ont tenté de prendre ainsi leur destin en main. L’immense majorité de l’aventure humaine est constituée d’hétéronomie, et lorsqu’il y a révolte, c’est pour perpétrer une hétéronomie différente, ou la même avec d’autres acteurs. Il y a en fait deux grands moments historiques de rupture avec cette pente naturelle, je reprends là aussi C. Castoriadis : la Grèce antique et l’Occident moderne.
La Grèce antique
Le cas de la Grèce est connu, on parle essentiellement d’Athènes, qui semble avoir été exemplaire, mais il y a aussi une multitude de cités-États sur lesquelles on a moins de données. La démocratie directe y a été pratiquée pendant un ou deux siècles, globalement de la réforme de Clisthène (-504) à la fin de la seconde guerre du Péloponnèse (-404) ou à l’invasion macédonienne (-322), mais il y aurait à inclure les siècles précédents, qui ont été le théâtre de multiples luttes de paysans et d’auto-transformations sociales et politiques. On voit là une société qui fonctionne véritablement sans État. Il y a une administration, constituée d’esclaves, mais pas d’organes de pouvoir séparés du peuple. Les décisions sont prises par l’assemblée, l’Ekklésia (qui a donné « Église » chez les chrétiens) et des organes, le Conseil ou la Boulè, où les gens sont tirés au sort, pour un temps déterminé. C’est le système des jurés d’assises d’aujourd’hui – quiconque possède une carte d’électeur peut être amené à y siéger – mais généralisé à toutes les institutions politiques. Et il y a en plus une multitude de dispositifs, d’institutions, de mesures de partage du pouvoir qui viennent s’équilibrer, se limiter les uns les autres – auto-limitation, donc. Tout ça a été très bien décrit par M. H. Hansen ou M. I. Finley, par exemple. On voit aussi dans cette Athènes antique le peuple en armes : l’armée n’est pas constituée de professionnels issus d’une ethnie, d’une caste, d’une classe qui aurait le monopole de la violence comme dans toutes les sociétés antiques, et possédant ses propres intérêts, mais des citoyens qui se battent donc en connaissance de cause. Et cela influe sur les techniques de combat, puisqu’ils inventent la phalange, et, au-delà, toute une approche très singulière de la guerre, très bien théorisée par V. D. Hanson [2].
Femmes, esclaves, métèques… et religion
L’objection inévitable, et systématique, lorsqu’on aborde la Grèce antique, c’est que la citoyenneté excluait les femmes, les esclaves et les étrangers. Elle est en partie vraie, on pourrait en discuter longtemps, mais en partie biaisée : ces restrictions n’étaient nullement un fondement à la pratique de la démocratie. D’abord parce qu’on oublie que la société athénienne était, de ce point de vue-là, une civilisation antique parmi d’autres qui n’avaient rien, elles, de démocratique. Ensuite parce que la période moderne, dont je vais parler après, montre bien que la démocratie renaît alors sans ces traits incriminés.
Mais l’objection, elle, révèle très bien comment les schémas religieux demeurent ou resurgissent dès qu’il est question de politique. Parce que rétorquer que, comme le régime athénien n’était pas parfait, il ne vaut rien, sous-entend qu’une démocratie directe doit être un paradis ou rien. Et c’est symptomatique dès qu’on parle de projet de société : soit vous décrivez une organisation parfaite, sans défauts, sans failles ou faiblesses (et alors on vous traite d’utopiste), soit on vous fait comprendre que s’il y a encore des problèmes, ça n’en vaut pas la peine… Alors il faut être clair : Athènes n’est pas un modèle, c’est une source d’inspiration, un germe, comme dit Castoriadis, dont on peut s’inspirer pour certaines choses. Et de la même manière, un projet de démocratie directe est un régime éminemment humain, donc relatif, qui n’a rien d’un absolu, mais qui tâtonnera sans cesse, capable de fulgurances comme de laisser beaucoup choses dans l’ombre ou de commettre des atrocités. Tout cela ne peut que dépendre d’une période, d’un peuple à un moment de son histoire, d’une époque relativement à la formation du citoyen (la Paideia) et à la culture propre de ceux qui sont là à ce moment.
Bref, je finis avec la Grèce antique, ou plutôt l’histoire en finit : affaiblies par la guerre civile du Péloponnèse, les cités grecques se font envahir par la Macédoine et Alexandre le Grand fondera l’empire héllénistique, en reprenant la culture héllénique mais en émasculant la dimension démocratique, puis Rome prend le relais, n’en gardant que quelques bribes, et enfin c’est le christianisme qui éradique complètement toute trace d’une autonomie individuelle ou collective. Le projet d’autonomie est alors mort et enterré par le monothéisme, il n’y a même plus un mince fil rouge qui assurerait une continuité quelque part, même si on pourrait en discuter.
L’Occident moderne
Mille ans plus tard, environ, en d’autres lieux, avec d’autres gens, une autre langue, une religion complètement différente, va naître, à nouveau, ce projet d’autonomie individuelle et collective. Vers le haut Moyen Âge, entre le Piémont et les Flandres, du XIe au XIIIe siècle, des villes vont conquérir, arracher leur indépendance vis-à-vis du pouvoir seigneurial : c’est le mouvement des villes libres, qui s’affranchissent ; les villes franches, les bourg, les communes se mettent à s’auto-instituer politiquement et économiquement, là-dessus H. Pirenne, par exemple, est très bien. C’est le tout début de la proto-bourgeoisie, qui va inventer le capitalisme et, parallèlement, la démocratie moderne, sur de nouvelles bases. Bien sûr, ces gens re-découvrent les auteurs antiques, que le dogme de l’Église rendait illisibles, et c’est la Renaissance (rien que le terme lance un pont à travers les siècles) avec ses remises en cause en cascade dans les domaines artistiques, architecturaux, techniques, agricoles, etc. Puis les Lumières, je passe très rapidement, où les esprits s’émancipent des dogmes religieux, des superstitions et cherchent à fonder l’égalité entre les hommes et les possibilités de la liberté pour l’individu et la société. C’est l’Humanisme, qui nourrit en parallèle les mouvements féministes, et plus tard les décolonisations et les courants écologistes, mais qui pour l’instant éclate dans les révolutions anglaise puis américaine et surtout française où, là, sont institués des fonctionnement authentiquement démocratiques, puis des régimes politiques qui s’en inspirent, au moins pendant quelques temps, puisque la réaction prend le dessus, par exemple avec l’Empire et la Restauration. D’une manière générale c’est l’ère des compromis historique entre différentes tendances.
Mais les mouvements ouvriers prennent le relais en Europe et, là encore, parviennent, par soubresauts, à ébranler, réformer l’organisation sociale et politique, et même lors des épisodes révolutionnaires à créer des sociétés fonctionnant en démocratie directe : ce sont les révolutions de 1830 en France, 1847-48 dans toute l’Europe puis le paroxysme lors de la Commune de Paris de 1871 qui constitue une référence centrale pour nous. Ce sont enfin les révolutions du XXe siècle : la russe de 1917 (février ! pas le putsch d’octobre !), l’allemande de 1919, etc. Jusqu’à l’Espagne de 1936 et surtout la Hongrie de 1956, trop méconnue, où le peuple s’est levé face au totalitarisme bolchévique. Dans tout ce « trésor perdu », pour reprendre une expression de H. Arendt, cette dernière révolution est pour nous la dernière de l’époque moderne parce que c’est la dernière où les gens ont formé des organes de décision populaire, des conseils souverains, dans les usines, les fermes, les administrations, pour instituer l’autogestion en coordonnant tous ces soviets pour supplanter l’État comme unique source de pouvoir. Et on n’a jamais retrouvé ça après.
Donc tous ces épisodes, plus ou moins durables, ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour nous fondamentaux qui assurent, mais qui ne garantissent pas, le pouvoir du plus grand nombre : c’est bien sûr la division du pouvoir (évoquée par Montesquieu et pratiquée par les républiques, mais ici radicalisée) ; la rotation des tâches pour que personne n’incarne durablement une fonction (là aussi l’alternance électorale en étant une forme dégradée) ; la révocation possible des mandatés ; les mandats directs ; le tirage au sort des délégués ; etc. et bien sûr la systématisation des assemblées générales.
Pour nous, ce sont ces assemblées générales qui sont fondamentales, pour des raisons symboliques mais aussi pratiques : c’est le peuple rassemblé qui prend les décisions et peut déléguer son pouvoir à d’autres institutions. Toute notre dernière brochure porte, justement, sur « Ce que pourrait être une société démocratique ». Nous essayons d’y décrire des communes autonomes, coordonnées en réseau et formant des fédérations de plus grandes dimensions. Cela pose de multiples problèmes que nos évoquons, dont la taille, mais qu’il m’est impossible d’aborder ici.
Ces deux grands épisodes civilisationnels où l’on peut voir ce projet d’autonomie à l’œuvre dans l’histoire sont également de grands moments de créativité individuelle et collective, dans tous les domaines : social et politique bien sûr, technique, scientifique, philosophique, artistique, etc. On y voit se succéder à un rythme incroyable des inventions plus originales les unes que les autres, il suffit de comparer sur deux siècles les mœurs, les pratiques, les arts, les savoirs de n’importe quelle civilisation avec ces deux périodes-là pour s’en rendre compte. C’est une explosion de liberté, d’invention, de création, où les individus sont portés par leur société et cherchent à exprimer de mille manières différentes ce qu’est l’humain et ce qu’il est capable de faire.
(…/…)