Internationale Situationniste, « Deux guerres locales
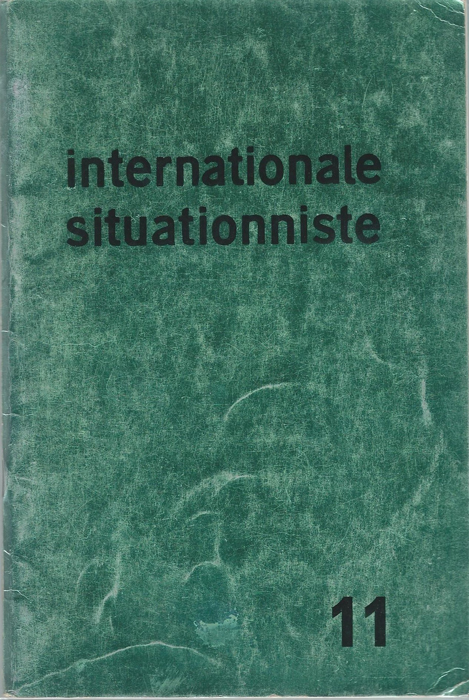
Version imprimable de Deux guerres locales
Internationale Situationniste
Deux guerres locales
(1967)
La guerre israélo-arabe a été un mauvais tour joué par l’histoire moderne à la bonne conscience de gauche, qui communiait dans le grand spectacle de sa protestation contre la guerre du Vietnam. La fausse conscience, qui voyait dans le F.N.L. le champion de la « révolution socialiste » contre l’impérialisme américain, ne put que s’embrouiller et sombrer dans ses insurmontables contradictions, quand il s’est agi de départager Israël et Nasser ; elle n’a pas cependant, à travers ses burlesques polémiques, cessé de proclamer que l’un ou l’autre avait absolument raison, même que telle ou telle de leurs perspectives était révolutionnaire.
C’est qu’en immigrant dans les zones sous-développées, la lutte révolutionnaire était l’objet d’une double aliénation : d’une part, celle d’une gauche impuissante devant un capitalisme surdéveloppé qu’elle ne peut nullement combattre, et, d’autre part, celle des masses laborieuses des pays colonisés, qui ont hérité des restes d’une révolution défigurée et ont dû subir ses tares. L’absence de mouvement révolutionnaire en Europe a réduit la gauche à sa plus simple expression : une masse de spectateurs qui se pâment chaque fois que les exploités des colonies prennent les armes contre leurs maîtres, et ne peut s’empêcher d’y voir le nec plus ultra de la Révolution. De même que l’absence de la vie politique du prolétariat en tant que classe-pour-soi (et pour nous le prolétariat est révolutionnaire ou il n’est rien) a permis à cette gauche de devenir le chevalier de la vertu dans un monde sans vertu. Mais quand elle se lamente et se plaint de « l’ordre du monde » comme étant en conflit avec ses bonnes intentions, et qu’elle maintient ses pauvres aspirations en face de cet ordre, elle est en fait attachée à lui comme à son essence, et si cet ordre lui est ravi et si elle-même s’en exclut elle perd tout. La gauche européenne se montre si pauvre que, comme le voyageur dans le désert aspire à une simple goutte d’eau, elle semble aspirer pour se réconforter seulement au maigre sentiment d’une objection abstraite. À la facilité avec laquelle elle se satisfait peut se mesurer l’étendue de son indigence. Elle est étrangère à l’histoire, autant que le prolétariat est étranger à ce monde ; la fausse conscience est son état naturel, le spectacle son élément, et l’affrontement apparent des systèmes sa référence universelle : toujours et partout où il y a conflit, c’est le bien qui combat le mal, la « Révolution absolue » contre la « Réaction absolue ».
L’adhésion de la conscience spectatrice aux causes étrangères reste irrationnelle, et ses protestations vertueuses s’embourbent dans les méandres de sa culpabilité. La plupart des « Comités Vietnam », en France, ont éclaté pendant la « guerre de six jours » et, aux États-Unis, une partie des groupes de résistance à la guerre au Vietnam ont aussi connu leur vérité. « On ne peut être à la fois pour les Vietnamiens et contre les Juifs menacés d’extermination », s’écrient les uns. « Pouvez-vous lutter contre les Américains au Vietnam en appuyant leurs alliés sionistes agresseurs ? » rétorquent les autres, et on se lance dans des discussions byzantines… Sartre ne s’en est pas relevé. En réalité, ce que condamne tout ce beau monde, il ne le combat pas effectivement, et ce qu’il approuve, il ne le connaît pas. Son opposition à la guerre américaine se confond quasiment toujours avec l’appui inconditionnel au Vietcong, mais en tout cas, pour tous, elle reste spectaculaire. Ceux qui s’opposaient réellement au fascisme espagnol allaient le combattre. Aucun n’est encore parti lutter contre l’« impérialisme yankee ». Tout un étalage de tapis volants s’offre au choix des consommateurs de la participation illusoire : le nationalisme stalino-gaulliste contre l’Américain (la visite de Humphrey a été l’unique occasion où le P.C.F. a manifesté avec les fidèles qui lui restent) ; la vente du Courrier Vietnam, ou des brochures publicitaires de l’État de Ho Chi Minh ; enfin, les manifestations pacifistes. Ni les Provos (avant leur dissolution), ni les étudiants de Berlin n’ont su dépasser ce cadre étroit de « l’action » anti-impérialiste.
L’opposition à la guerre en Amérique est d’emblée plus sérieuse, car elle trouve en face d’elle l’ennemi réel. Cependant, pour une partie de la jeunesse, elle signifie son identification mécanique avec les ennemis apparents de ses ennemis réels : ce qui accentue la confusion d’une classe ouvrière déjà soumise aux pires abrutissements et mystifications, et contribue à la maintenir dans cet état d’esprit « réactionnaire » dont on tire argument contre elle.
Plus importante nous semble la critique de Guevara, parce qu’enracinée dans des luttes authentiques, mais elle pèche par défaut. Le Che est sûrement l’un des derniers léninistes conséquents de notre époque. Toutefois, tel Épiménide, il semble avoir dormi pendant ce dernier demi-siècle, pour croire qu’il y a encore un « camp progressiste », et que celui-ci est étrangement « défaillant ». Ce bureaucratique et romantique révolutionnaire ne voit ainsi dans l’impérialisme que le stade suprême du capitalisme, en lutte contre une société qui est socialiste, même si elle a des défauts.
La déficience de l’U.R.S.S., honteusement reconnue, paraît de plus en plus « naturelle ». Quant à la Chine, selon une déclaration officielle, elle reste « prête à consentir tous les sacrifices nationaux pour soutenir le Vietnam du Nord contre les U.S.A. (à défaut des ouvriers de Hong Kong) et elle constitue l’arrière-garde la plus solide et la plus sûre pour le peuple vietnamien en lutte contre l’impérialisme ». Personne ne doute, en effet, que quand le dernier Vietnamien sera tué, la Chine bureaucratique de Mao sera intacte. (Selon les Izvestia, la Chine et les États-Unis auraient conclu un accord de non-intervention réciproque.)
Ni la conscience manichéenne de la gauche vertueuse, ni la bureaucratie ne sont capables de voir l’unité profonde du monde actuel. La dialectique est leur ennemi commun. La critique révolutionnaire, quant à elle, commence par-delà le bien et le mal ; elle prend ses racines dans l’histoire, et a pour terrain la totalité du monde existant. Elle ne peut, en aucun cas, applaudir un État belligérant, ni appuyer la bureaucratie d’un État exploiteur en formation. Elle doit, avant tout, dévoiler la vérité des conflits actuels, en les rattachant à leur histoire, et démasquer les buts inavoués des forces officiellement en lutte. L’arme de la critique sert de prélude à la critique des armes.
La coexistence pacifique des mensonges bourgeois et bureaucratique a fini par l’emporter sur le mensonge de leurs affrontements ; l’équilibre de la terreur a été rompu à Cuba en 1962 lors de la débandade russe. Depuis, l’impérialisme américain est le maître incontesté du monde. Et il ne peut l’être que par l’agression, car il n’a aucune chance d’avoir un quelconque attrait pour les déshérités, plus facilement tournés vers le modèle russo-chinois. Le capitalisme d’État est la tendance naturelle des sociétés colonisées où l’État se constitue généralement avant les classes – au sens historique du terme. L’élimination totale de ses capitaux et de ses marchandises du marché mondial est justement la menace mortelle qui pèse sur la classe possédante américaine et son économie de libre entreprise ; et la clé de sa fureur agressive.
Depuis la grande crise de 1929, l’intervention de l’État se fait de plus en plus voyante dans les mécanismes du marché ; l’économie ne peut plus fonctionner régulièrement sans les dépenses massives de l’État, principal « consommateur » de toute la production non commerciale (surtout par l’industrie d’armement). Ce qui ne l’empêche pas de rester en crise et d’avoir toujours besoin de l’expansion de son secteur public aux dépens de son secteur privé. Une logique implacable pousse le système vers un capitalisme de plus en plus contrôlé par l’État, engendrant de graves conflits sociaux.
La profonde crise du système américain, c’est son incapacité à produire des profits à l’échelle sociale, d’une façon suffisante. Il doit donc réussir, à l’extérieur, ce qu’il ne peut faire chez lui, c’est-à-dire augmenter la masse des profits proportionnellement à la masse des capitaux existants. La classe possédante, qui possède aussi plus ou moins l’État, compte sur ses entreprises impérialistes pour réaliser ce rêve dément. Pour cette classe, le capitalisme d’État signifie la mort, tout autant que le communisme ; c’est pourquoi elle est par essence incapable d’y voir une quelconque différence.
Le fonctionnement artificiel de l’économie monopoliste comme « économie de guerre » assure, pour le moment, à la politique de la classe dirigeante, l’appui bienveillant des ouvriers, qui profitent du plein-emploi et d’une abondance spectaculaire : « Actuellement, la proportion de la main-d’œuvre affectée à des tâches intéressant la défense nationale représente 5,2 % de la main-d’œuvre américaine totale, contre 3,9 % il y a deux ans […]. Le nombre des emplois civils dans le domaine de la défense nationale est passé de 3 000 000 à 4 100 000 environ en deux ans » (Le Monde du 17-9-67). En attendant, le capitalisme de marché sent obscurément qu’en étendant son contrôle territorial il atteindra une expansion accélérée capable de contrebalancer les exigences toujours croissantes de la production non profitable. La défense acharnée des régions du monde « libre » où ses intérêts sont souvent minimes (en 1959, les investissements américains au Vietnam du Sud ne dépassaient pas les 50 millions de dollars) correspond à une stratégie qui, à long terme, pense arriver à transformer les dépenses militaires en simples frais d’exploitation, assurant aux États-Unis non seulement un marché, mais le contrôle monopolistique des moyens de production de la plus grande partie du globe. Mais tout contrecarre ce projet. D’une part, les contradictions internes du capitalisme privé : des intérêts particuliers s’opposent à cet intérêt général de la classe possédante dans son ensemble, tels les groupes qui s’enrichissent à court terme des commandes d’État (avec, en tête, les fabricants d’armes), tels les entreprises monopolistes qui répugnent à investir dans des pays sous-développés, où la productivité est très basse en dépit d’une main-d’œuvre à bon marché, au lieu de le faire dans la partie avancée du monde – et surtout en Europe, toujours largement plus rentable que l’Amérique saturée. D’autre part, il se heurte aux intérêts immédiats des masses déshéritées, dont le premier mouvement ne peut être que l’élimination de leurs couches exploiteuses, seules capables d’assurer aux U.S.A. une quelconque infiltration.
Le Vietnam n’est, pour le moment, selon Rostow, spécialiste de la « croissance » au Département d’État, que le champ d’expérience de cette vaste stratégie – appelée à se multiplier – qui, pour assurer sa paix exploiteuse, doit commencer par une guerre destructrice – qui n’a pas grande chance d’aboutir. L’agressivité de l’impérialisme américain n’est donc nullement une aberration d’un mauvais gouvernement, mais une nécessité pour les relations de classes du capitalisme privé, qui, si un mouvement révolutionnaire ne vient pas y mettre un terme, évolue inexorablement vers un capitalisme technocratique d’État. C’est dans ce cadre général de l’économie mondiale restée non-dominée qu’il faut insérer l’histoire des luttes aliénées de notre époque.
La destruction des vieilles structures « asiatiques » par la pénétration coloniale amena, d’une part, la naissance d’une nouvelle couche urbaine et, d’autre part, la paupérisation accrue de larges fractions de la paysannerie surexploitée. C’est la rencontre de ces deux forces sociales qui constitua le moteur principal de tout le mouvement vietnamien. Parmi les couches urbaines – petites-bourgeoises, et même bourgeoises – se formèrent en effet les premiers noyaux nationalistes, et le cadre de ce qui allait être, à partir de 1930, le Parti communiste indochinois. L’adhésion à l’idéologie bolchevik (dans sa version stalinienne), doubla le programme purement nationaliste d’un programme essentiellement agraire, et permit au P.C.I. de devenir le principal dirigeant de la lutte anti-coloniale, et d’encadrer la grande masse des paysans spontanément insurgés. Les « soviets paysans » de 1931 furent la première manifestation de ce mouvement, mais, en rattachant son sort à celui de la IIIe Internationale, le P.C.I. se soumit à toutes les vicissitudes de la diplomatie stalinienne, et aux fluctuations des intérêts nationaux et étatiques de la bureaucratie russe. À partir du septième Congrès du Comintern (août 1935) « la lutte contre l’impérialisme français » disparut du programme et fut bientôt remplacée par la lutte contre le puissant parti trotskiste. « En ce qui concerne les trotskistes, pas d’alliances ni de concessions ; ils doivent être démasqués pour ce qu’ils sont : les agents du fascisme » (Rapport de Ho Chi Minh au Comintern, juillet 1939). Le traité germano-soviétique et l’interdiction des P.C. de France et d’outre-mer permirent au P.C.I. de changer de direction : « Notre parti trouve que c’est une question de vie ou de mort… de lutter contre la guerre impérialiste et la politique de piraterie et de massacre de l’impérialisme français (lire : contre l’Allemagne nazie)… mais nous lutterons, en même temps, contre les buts agressifs du fascisme japonais ».
Vers la fin de la deuxième guerre mondiale, avec l’aide effective des Américains, le Vietminh contrôlait la plus grande partie du territoire, et était reconnu par la France comme l’unique représentant de l’Indochine. C’est à ce moment que Ho préféra « renifler un peu la crotte française plutôt que de manger toute la vie celle des Chinois », et signa, pour faciliter la tâche de ses camarades-maîtres, le monstrueux compromis de mars 1946, qui reconnut le Vietnam à la fois comme « État libre » et comme « faisant partie de la Fédération indochinoise de l’Union française ». Ce compromis permit à la France de reconquérir une partie du pays et d’engager, en même temps que les staliniens perdaient leur part du pouvoir bourgeois en France, une guerre de huit ans, au bout de laquelle le Vietminh livrait le Sud aux couches les plus rétrogrades de la société vietnamienne et à leurs protecteurs, les Américains, et gagnait définitivement le Nord. Après avoir procédé à l’élimination systématique des éléments révolutionnaires qui restaient (le dernier leader trotskiste, Ta Tu Thau, a été assassiné dès 1946), la bureaucratie vietminh installa son pouvoir totalitaire sur la paysannerie, et amorça l’industrialisation du pays dans le cadre d’un capitalisme d’État. L’amélioration du sort des paysans, consécutive à leurs conquêtes pendant la longue lutte de libération, devait, dans la logique bureaucratique, être mise au service de l’État naissant ; dans le sens d’une meilleure productivité dont il restait le maître incontesté. L’application autoritaire de la réforme agraire donna lieu, en 1956, à de violentes insurrections et à une sanglante répression (surtout dans la province même de Ho Chi Minh). Les paysans qui ont porté la bureaucratie au pouvoir se trouvaient être ses premières victimes. Une « orgie d’autocritiques » tenta, pendant plusieurs années, de faire oublier cette « grave erreur ».
Mais les mêmes accords de Genève permirent aux Diem d’installer, au sud du 17e parallèle, un État bureaucratique, féodal et théocratique, au service des propriétaires terriens et de la bourgeoisie compradore. Cet État allait, en l’espace de quelques années, liquider toutes les acquisitions de la paysannerie, par quelques « réformes agraires » appropriées, et les paysans du Sud, dont une partie n’avait jamais déposé les armes, allaient retomber sous la coupe de l’oppression et de la surexploitation. C’est la deuxième guerre du Vietnam. Là aussi, la masse des paysans insurgés, qui reprennent les armes contre les mêmes ennemis, retrouvent les mêmes chefs. Le Front national de libération succède au Vietminh, héritant à la fois de ses qualités et de ses lourds défauts. En se faisant le champion de la lutte nationale et de la guerre paysanne, le F.N.L. a, dès le début, gagné la campagne, et en a fait la base principale de la résistance armée. Ce sont ses victoires successives sur l’armée officielle qui ont provoqué l’intervention de plus en plus massive des Américains, jusqu’à réduire le conflit à une guerre coloniale ouverte, où les Vietnamiens se trouvent opposés à l’armée d’invasion. Sa résolution dans la lutte, son programme nettement anti-féodal et ses perspectives unitaires restent les principales qualités du mouvement. En aucune manière la lutte du F.N.L. ne sort du cadre classique des luttes de libération nationale, et son programme reste basé sur un compromis d’une vaste coalition de classes, dominée par l’unique objectif de liquider l’agression américaine (ce n’est pas par hasard qu’il rejette la dénomination Vietcong – id est communistes vietnamiens – pour insister sur son caractère national). Ses structures sont celles d’un État en formation, puisque déjà dans les zones qu’il contrôle il lève des impôts et institue le service militaire obligatoire.
Ces qualités minimum dans la lutte, les objectifs et les intérêts sociaux qu’ils expriment, restent totalement absents dans l’affrontement qui oppose Israël aux Arabes. Les contradictions spécifiques du sionisme, comme celles de la société arabe morcelée, s’ajoutent dans la confusion générale.
Dès ses origines, le mouvement sioniste était le contraire de la solution révolutionnaire de ce qu’on appelait la question juive. Produit direct du capitalisme européen, il visait non le bouleversement d’une société qui avait besoin de persécuter les Juifs, mais la création d’une entité nationale juive qui serait à l’abri des aberrations antisémites du capitalisme décadent ; non l’abolition de l’injustice, mais son transfert. Ce qui constitue le péché originel du sionisme, c’est d’avoir toujours raisonné comme si la Palestine était une île déserte. Le mouvement ouvrier révolutionnaire voyait la solution de la question juive dans la communauté prolétarienne, c’est-à-dire la destruction du capitalisme et de « sa religion, le judaïsme », l’émancipation du Juif ne pouvant se faire en dehors de l’émancipation de l’homme. Le sionisme partait de l’hypothèse inverse. Certes, le développement contre-révolutionnaire de ce demi-siècle lui a donné raison, mais de la même manière que le développement du capitalisme européen a donné raison aux thèses réformistes de Bernstein. Le succès du sionisme, et corollairement la création de l’État d’Israël, n’est qu’un avatar du triomphe de la contre-révolution mondiale. Au « socialisme dans un seul pays » pouvait faire écho « justice pour un seul peuple » et « égalité dans un seul kibboutz ». C’est avec les capitaux de Rothschild qu’on a organisé la colonisation de la Palestine, et c’est grâce à la plus-value européenne qu’on a lancé les premiers kibboutzim. Les Juifs recréaient alors pour eux tout ce dont ils étaient victimes : le fanatisme et la ségrégation. Ceux qui souffraient de n’être que tolérés dans leur société, allaient lutter pour devenir, ailleurs, des propriétaires disposant du droit de tolérer les autres. Le kibboutz n’était pas un dépassement révolutionnaire de la « féodalité » palestinienne, mais une formule mutualiste d’auto-défense des travailleurs-colons juifs contre les tendances d’exploitation capitaliste de l’Agence Juive. Parce qu’elle était le principal propriétaire juif de Palestine, l’Organisation Sioniste se définissait comme l’unique représentant des intérêts supérieurs de « la Nation Juive ». Si elle a fini par céder le droit à une certaine autogestion, c’est qu’elle s’était assurée que celle-ci serait fondée sur le refoulement systématique du paysan arabe.
Quant à la Histadrut, elle était, dès sa création en 1920, soumise à l’autorité du sionisme mondial, c’est-à-dire le contraire même de l’émancipation des travailleurs. Les travailleurs arabes en étaient statutairement exclus, et son activité consistait souvent à interdire aux entreprises juives de les employer.
Le développement de la lutte triangulaire entre Arabes, sionistes et Anglais, allait tourner au profit des seconds ; grâce à la paternité active des Américains (à partir de la deuxième guerre mondiale) et à la bénédiction de Staline (qui voyait en Israël la constitution du premier bastion « socialiste » au Moyen-Orient, mais voulait par là même se débarrasser de quelques Juifs encombrants), le rêve herzlien ne tarda pas à se concrétiser, et l’État juif fut arbitrairement proclamé. La récupération de toutes les formes « progressives » d’organisation sociale, et leur intégration à l’idéal sioniste, permit dès lors aux plus « révolutionnaires » de travailler, la conscience tranquille, à l’édification de l’État bourgeois, militariste et rabbinique qu’est devenu l’Israël moderne. Le sommeil prolongé de l’internationalisme prolétarien a encore une fois engendré un monstre. L’injustice fondamentale commise contre les Arabes de Palestine se retourna aussitôt contre les Juifs eux-mêmes : l’État du peuple élu n’était rien d’autre qu’une vulgaire société de classes, où s’étaient reconstituées toutes les anomalies des vieilles sociétés (divisions hiérarchiques, oppositions ethniques entre Ashkénazes et Séphardites, persécutions racistes de la minorité arabe, etc.). La centrale syndicale y retrouva sa fonction normale d’intégrer les ouvriers à une économie capitaliste, dont elle est devenue le principal propriétaire. Elle emploie plus de salariés que n’en possède l’État lui-même. Elle constitue actuellement la tête de pont de l’expansion impérialiste du jeune capitalisme israélien (« Solel Boneh », importante succursale en bâtiment de la Histadrut, a investi 180 millions de dollars en Afrique et en Asie en 1960-1966, et emploie actuellement 12 000 ouvriers africains).
Et comme l’État n’aurait jamais pu voir le jour sans l’intervention directe de l’impérialisme anglo-américain et l’aide massive du capitalisme financier juif, il ne peut aujourd’hui équilibrer son économie artificielle qu’avec l’aide des mêmes forces qui l’ont créé (le déficit de la balance des paiements est égal à 600 millions de dollars, c’est-à-dire plus que le revenu moyen d’un travailleur arabe par tête d’habitant israélien). Dès l’installation des premières colonies d’immigrés, les Juifs constituaient, parallèlement à la société arabe économiquement et socialement attardée, une société moderne de type européen ; la proclamation de l’État n’a fait qu’achever ce processus par l’expulsion pure et simple des éléments du retard. Israël est, de par son être, le bastion de l’Europe au cœur d’un monde afro-asiatique. Ainsi est-il devenu doublement étranger : à la population arabe, réduite à l’état permanent de réfugiés ou de minorité colonisée, et à la population juive qui y avait vu un moment la réalisation terrestre de toutes les idéologies égalitaires.
Mais ceci n’est pas dû aux seules contradictions de la société israélienne ; dès le début, cette situation n’a cessé de s’aggraver, du fait de son entretien par l’environnement arabe, incapable jusqu’à présent d’y apporter un début de solution effective.
Dès le début du mandat britannique, la résistance arabe en Palestine a été entièrement dominée par la classe possédante, c’est-à-dire par les classes dirigeantes arabes d’alors, et leurs protecteurs britanniques. L’accord Sykes-Picot a mis fin à tous les espoirs du nationalisme arabe naissant, et soumis la région, savamment morcelée, à une domination étrangère qui est loin d’être achevée. Les mêmes couches qui assuraient la servitude des masses arabes à l’Empire Ottoman passèrent au service de l’occupation britannique, et se firent les complices de la colonisation sioniste (par la vente, à des prix très élevés, de leurs terres). Le retard de la société arabe ne permettait pas encore l’émergence de nouvelles directions plus avancées, et les soulèvements populaires spontanés retrouvaient chaque fois les mêmes récupérateurs : les notabilités « féodales-bourgeoises » et leur marchandise, l’union nationale.
L’insurrection armée de 1936-1939, et la grève générale de six mois (la plus longue de l’histoire) ont été décidées et exécutées en dépit de l’opposition de toutes les directions des partis « nationalistes ». Spontanément organisées, elles ont connu une vaste ampleur ; ce qui a obligé la classe dirigeante à s’y rallier et, du coup, à prendre la direction du mouvement. Mais c’était pour y mettre un frein, le conduire à la table des négociations et aux compromis réactionnaires. Seule la victoire de ce soulèvement dans ses ultimes conséquences aurait pu à la fois liquider le mandat britannique et le projet sioniste de constituer un État juif. Son échec annonçait, a contrario, les futures catastrophes, et en définitive la défaite de 1948.
Celle-ci a sonné le glas de la « bourgeoisie-féodalité » comme classe dirigeante du mouvement arabe. Elle a été l’occasion pour la petite-bourgeoisie d’émerger au pouvoir et de constituer, avec les cadres de l’armée défaite, le moteur du mouvement actuel. Son programme était simple : l’unité, une certaine idéologie socialiste et la libération de la Palestine (le Retour). L’agression tripartite de 1956 lui a fourni la meilleure occasion de se consolider en tant que classe dominante, et de découvrir un leader-programme en la personne de Nasser, proposé à l’admiration collective des masses arabes dépossédées de tout. C’était leur religion et leur opium. Seulement, la nouvelle classe exploiteuse avait ses intérêts propres, et ses buts autonomes. Les mots d’ordre qui ont fait la popularité du régime bureaucratique militaire d’Égypte étaient mauvais en eux-mêmes, et il était incapable de les réaliser. L’unité arabe et la destruction d’Israël (tour à tour invoquée comme liquidation de l’État usurpateur, et comme rejet pur et simple de sa population à la mer) étaient au centre de cette idéologie-propagande.
Ce qui a inauguré la décadence de la petite-bourgeoisie arabe et de son pouvoir bureaucratique, ce sont tout d’abord ses propres contradictions internes, et la superficialité de ses options (Nasser, le Baas, Kassem et les partis dits communistes n’ont pas cessé de lutter les uns contre les autres, à travers les compromissions et les alliances avec les forces les plus louches).
Vingt ans après la première guerre de Palestine, cette nouvelle couche vient de prouver son incapacité totale de résoudre le problème palestinien. Elle a vécu par la surenchère démente, car seul l’entretien permanent du prétexte israélien lui permettait de survivre, impuissante qu’elle était à apporter une quelconque solution radicale aux innombrables problèmes intérieurs : le problème palestinien reste la clé des bouleversements arabes. C’est autour de lui que les conflits tournent, et en lui que tout le monde communie. Il est la base de la solidarité objective de tous les régimes arabes. Il réalise « l’Union sacrée » entre Nasser et Hussein, Fayçal et Boumedienne, le Baas et Aref.
La dernière guerre est venue dissiper toutes les illusions. La rigidité absolue de « l’idéologie arabe » a été pulvérisée au contact de la réalité effective tout aussi dure, mais permanente. Ceux qui parlaient de faire la guerre ne la voulaient ni ne la préparaient, et ceux qui ne parlaient que de se défendre préparaient effectivement l’offensive. Chacun des deux camps suivait sa propre pente ; la bureaucratie arabe, celle du mensonge et de la démagogie, les maîtres d’Israël, celle de l’expansion impérialiste. C’est en tant qu’élément négatif que la guerre de six jours a eu une importance capitale, puisqu’elle a révélé toutes les faiblesses et les tares secrètes de ce qu’on a voulu présenter comme « la révolution arabe ». La « puissante » bureaucratie militaire égyptienne s’est effritée en deux jours, dévoilant tout d’un coup la vérité de ses réalisations : le pivot autour duquel se sont opérées toutes les transformations socio-économiques, l’armée, est resté fondamentalement le même. D’une part, elle prétendait tout changer en Égypte (et même dans toute la zone arabe), et d’une autre elle faisait tout pour que rien ne change en son sein, en ses valeurs et habitudes. L’Égypte nassérienne est encore dominée par les forces pré-nassériennes, sa « bureaucratie » est un magma sans cohérence ni conscience de classe, que seule l’exploitation et le partage de la plus-value sociale unit.
Quant à l’appareil politico-militaire qui gouverne la Syrie baasiste, il s’enferme de plus en plus dans l’extrémisme de son idéologie. Seulement, sa phraséologie ne trompe plus personne (à part Pablo !) ; tout le monde sait qu’il n’a pas fait la guerre, et qu’il a livré le front sans résistance, puisqu’il a préféré garder les meilleures troupes à Damas pour sa propre défense. Ceux qui consommaient 65 % du budget syrien pour défendre le territoire ont définitivement démasqué leur cynique mensonge.
Enfin, elle a une dernière fois montré, à ceux qui en avaient encore besoin, que l’Union sacrée avec les Hussein ne pouvait conduire qu’à la catastrophe. La Légion Arabe s’est retirée dès le premier jour, et la population palestinienne, qui a subi pendant vingt ans la terreur policière de ses bourreaux, s’est trouvée désarmée et désorganisée devant les forces d’occupation. Le trône hachémite, depuis 1948, s’était partagé la colonisation des Palestiniens avec l’État sioniste. En désertant la Cisjordanie, il livrait à celui-ci les dossiers établis par la police sur tous les éléments révolutionnaires palestiniens. Mais les Palestiniens ont toujours su qu’il n’y avait pas une grande différence entre les deux colonisations, et se sentent aujourd’hui plus à l’aise dans leur résistance à la nouvelle occupation.
De l’autre côté, Israël est devenu tout ce que les Arabes, avant la guerre, lui reprochaient d’être : un État impérialiste se conduisant comme les forces d’occupation les plus classiques (terreur policière, dynamitage des maisons, loi martiale permanente, etc.). Et à l’intérieur se développe un délire collectif dirigé par les rabbins pour « le droit imprescriptible d’Israël aux frontières bibliques ». La guerre est venue arrêter tout le mouvement de contestation qu’engendraient les contradictions de cette société artificielle (en 1966, il y a eu quelques dizaines d’émeutes, et pas moins de 277 grèves pour la seule année 1965) ; et provoquer une adhésion unanime autour des objectifs de la classe dominante, et de son idéologie la plus extrémiste. Elle a servi par ailleurs à renforcer tous les régimes arabes non impliqués dans l’affrontement armé. Boumedienne put ainsi, à 5 000 km, participer, quiètement, à la surenchère, et faire applaudir son nom par la foule algérienne devant laquelle il n’osait même pas se présenter la veille ; enfin obtenir l’appui d’une O.R.P. complètement stalinisée (« pour sa politique anti-impérialiste »). Fayçal, contre quelques millions de dollars, obtient l’abandon du Yémen républicain et la consolidation de son trône – et on en passe.
Comme toujours la guerre, quand elle n’est pas civile, ne peut que geler le processus de la révolution sociale ; au Nord-Vietnam, elle provoque l’adhésion, jamais obtenue, de la masse paysanne à la bureaucratie qui l’exploite. En Israël, elle liquide pour une longue période toute opposition au sionisme, et dans les pays arabes c’est le renforcement – momentané – des couches les plus réactionnaires. En aucune façon les coulants révolutionnaires ne peuvent s’y reconnaître. Leur tâche est à l’autre bout du mouvement actuel, car elle doit en être la négation absolue.
Il est évidemment impossible de chercher, aujourd’hui, une solution révolutionnaire à la guerre du Vietnam. Il s’agit avant tout de mettre fin à l’agression américaine, pour laisser se développer, d’une façon naturelle, la véritable lutte sociale du Vietnam, c’est-à-dire permettre aux travailleurs vietnamiens de retrouver leurs ennemis de l’intérieur : la bureaucratie du Nord et toutes les couches possédantes et dirigeantes du Sud. Le retrait des Américains signifie immédiatement la prise en main, par la direction stalinienne, de tout le pays : c’est la solution inéluctable. Car les envahisseurs ne peuvent indéfiniment prolonger leur agression ; on sait depuis Talleyrand qu’on peut faire n’importe quoi avec des baïonnettes sauf s’asseoir dessus. Il ne s’agit donc pas de soutenir inconditionnellement (ou d’une façon critique) le Vietcong, mais de lutter avec conséquence et sans concessions contre l’impérialisme américain. Le rôle le plus efficace est actuellement celui des révolutionnaires américains qui prônent et pratiquent l’insoumission à une très large échelle (devant laquelle la résistance à la guerre d’Algérie, en France, est un jeu d’enfant). C’est que la racine de la guerre du Vietnam se trouve en Amérique même, et c’est là qu’il faut l’extirper.
Au contraire de la guerre américaine, la question palestinienne n’a pas de solution immédiatement perceptible. Aucune solution à court terme n’est praticable. Les régimes arabes ne peuvent que s’écrouler sous le poids de leurs contradictions, et Israël sera de plus en plus prisonnier de sa logique coloniale. Tous les compromis que les grandes puissances et leurs alliés respectifs essaient de rafistoler ne peuvent, de toutes les façons, qu’être contre-révolutionnaires. Le statu quo bâtard – ni paix, ni guerre – va probablement prédominer pour une longue période, pendant laquelle les régimes arabes connaîtront le sort de leurs prédécesseurs de 1948 (et probablement au profit des forces franchement réactionnaires dans un premier temps). La société arabe qui a secrété toutes sortes de classes dominantes, caricatures de toutes les classes historiquement connues, doit maintenant secréter les forces qui porteront sa subversion totale. La bourgeoisie dite nationale et la bureaucratie arabe ont hérité de toutes les tares de ces deux classes, sans avoir jamais connu leurs réalisations historiques dans les autres sociétés. Les futures forces révolutionnaires arabes, qui doivent naître sur les décombres de la défaite de juin 1967, sauront qu’elles n’ont rien de commun avec aucun des régimes arabes existants, ni rien à respecter des pouvoirs constitués qui dominent le monde actuel. C’est en elles-mêmes et dans les expériences refoulées de l’histoire révolutionnaire qu’elles trouveront leur modèle. La question palestinienne est trop sérieuse pour être laissée aux États, c’est-à-dire aux colonels. Elle touche de trop près les deux questions fondamentales de la révolution moderne, à savoir l’internationalisme et l’État, pour qu’aucune force existante puisse lui apporter la solution adéquate. Seul un mouvement révolutionnaire arabe résolument internationaliste et anti-étatique, peut à la fois dissoudre l’État d’Israël et avoir pour lui la masse de ses exploités. Seul, par le même processus, il pourra dissoudre tous les États arabes existants et créer l’unification arabe par le pouvoir des Conseils.
Cahier de l’I.S. n° 11, Paris, octobre 1967
Version originale de Deux guerres locales
Version anglaise sur le site de Ken Knabb
Tous les cahiers de l’IS sont consultables et téléchargeables sur ce site
Source : Internationale Situationniste, « Deux guerres locales | «Les Amis de Bartleby

