Le Russie-gate, ce n’est pas le Watergate ou l’Iran-Contra, par Robert Parry
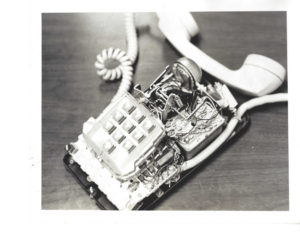
Source : Robert Parry, Consortium News, 28-06-2017
On a beaucoup comparé le Russie-gate aux scandales plus anciens du Watergate et de l’Iran-Contra, mais les ressemblances sont au mieux superficielles, explique Robert Parry.
Le Russie-gate, cette enquête tentaculaire sur l’implication de la Russie dans l’élection américaine de l’an dernier, est souvent comparé aux deux grands scandales politiques de la seconde moitié du XXe siècle, le Watergate et l’Iran-Contra. Parfois, on entend même dire que le Russie-gate « est plus gros que le Watergate ».
Pourtant, ce qui est peut-être plus frappant au sujet de ces deux scandales du XXe siècle est à quel point les officiels de Washington semblent ne pas les comprendre, et à quel point ces précédentes affaires, au lieu de leur ressembler, contrastent avec les événements qui se déroulent aujourd’hui.
Bien que le récit historique sur le Watergate et l’Iran-Contra soit encore incomplet, les preuves disponibles indiquent que les deux scandales proviennent des manigances des Républicains visant à impliquer des dirigeants étrangers dans des machinations afin de compromettre des présidents démocrates en fonction, et d’ouvrir ainsi la voie aux élections de Richard Nixon en 1968 et de Ronald Reagan en 1980.
Dans le cas du Russie-gate, même en admettant que le gouvernement russe ait piraté les e-mails des Démocrates et les ait publiés via WikiLeaks, il n’y a toujours aucune preuve que Donald Trump ou son équipe de campagne aient comploté avec le Kremlin à cet effet. À l’inverse, aux origines du Watergate et de l’Iran-Contra, il apparaît que les campagnes de Nixon et de Reagan, respectivement, étaient à l’origine de manigances pour pousser des gouvernements étrangers à bloquer un accord de paix au Vietnam en 1968 et des négociations pour libérer 52 otages américains en Iran en 1980.
Quand bien même le Watergate fut directement associé à la campagne de 1972 — lorsque l’équipe de cambrioleurs de Nixon fut surprise dans les bureaux du Comité national démocrate, dans le bâtiment du Watergate — Nixon forma cette équipe, connue sous le nom de Plombiers, par crainte d’être démasqué dans ses manœuvres pour faire capoter les pourparlers de paix au Vietnam menés par le Président Lyndon Johnson en 1968, dans le but d’assurer son élection à la Maison-Blanche cette année-là.
Après la victoire serrée de Nixon contre le vice-président Hubert Humphrey à l’élection de 1968, le directeur du FBI J. Edgar Hoover informa Nixon que Johnson avait un dossier secret, contenant des interceptions téléphoniques, qui détaillaient les communications officieuses de la campagne de Nixon avec des représentants Sud-vietnamiens, pour les convaincre de boycotter les négociations de paix de Paris menées par Johnson. Plus tard, Nixon apprit que ce dossier compromettant avait disparu de la Maison-Blanche.
Alors, en 1971, après la fuite des Pentagon Papers qui relataient les mensonges utilisés pour justifier la guerre du Vietnam jusqu’en 1967, Nixon craignait que le dossier manquant détaillant ses manœuvres sur les pourparlers de paix de 1968 pût également refaire surface, et qu’il puisse le détruire politiquement. Il mit donc sur pied l’équipe des Plombiers pour trouver le dossier, allant même jusqu’à envisager le bombardement incendiaire de la Brookings Institution [un des premiers think-tanks, NdT] pour permettre de fouiller son coffre-fort dans lequel certains adjoints pensaient que le dossier pouvait se trouver.
Autrement dit, le Watergate ne fut pas juste une effraction au Comité national démocrate, le 17 juin 1972, afin de trouver des renseignements politiques utiles, ni le camouflage subséquent de Nixon. L’affaire naquit d’un scandale bien pire, le sabotage de pourparlers de paix qui auraient pu mettre fin à la guerre du Vietnam des années plus tôt et sauver la vie de dizaines de milliers de soldats américains et probablement de plus d’un million de Vietnamiens.
Les parallèles avec l’Iran-Contra
De manière analogue, le scandale de l’Iran-Contra explosa en 1986, révélant que le Président Reagan avait autorisé la vente secrète d’armes à l’Iran et qu’une partie des profits avait servi à financer les rebelles Contra nicaraguayens. Les preuves indiquent aujourd’hui que les relations entre l’équipe de Reagan et le régime révolutionnaire iranien remontaient à 1980, quand des émissaires de la campagne de Reagan œuvrèrent à contrecarrer les négociations du Président Jimmy Carter pour libérer 52 otages américains alors détenus en Iran.
D’après plusieurs témoins, parmi lesquels l’ancien Secrétaire d’État adjoint pour les affaires au Moyen-Orient Nicholas Veliotes, les contacts pré-électoraux conduisirent à l’ouverture, après que Reagan eut prêté serment le 20 janvier 1981, d’une filière d’armement vers l’Iran (via Israël) au moment précis où l’Iran libérait enfin les otages américains après 444 jours de détention.
Certains des acteurs clés des contacts entre Reagan et l’Iran en 1980 réapparaissaient quatre ans plus tard au démarrage en 1985 de livraisons directes (toujours secrètes) d’armes américaines à l’Iran, en transitant à nouveau par des intermédiaires israéliens. Parmi ces acteurs clés se trouvaient l’agent iranien de la CIA Cyrus Hashemi, l’ancien directeur des opérations clandestines de la CIA Theodore Shackey, le directeur de campagne de Reagan alors directeur de la CIA, William Casey, et l’ancien directeur de la CIA alors vice-président, George H. W. Bush.
En d’autres termes, les livraisons d’armes de l’Iran-Contra de 1985-1986 semblent avoir été un prolongement de livraisons plus anciennes, datant de 1980, et qui perdurèrent sous l’égide israélienne jusqu’à ce que la filière d’approvisionnement fût reprise plus directement par l’administration Reagan en 1985-1986.
Ainsi, le scandale du Watergate de 1972 et l’affaire Iran-Contra de 1986 pourraient être considérés comme des « suites » des complots plus anciens conduits par la soif républicaine de s’emparer des pouvoirs colossaux de la présidence des États-Unis. Pourtant, et ce depuis des décennies, le Tout-Washington officiel s’est opposé à ces explications sous-jacentes des débuts du Watergate et de l’Iran-Contra.
Par exemple, le New York Times, le soi-disant « journal de référence », traita l’accumulation de preuves concernant les manœuvres de Nixon sur les pourparlers de paix de 1968 comme une simple « rumeur » jusqu’à ce qu’au début de cette année, un chercheur, John A. Farell, eût mis au jour des notes sibyllines prises par l’assistant de Nixon, H. R. Haldeman, qui ajoutèrent une pierre à l’édifice, ne laissant guère d’autre choix au Times que de déclarer la réalité historique comme finalement vraie.
Comprendre le récit du Watergate
Malgré tout, le Times ainsi que d’autres organes de presses de premier plan ont omis d’intégrer cette admission faite du bout des lèvres dans le récit élargi du Watergate. Si vous comprenez que Nixon a bel et bien saboté les pourparlers de paix au Vietnam du Président Johnson et que Nixon était au courant que le dossier de Johnson sur ce que celui-ci nommait « la trahison » de Nixon avait disparu de la Maison-Blanche, les premières « cassettes du Watergate » de 1971 prennent soudainement tout leur sens.
Nixon ordonna au chef de cabinet à la Maison-Blanche H. R. « Bob » Haldeman et au conseiller à la Sécurité nationale Henry Kissinger de localiser le dossier disparu, mais leurs recherches furent vaines. Cependant, certains assistants de Nixon pensaient que le dossier pouvait être caché à la Brookings Institution, une cellule de réflexion libérale de Washington. Dans sa recherche désespérée du dossier, Nixon plaida ainsi pour une effraction chez Brookings, même éventuellement un bombardement incendiaire du bâtiment pour servir de couverture à son équipe de cambrioleurs afin qu’ils pussent se faufiler dans la confusion générale et dévaliser le coffre.
L’ancienne explication selon laquelle Nixon cherchait simplement à mettre la main sur des documents relatifs à la fin du bombardement du Vietnam par Johnson, dans le contexte pré-électoral de 1968 n’a jamais tenu étant donné les mesures extrêmes que Nixon était prêt à prendre.
Les extraits pertinents des enregistrement de la Maison-Blanche de Nixon incluent un passage du 17 juin 1971, coïncidence, un an jour pour jour avant que les cambrioleurs du Watergate ne fussent appréhendés. Nixon avait convoqué Haldeman et Kissinger dans le Bureau ovale, les implorant de nouveau de mettre la main sur le dossier.
« Est-ce qu’on l’a ? » demande Nixon à Haldeman. « J’ai demandé à l’avoir. Vous avez dit que vous ne l’aviez pas. »
Haldeman : « Nous n’arrivons pas à le trouver. »
Kissinger : « Nous n’avons rien ici, monsieur le Président »
Nixon : « Mais, merde, je l’ai demandé parce que j’en ai besoin. »
Kissinger : « Mais Bob et moi essayons de résoudre ce satané machin. »
Hadleman : « Nous avons un historique basique à force de construire le nôtre, mais il y a un dossier là-dessus. »
Nixon : « Où ça ? »
Haldeman : « [L’assistant au président Tom Charles] Huston jure par ses grands dieux qu’il y a un dossier sur ça, et qu’il est à Brookings. »
Nixon : « Bob ? Bob ? Alors tu te souviens du plan de Huston [pour des casses commandités par la Maison-Blanche à des fins d’opérations domestiques de contre-espionnage] ? Mets ça en route. »
Kissinger : « Brookings n’a aucun droit d’avoir des dossiers classés »
Nixon : « Je veux que ça se fasse. Bordel, tu rentres et tu récupères ces fichiers. Tu fais exploser le coffre et tu le récupères. »
Haldeman : « Ils ont très bien pu s’en débarrasser depuis, mais pour faire ça, vous devez… »
Kissinger : « Je ne serais pas surpris si Brookings avait les documents. »
Haldeman : « Ce que je veux dire c’est que Johnson sait que ces documents sont dans les parages. Il ne sait pas avec certitude qu’on ne les a pas. »
Mais Johnson savait en fait que le dossier n’était plus à la Maison-Blanche car il avait ordonné à son conseiller à la Sécurité nationale, Walt Rostow, de le retirer dans les derniers jours de sa présidence.
La formation des cambrioleurs
Le 30 juin 1971, Nixon sermonna une nouvelle fois Hadleman sur le besoin de pénétrer chez Brookings et de « le [le dossier] retirer ». Nixon suggéra de faire appel à l’ancien officier de la CIA, E. Howard Hunt, pour effectuer le casse de la Brookings.
« Parle avec Hunt » dit Nixon à Hadleman. « Je veux ce casse. Bordel, qu’ils le fassent. Vous rentrez là-bas, vous raflez les fichiers, et vous les ramenez. Vous rentrez et vous le prenez, c’est tout. Allez-y vers 8 ou 9 heures. »
Haldeman : « On fait une inspection du coffre. »
Nixon : « C’est ça. Vous allez inspecter le coffre. Je veux dire, le nettoyer. »
Pour des raisons qui restent obscures, il semble que le casse de la Brookings n’eut jamais lieu (de même que le bombardement incendiaire), mais l’empressement désespéré de Nixon à faire main-basse sur le dossier des pourparlers de paix de Johnson fut un élément important dans la succession d’événements qui menèrent à la création par Nixon de son équipe de cambrioleurs sous le contrôle de Hunt. Plus tard, Hunt supervisa les deux effractions de mai et juin 1972.
Bien qu’il soit possible que Nixon était toujours à la recherche du dossier sur son sabotage des pourparlers de paix du Vietnam quand les malheureux casses eurent lieu un an plus tard, il est de l’avis général que l’effraction avait une visée plus large : rechercher toute information qui pourrait affecter la réélection de Nixon tant sur le plan défensif qu’offensif.
Cependant, si l’on se remémore l’année 1971 alors que la guerre du Vietnam déchirait le pays et que des manifestations massives contre la guerre envahissaient Washington, l’empressement désespéré de Nixon à mettre la main sur le dossier disparu ne semble soudain plus si fou. Le prix à payer aurait été élevé si le public avait eu vent que Nixon avait fait durer la guerre pour gagner un avantage politique en 1968.
Au cours de l’année 1972 — et des débuts du scandale du Watergate — l’ex-président Johnson demeura silencieux sur le sabotage des pourparlers de paix de Paris par Nixon. L’ancien président devint cependant livide lorsque — après la réélection de Nixon en 1972 — les hommes de Nixon cherchèrent à faire pression sur Johnson pour les aider à faire avorter l’enquête sur le Watergate, entre autres en faisant remarquer que Johnson aussi avait fait mettre la campagne de 1968 de Nixon sur écoute afin d’obtenir des preuves du sabotage des pourparlers.
Bien qu’il ne soit pas certain que Johnson aurait finalement parlé, cette menace pour Nixon s’évanouit deux jours après le second discours inaugural de Nixon le 22 janvier 1973, lorsque Johnson mourut d’une crise cardiaque. Cependant, et à l’insu de Nixon, Johnson avait laissé le dossier manquant, nommé « l’enveloppe-X », aux soins de Rostow qui, après la mort de Johnson, remit le dossier à la bibliothèque présidentielle Lyndon B. Johnson à Austin (Texas) avec comme instructions de le maintenir secret pour au moins 50 ans. (Les instructions de Rostow furent annulées dans les années 90, et j’ai pu trouver en 2012 les documents, maintenant largement déclassifiés, à la bibliothèque.)
Ainsi, avec « l’Enveloppe-X » enterrée pendant plus de deux décennies à la bibliothèque LBJ et avec les principaux journaux traitant les premiers rapports succincts du sabotage des pourparlers de paix par Nixon comme de simples « rumeurs », le Watergate restait un scandale cantonné à la campagne de 1972.
Les tentatives de Nixon d’étouffer le rôle de sa campagne dans le cambriolage du Watergate produisirent cependant suffisamment de preuves irréfutables d’obstruction à l’action de la justice et d’autres infractions, pour que Nixon se vît forcé de démissionner le 9 avril 1974.
Une enquête ratée
La confrontation avec l’Iran au sujet des otages de 1979 à 1981 ne fut certes pas une crise aussi dévastatrice que celle de la guerre du Vietnam, cependant l’humiliation des États-Unis durant cette épreuve de 444 jours s’est retrouvée au cœur de l’élection de 1980, également, du fait que le premier anniversaire de la prise par l’Iran de l’ambassade américaine à Téhéran se trouvait tomber le jour de l’élection.
L’échec de Carter à obtenir la libération des 52 employés de l’ambassade a transformé le coude-à-coude en une victoire écrasante pour Ronald Reagan, les Républicains prenant également le contrôle du Sénat américain en éliminant certains des sénateurs Démocrates les plus influents.
En 1984, Reagan fut réélu haut la main, mais se heurta deux ans plus tard au scandale de l’Iran-Contra. Les ventes d’armes secrètes de Reagan à l’Iran et le détournement des profits vers les Contras « sortit » en novembre 1986 mais avec une focalisation uniquement sur les ventes d’armes de 1985 à1986 et le détournement. Pourtant, les crimes liés au scandale comprenaient des violations de la loi sur le contrôle d’exportation des armes et sur la loi dite « Boland » interdisant d’armer les Contras, tout autant qu’ils incluaient parjure et obstruction à la justice. Il y avait donc la perspective d’une destitution de Reagan.
Pourtant — dès le début de l’affaire Iran-Contra — on constatait une vive opposition des Républicains, qui ne voulaient pas voir un autre président issu du GOP [Great Old Party, le parti Républicain, NdT] expulsé de son poste. De nombreux médias dominants opposèrent également de la résistance au scandale, parce qu’ils appréciaient Reagan personnellement et craignaient un retour de bâton de la part du public si la presse tenait un rôle agressif comme lors du Watergate.
Des Démocrates modérés, comme le député Lee Hamilton (Indiana) qui coprésidait l’enquête officielle du Congrès, cherchèrent également à éteindre l’incendie Iran-Contra et mirent en place des coupe-feux pour empêcher l’enquête de s’intéresser à des exactions liées comme la protection par l’administration Reagan des trafiquants de cocaïne Contras.
« Demandez, pour la cocaïne », implorait un manifestant alors qu’il était évacué de la salle d’audience de la commission sur l’Iran-Contra, tandis que les enquêteurs du Congrès détournaient les yeux de ce sujet inconvenant, pour donner à la place des leçons guindées sur les prérogatives constitutionnelles du Congrès.
Il faudra attendre 1990-1991 pour découvrir que les livraisons d’armes à l’Iran approuvées par les États-Unis ne commencèrent pas en 1985 comme l’expliquait le récit officiel de l’Iran-Contra, mais remontaient à 1981, avec l’accord de Reagan pour des ventes d’armes à l’Iran via Israël.
Le choix politiquement risqué de Reagan d’armer secrètement l’Iran immédiatement après sa prise de fonction et la libération des otages faillit être mis à jour quand l’un des avions israéliens dévia dans l’espace aérien soviétique le 18 juillet 1981 puis s’écrasa ou fut abattu.
Dans une interview pour PBS près de dix ans plus tard, Nicholas Veliotes, le Secrétaire d’État adjoint pour le Moyen-Orient de Reagan déclara s’être penché sur l’incident en parlant avec les haut-responsables de l’administration.
« Il était clair pour moi, suite à mes conversations avec des gens haut placés, que nous avions en effet autorisé les Israéliens à transborder vers l’Iran des équipements militaires d’origine américaine », déclara Veliotes.
En vérifiant le vol israélien, Veliotes en vint à croire que les tractations entre le camp de Reagan et l’Iran remontaient à avant l’élection de 1980. « Cela semble avoir sérieusement débuté probablement avant l’élection de 1980, quand les Israéliens eurent identifié qui deviendraient les nouveaux acteurs de la sécurité nationale sous l’administration Reagan », nous dit Veliotes. « Pour moi, certains contacts eurent lieu à cette époque-là. »
Toutefois, en 1981, d’après Veliotes, le Département d’État diffusa des communiqués de presse trompeurs pour couvrir les traces de l’administration et les médias de Washington manquèrent d’en assurer le suivi. C’est ainsi que la filière d’armes États-Unis-Israël vers l’Iran demeura secrète pour le peuple américain jusqu’en novembre 1986, quand — en dépit de l’affirmation constante de Reagan qu’il ne ferait jamais de commerce d’armes avec un pays terroriste comme l’Iran — l’opération fut révélée.
Quand je ré-interviewai Veliotes en 2012, il déclara qu’il ne se rappelait pas qui étaient les « personnes haut placées » qui avaient décrit l’autorisation souterraine des convois israéliens d’armes fabriquées aux États-Unis, mais il m’indiqua que « les nouveaux acteurs » étaient les jeunes néoconservateurs qui travaillaient sur la campagne de Reagan, et dont beaucoup rejoignirent plus tard l’administration, nommés aux principaux postes politiques.
Des documents que je découvris dans la bibliothèque présidentielle de Reagan montrèrent que les néoconservateurs de Reagan au Département d’État, en particulier Robert McFarlane et Paul Wolfowitz, initièrent une examen de la politique en 1981 visant à permettre à Israël de convoyer des cargaisons militaires secrètes vers l’Iran.
McFarlane et Wolfowitz manœuvrèrent également pour que McFarlane fut responsable des relations américaines avec l’Iran et pour établir des liens officieux clandestins avec le gouvernement israélien, à l’insu des représentants du gouvernement américain, même les plus gradés.
Une autre enquête ratée
En 1991, confronté à l’accumulation de preuves d’un prologue au scandale de l’Iran-Contra, le Congrès accepta à contrecœur de s’intéresser à ces allégations qualifiées de « surprise d’octobre » [dans le jargon politique US, cette expression désigne un événement qui est révélé ou se produit opportunément avant une élection présidentielle et est susceptible d’influencer le résultat, NdT]. Mais les Républicains, alors menés par le président George H.W. Bush et son équipe de la Maison-Blanche, montèrent une opération de camouflage agressive pour « trafiquer » l’histoire.
L’enquête du Congrès étant à nouveau largement dans les mains du représentant Hamilton, les Démocrates battirent craintivement en retraite, en dépit d’une masse de preuves croissante indiquant que l’équipe de Reagan était en effet coupable.
Un nombre conséquent de ces preuves parvinrent au groupe de travail de la Chambre en décembre 1992, alors que le président George H.W. Bush avait déjà perdu sa réélection et que les Démocrates se réjouissaient de retrouver le contrôle de Washington. Au lieu de se prêter à un examen minutieux des nouvelles preuves, le groupe de travail de la Chambre les a alors ignorées, dénigrées ou enterrées.
Le nouveau matériel comprenait le témoignage sous serment le 18 décembre 1992 de David Andelman, le biographe du chef du renseignement français Alexandre de Marenches, décrivant comment Marenches avait confié avoir aidé à arranger les contacts entre les Républicains et les Iraniens. Andelman, un ancien correspondant du New York Times et de CBS News, déclara que pendant qu’il travaillait à l’autobiographie de Marenches, le maître espion ultraconservateur avait admis avoir organisé des rencontres entre les Républicains et les Iraniens à propos du problème des otages à l’été et à l’automne 1980, une réunion s’étant finalement tenue à Paris en octobre.
Andelman dit que Marenches avait donné l’ordre que ces rencontres secrètes ne soient pas inscrites dans ses mémoires, parce que l’histoire pouvait ternir la réputation de ses amis, William Casey et George H.W. Bush. Le témoignage de Andelman corrobora des affirmations de longue date émanant d’une variété d’agents du renseignement international à propos d’une réunion à Paris impliquant Casey et Bush. Mais le rapport du groupe de travail mit de côté ce témoignage, le qualifiant paradoxalement de « crédible » tout en déplorant qu’il fût « insuffisamment probant ».
Le rapport du groupe de travail argumenta que Andelman ne pouvait pas « écarter la possibilité que Marenches avait dit être au courant et avoir participé aux réunions de Casey parce que lui, Marenches, ne pouvait pas prendre le risque de dire à son biographe qu’il ne savait rien de ces allégations. »
Dans les dernières semaines de l’enquête, les enquêteurs de la Chambre reçurent également une lettre de l’ancien Président iranien Bani-Sadr détaillant sa bataille en coulisse avec l’ayatollah Ruhollah Khomeini et son fils Ahmad à propos des accords secrets avec la campagne de Reagan. Mais les enquêteurs de la Chambre considérèrent le compte-rendu de première main de Bani-Sadr comme des ouï-dire et donc comme manquant également de « valeur probante ».
J’exhumai ensuite quelques-unes des preuves dans les dossiers non publiés du groupe de travail. Quoi qu’il en soit, dans l’intervalle, le Washington officiel avait rejeté la « surprise d’octobre » et d’autres scandales en lien avec l’Iran-Contra, comme le trafic de drogue des Contras, en tant que théories du complot.
Le « rapport russe »
Ironiquement, une autre preuve tardive s’avéra être un rapport de janvier 1993, d’une commission de sécurité nationale du parlement russe sur les données du renseignement du Kremlin, confirmant que des Républicains de premier plan, notamment George H. W. Bush et William Casey, avaient rencontré des représentants iraniens en Europe au sujet des otages, au cours de la campagne de 1980.
Hamilton avait requis l’aide des Russes avant les élections américaines de 1992, mais le rapport ne fut envoyé que deux semaines seulement avant la fin de la présidence de George H. W. Bush.
Comme Lawrence Barcella, conseiller en chef du groupe de travail, me le confia plus tard, tant de preuves incriminantes étaient arrivées si tardivement qu’il avait demandé à Hamilton de prolonger l’enquête de trois mois. Mais Hamilton dit non (bien que Hamilton me rapportât n’avoir aucun souvenir d’avoir refusé une demande de Barcella).
L’autre erreur fatale de l’enquête de la Chambre fut d’avoir laissé le soin de la grande part des vraies investigations au bureau juridique de la Maison-Blanche du président George H. W. Bush et au Département d’État, en dépit du fait que Bush fût l’un des principaux suspects et que de 1991 à 1992 il se présentât pour une réélection, dont la campagne aurait été ruinée si les allégations de la surprise d’octobre 1980 avaient été confirmées.
La naïveté de cette décision se trouva soulignée des années après, quand je mis la main sur une note à la Bibliothèque présidentielle de Bush, indiquant que le Département d’État avait informé le bureau juridique de la Maison-Blanche que Casey s’était rendu à Madrid en 1980, corroborant une allégation clé au sujet de la surprise d’octobre.
La confirmation du déplacement de Casey fut transmise par le conseiller juridique au Département d’État, Edwin D. Williamson, au conseiller du bureau juridique de la Maison-Blanche, Chester Paul Beach Jr. au début de novembre 1991, au moment où l’enquête sur la surprise d’octobre se dessinait, selon le « livre d’ordre » de Beach datant du 4 novembre 1991.
Selon la note de Beach, Williamson dit que parmi le matériel détenu par le Département d’État « potentiellement utile aux allégations sur la surprise d’octobre se trouvait un message de l’ambassade à Madrid indiquant que Bill Casey était de passage, pour des raisons inconnues. »
Deux jours après, le 6 novembre 1991, le patron de Beach, C. Boyden Gray, conseiller à la Maison-Blanche, organisa une session stratégique inter-agences où il expliqua le besoin de cantonner l’enquête du Congrès à l’affaire de la surprise d’octobre. L’objectif manifeste était de s’assurer que le scandale ne nuirait pas aux espoirs de réélection du président Bush en 1992.
Lorsque j’interviewai en 2013 Hamilton au sujet de la note de Beach, il déplora que l’information de Madrid n’ait pas été communiquée pendant son enquête, ajoutant « on doit se reposer sur des personnes » dans la hiérarchie pour répondre aux demandes d’information.
« Nous n’avons trouvé aucune preuve confirmant le déplacement de Casey à Madrid », me confia Hamilton. « Nous n’avons pas pu montrer ça. La Maison-Blanche [de George H.W. Bush] ne nous a pas notifié qu’il avait effectivement fait le voyage. Auraient-ils dû nous transmettre ça ? Ils auraient dû le faire parce qu’ils savaient que ça nous intéressait. »
A la question de savoir si avoir eu connaissance que Casey avait fait le voyage à Madrid aurait changé la conclusion méprisante de la surprise d’octobre par le groupe de travail, Hamilton répondit par l’affirmative, car la question du déplacement à Madrid était capitale dans l’investigation du groupe de travail.
Rien ne bouge
Pourtant, ni la révélation du voyage à Madrid ni d’autres divulgations n’auront rien changé au dédain du Tout-Washington officiel pour l’histoire de la surprise d’octobre.
Les dernières divulgations comprenaient une interview de 1993 à Tel Aviv dans laquelle l’ancien Premier ministre Yitzhak Shamir disait qu’il avait lu le livre Surprise d’Octobre, écrit en 1991 par l’ex-conseiller du Conseil national de sécurité, Gary Sick, qui étayait la croyance que les Républicains étaient intervenus dans les négociations de la libération des otages en 1980 afin d’entraver la réélection de Carter.
La question désormais soulevée, un intervieweur demanda : « Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il eu une surprise d’octobre ? »
« Bien sûr qu’il y en a eu une », répondit Shamir sans hésitation, « il y en a eu une. »
Et il y eut également d’autres déclarations corroborantes. En 1996, par exemple, alors que l’ancien président Carter rencontrait dans la ville de Gaza, Arafat, le chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Arafat tenta d’avouer son rôle dans les manœuvres républicaines pour bloquer les négociations de Carter pour la libération des otages en Iran.
« J’aimerais vous dire quelque chose », dit Arafat, s’adressant à Carter en présence de l’historien Douglas Brinkley. « Sachez qu’en 1980 les Républicains m’ont approché avec un contrat d’armement [pour l’OLP] si je pouvais faire en sorte que les otages restent en Iran jusqu’après les élections [présidentielles américaines] », dit Arafat, selon un article de Brinkley paru dans l’édition de l’automne 1996 du Diplomatic Quarterly.
En 2013, après la sortie du film Argo traitant des prémices de la crises des otages en Iran, l’ancien président iranien Bani-Sadr développa sa version des avances républicaines en Iran en 1980 et comment cette initiative secrète empêcha la libération des otages.
Bani-Sadr écrivit dans un commentaire du Christian Science Monitor : « L’ayatollah Khomeini et Ronald Reagan avaient organisé une négociation clandestine qui empêcha toute tentative de ma part et de celle du président américain de l’époque Jimmy Carter de libérer les otages avant que les élections présidentielles américaines n’aient lieu en 1980. Le fait qu’ils ne fussent pas libérés fit pencher les résultats des élections en faveur de Reagan. »
Bani-Sadr ajouta ensuite un nouveau détail : que « deux de mes conseillers, Hussein Navab Safavi et Sadr-al-Hefazi, furent exécutés par le régime de Khomeini car ils avaient appris cette relation secrète entre Khomeini, son fils Ahmad, … et l’administration Reagan. » [ Pour plus de détails sur l’affaire de la surprise d’octobre, voir Trick or Treason et America’s Stolen Narrative de Robert Parry. ]
Comparer et Contraster
En quoi le Watergate et l’Iran-Contra sont-ils comparables au Russie-gate et en quoi en sont-ils différents ? Une différence clé est le fait que pour le Watergate (1972 à 1973) et l’Iran-Contra (1985 à 1986), on avait affaire à des crimes bien définis (même en refusant de croire aux deux « précédents » de 1968 et 1980 respectivement).
Pour le Watergate, cinq cambrioleurs furent capturés dans l’enceinte des bureaux du DNC le 17 juin 1972, alors qu’ils cherchaient à mettre davantage de lignes téléphoniques démocrates sur écoute. (Lors d’une précédente effraction, en mai, deux mouchards avaient été posés, mais l’un d’eux ne fonctionnait pas). Ensuite Nixon commença à organiser le camouflage de son rôle dans la campagne de 1972 en initiant une effraction et en commettant d’autres abus de pouvoir.
Pour l’Iran-Contra, Reagan autorisa en secret des ventes d’armes à l’Iran, qui était alors désigné comme un État terroriste, sans en informer le Congrès, ce qui était une violation de la Loi sur le contrôle des exportations d’armes. Il tint aussi le Congrès dans l’ignorance au sujet de sa signature tardive d’un « rapport » lié du Renseignement. Et la création d’une caisse noire pour financer les Contras nicaraguayens représentait un contournement de la Constitution américaine.
Il y eut aussi un camouflage lié à l’Iran-Contra, monté d’abord par la Maison-Blanche de Reagan puis par celle de George H. W. Bush, qui aboutit la veille de Noël 1992, à l’amnistie par Bush de six accusés de l’affaire, alors que le procureur spécial Lawrence Walsh se focalisait sur les possibilités d’inculper Bush pour rétention de preuves.
En revanche, le Russie-gate a été un « scandale » faute d’un crime particulier. Les petits chefs du renseignement du Président Barack Obama ont prétendu, sans apporter aucune preuve évidente, que le gouvernement russe ont piraté les e-mails du Comité national démocrate et du directeur de campagne de Hillary Clinton, John Podesta, et ont publié ces e-mails via Wikileaks et autres sites Internet. (Les Russes ainsi que Wikileaks ont réfuté ces accusations.)
Les e-mails du DNC révélèrent que les démocrates de longue date n’avaient pas conservé l’indépendance requise concernant les primaires lors de leur tentative de nuire au Sénateur Bernie Sanders et d’aider Hillary Clinton. Les e-mails de Podesta dévoilèrent les discours de Clinton payés par les banquiers de Wall Street et la vénalité de la Fondation Clinton.
Pirater des ordinateurs personnels est un crime, pourtant le gouvernement américain n’a toujours pas porté plainte contre des individus censés être responsables du piratage informatique des e-mails démocrates.
Faute de preuve précise de ce cybercrime ou d’un complot entre la Russie et la campagne Trump, les rescapés du département de la Justice d’Obama et maintenant le procureur spécial Robert Mueller ont œuvré à démontrer des « actes criminels », autour de fausses déclarations aux enquêteurs et possible entrave à la justice.
La trajectoire de Flynn
Dans l’affaire du lieutenant général à la retraite Michael Flynn, le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump, la procureure générale intérimaire Sally Yates usa de l’archaïque loi Logan de 1799 pour créer un préalable afin que le FBI interroge Flynn au sujet d’une conversation, le 29 décembre 2016, avec l’ambassadeur russe Sergueï Kislyak, c’est-à-dire après l’élection de Trump mais avant la cérémonie d’investiture.
La loi Logan, qui en 218 ans n’a jamais donné lieu à des poursuites, fut adoptée durant la période des lois sur les étrangers et la sédition visant à empêcher les citoyens de négocier individuellement avec les gouvernements étrangers. Il n’a jamais été prévu qu’elle s’applique à un conseiller à la sécurité nationale d’un président élu, bien que n’ayant pas encore prêté serment.
Elle devint pourtant le préalable à l’instruction du FBI, et les agents du FBI étaient armés d’une transcription d’une conversation téléphonique interceptée entre Kislyak et Flynn dans le but de coincer Flynn sur de possibles lacunes dans ses souvenirs, qui devaient certainement être d’autant plus flous qu’il était en vacances en République dominicaine lors de l’appel de Kislyak.
Yates inventa également un argument bizarre selon lequel les divergences entre le récit de Flynn de l’appel et la transcription faisaient de lui la proie d’un chantage russe, bien que comment cela aurait-il pu fonctionner, puisque les Russes présumèrent forcément que l’appel de Kislyak serait enregistré par le renseignement américain et ne leur offrirent donc aucune prise sur Flynn, ne fut jamais clarifié.
Pour autant, l’incapacité de Flynn de répéter précisément la conversation téléphonique ainsi que la controverse qui s’en suivit, servirent de base à une instruction judiciaire contre Flynn et conduisirent le Président Trump à renvoyer Flynn le 13 février.
Il se pourrait que Trump ait pensé que jeter Flynn en pâture aux requins autour les calmerait mais le sang dans l’eau n’a fait que les exciter. Aux dires du directeur du FBI de l’époque, James Comey, Trump lui avait parlé seul à seul le lendemain, 14 février, lui disant : « J’espère que vous trouverez un moyen d’abandonner cela, de lâcher Flynn. C’est un bon gars. J’espère que vous pouvez laisser filer. »
« L’espoir » de Trump et le fait par la suite qu’il renvoya Comey auraient apparemment mené le procureur spécial Mueller à envisager la possibilité d’un procès contre Trump pour obstruction à la justice. En d’autres termes, Trump pourrait se voir accusé d’obstruction dans un procès contre Flynn qui semble avoir été truqué.
Bien entendu, il reste la possibilité de l’apparition d’une preuve de collusion entre Trump et son camp et les Russes, mais une telle preuve n’a jusqu’à présent pas été présentée. Ou bien l’enquête de Mueller pourrait trouver quelque chose de solide et révéler un délit sans rapport, probablement une malversation financière de la part de Trump ou un associé.
(Un cas similaire est arrivé lors de l’instruction des Républicains à propos de l’attaque à Bengazi du 11 septembre 2012, une enquête largement infructueuse à l’exception de la révélation que la secrétaire d’État Hillary Clinton avait envoyé et reçu des e-mails via un serveur privé, ce que Comney, lors de la campagne de l’année dernière, dénonça comme « extrêmement imprudent » mais pas délictueux.)
Freiner l’enthousiasme
Un autre contraste entre les scandales précédents (Watergate et Iran-Contra) et le Russie-gate est le degré d’enthousiasme et d’excitation déployé aujourd’hui par les médias américains dominants et les Démocrates du Congrès par rapport à 1972 et 1986.
Bien que Bob Woodward et Carl Bernstein du Washington Post aient agressivement enquêté sur le scandale, les autres organes de presse s’y sont bien moins intéressés jusqu’à ce que le crime de Nixon devienne évident en 1973. Beaucoup de Démocrates, y compris le président du DNC Bob Strauss, furent extrêmement réticents, voire carrément opposés à donner suite au scandale.
De même, bien que Brian Barger et moi-même à The Associated Press suivions des aspects de l’Iran-Contra dès le début de 1985, les chaînes et les journaux principaux accordèrent constamment à l’administration Reagan le bénéfice du doute, tout du moins avant que le scandale n’éclatât finalement au grand jour à l’automne 1986 (lorsqu’un avion approvisionné par les Contras s’écrasa à l’intérieur du Nicaragua et qu’un journal libanais révéla les livraisons d’armes américaines à l’Iran).
Durant plusieurs mois, l’attention se focalisa sur le scandale complexe d’Iran-Contra, mais les médias principaux continuèrent d’ignorer la preuve du camouflage de la Maison-Blanche et se désintéressèrent rapidement du travail difficile de démêlage des réseaux alambiqués propres à la contrebande d’armes, au blanchiment d’argent et au trafic de cocaïne.
Les Démocrates reculèrent également face à une confrontation constitutionnelle avec le populaire Reagan et son très introduit Vice-Président George H. W. Bush.
Après être passé de l’AP au Newsweek au début de 1987, j’appris que les haut dirigeants du Newsweek, alors propriété de la Washington Post Company, ne souhaitaient pas un « autre Watergate » ; ils furent d’avis qu’un tel autre scandale ne serait pas « bon pour le pays » et voulurent qu’Iran-Contra disparût aussi vite que possible. Je ne devais même pas lire le rapport Iran-Contra du Congrès lorsqu’il fut publié en octobre 1987 (j’ignorai cet ordre cependant et continuai mes propres investigations au mépris des vœux des grands pontes du Newsweek et cela jusqu’à ce que ces accrochages répétés eussent abouti à mon départ en juin 1990).
La plus grande similarité donc entre le Russie-gate et le Watergate est peut-être que Richard Nixon et Donald Trump étaient tous deux fortement impopulaires auprès de l’establishment à Washington, ne comptant ainsi que sur peu de défenseurs influents. En revanche, un contraste important avec l’Iran-Contra fut que Reagan et Bush étaient très appréciés, particulièrement parmi les dirigeants des journaux tels que l’éditeur du Washington Post, Katharine Graham, qui, de toute évidence, ne s’est pas occupée du rustre Nixon. Aujourd’hui, les cadres supérieurs du New York Times, du Washington Post et autres grands organes d’information n’ont jamais caché leur dédain pour le clownesque Trump, ni leur hostilité envers le Président russe Vladimir Poutine.
Autrement dit, le Russie-gate semble constituer – autant pour les journaux dominants que les Démocrates – un agenda politique, c’est-à-dire le désir de retirer Trump de son poste tout en renforçant une « nouvelle guerre froide » avec la Russie, une priorité pour les néoconservateurs de Washington et leurs acolytes libéraux-interventionnistes.
Si un pareil drame politique se jouait dans un tout autre pays, nous parlerions d’un « coup d’État en douceur » dans lequel « l’oligarchie » ou la force d’un « État profond » utiliseraient des moyens semi-constitutionnels pour orchestrer le retrait d’un leader indésirable.
Bien entendu, puisque la campagne de retrait de Trump en cours se déroule aux États-Unis, elle se doit d’être présentée comme une recherche de la vérité empreinte de principes, et comme une vertueuse application de la primauté du droit. Mais la comparaison avec le Watergate et l’Iran-Contra est exagérée.
Le reporter d’investigation Robert Parry a révélé de nombreux récits Iran-Contra pour l’Associated Press et Newsweek dans les années 80.
Source : Robert Parry, Consortium News, 28-06-2017
Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source.
via » Le Russie-gate, ce n’est pas le Watergate ou l’Iran-Contra, par Robert Parry











