L’incohérence du socialisme : le mythe du progrès et le culte de la machine (par George Orwell)
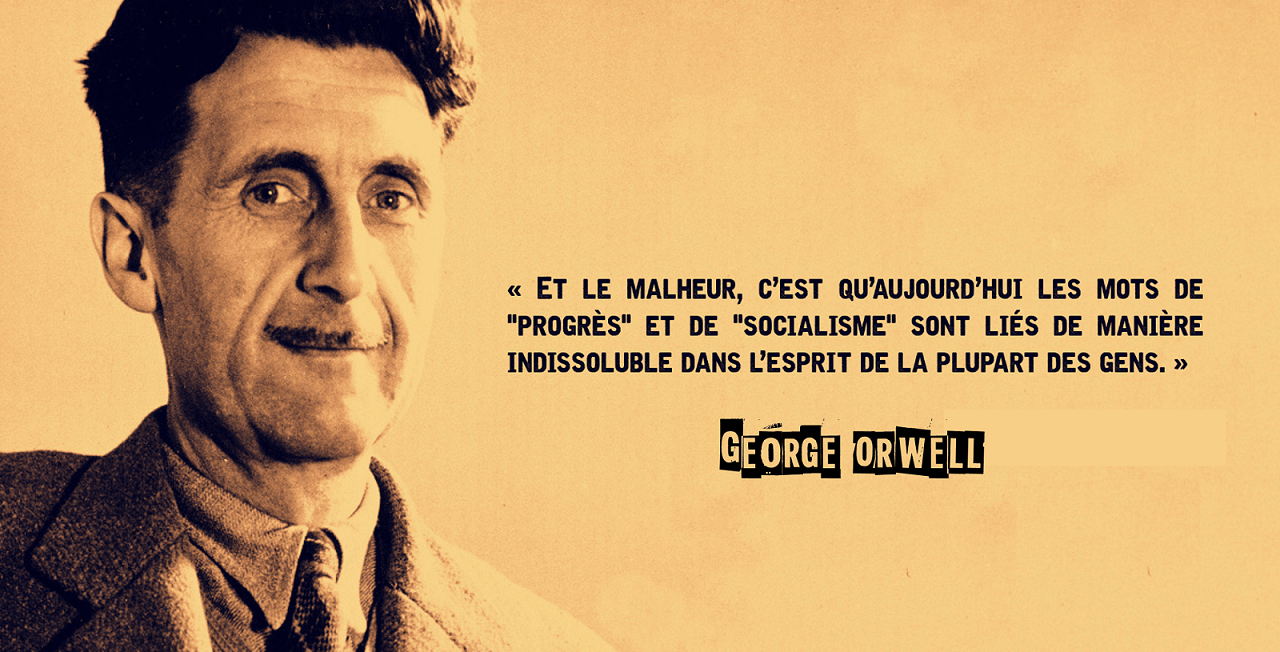
Un excellent texte de George Orwell. Il s’agit du chapitre XII de son livre Le Quai de Wigan, (1937, traduit de l’anglais par Michel Pétris, éd. Ivréa, 1982). Bien que nous ne soyons partisans d’aucune société de masse, fut-elle socialiste, sa critique du machinisme et du progressisme est très juste et très claire.
Prié d’expliquer pourquoi les gens intelligents se trouvent si souvent de l’autre côté de la barricade, le socialiste invoquera en général des raisons de bas intérêt, conscientes ou inconscientes, la conviction non fondée que le socialisme ne peut pas « marcher », ou la simple peur des horreurs et désagréments inhérents à la période révolutionnaire précédant l’instauration du socialisme. Tout ceci a certes son importance, mais il ne manque pas d’individus insensibles à des considérations de cet ordre et qui n’en sont pas moins résolument hostiles au socialisme. S’ils rejettent le socialisme, c’est pour des raisons spirituelles ou « idéologiques ». Leur refus n’est pas dicté par l’idée que « ça ne peut pas marcher », mais au contraire par la crainte que ça marche trop bien. Ce qu’ils redoutent, ce n’est pas les événements qui peuvent venir troubler le cours de leur vie, mais ce qui se passera dans un futur éloigné, quand le socialisme sera devenu une réalité.
Il m’a très rarement été donné de rencontrer un socialiste convaincu capable de comprendre que les gens réfléchis puissent être en désaccord avec l’objectif vers lequel semble tendre le socialisme. Le marxiste, en particulier, ne veut voir là qu’une manifestation de sentimentalité bourgeoise. En règle générale, les marxistes ne sont pas très habiles pour ce qui est de lire dans les pensées de leurs adversaires ; s’il en était autrement, la situation en Europe ne serait peut-être pas aussi critique qu’elle l’est aujourd’hui. En possession d’une technique qui, semble-t-il, fournit réponse à tout, ils ne se soucient guère de chercher à savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Je citerai ici un exemple pour mieux me faire comprendre. Se référant à la théorie largement diffusée — et qui en un sens est certainement vraie — selon laquelle le fascisme est un produit du communisme, M. N. A. Holdaway, un des auteurs marxistes les plus solides que nous ayons, écrit ce qui suit :
« La légende éculée du communisme conduisant au fascisme… L’élément de vérité qu’elle comporte, le voilà : l’apparition d’une activité communiste avertit les classes dirigeantes que les partis travaillistes démocratiques ne sont plus à même de tenir en coupe réglée la classe ouvrière, et que la dictature capitaliste doit dès lors prendre une autre forme pour se perpétuer. »
On voit ici où le bât blesse. Ayant décelé la cause économique cachée du fascisme, l’auteur pose comme allant de soi que l’aspect spirituel de la question est dénué d’importance. Le fascisme est dépeint comme une manœuvre de la « classe dirigeante », ce qu’il est effectivement en substance. Mais ceci explique uniquement l’attirance que le fascisme peut exercer sur les capitalistes. Que dire des millions de gens qui ne sont pas des capitalistes, qui, sur le plan matériel, n’ont rien à attendre du fascisme, qui bien souvent s’en rendent parfaitement compte, et qui pourtant sont fascistes ? De toute évidence, leur choix est purement idéologique. S’ils se sont jetés dans les bras du fascisme, c’est uniquement parce que le communisme s’est attaqué, ou a paru s’attaquer, à des valeurs (patriotisme, religion) qui ont des racines plus profondes que la raison économique. Et en ce sens, il est parfaitement exact que le communisme fait le lit du fascisme. Il est navrant que les communistes s’obstinent à sortir des lapins économiques de chapeaux idéologiques. En un sens, cela a bien pour effet de révéler la vérité, mais avec cette conséquence annexe que la propagande communiste manque pour l’essentiel son but. C’est cette réaction de rejet intellectuel à l’égard du socialisme, telle qu’elle se manifeste surtout chez les esprits réceptifs, que je veux étudier dans ce chapitre. Cette analyse sera assez longue dans la mesure où la réaction en question est très largement répandue, très puissante, et presque totalement négligée par les penseurs socialistes.
La première chose à signaler, c’est que le concept de socialisme est aujourd’hui quasiment indissociable du concept de machinisme. Le socialisme est, fondamentalement, un credo urbain. Il a connu un développement sensiblement parallèle à celui de l’industrialisme, il a toujours plongé ses racines dans le prolétariat des villes, l’intelligentsia des villes, et il est douteux qu’il puisse surgir dans une société qui ne serait pas une société industrielle. Si l’on prend l’industrialisme comme fait de départ, l’idée du socialisme se présente tout naturellement à l’esprit, étant donné que la propriété privée n’est tolérable que si chaque individu (ou famille, ou toute autre unité de base) peut vivre selon une certaine forme d’autarcie. Mais l’industrialisme a pour effet d’empêcher l’individu de se suffire à lui-même, ne serait-ce qu’un bref moment. L’industrialisme, dès qu’il dépasse un certain seuil (placé d’ailleurs assez bas), doit conduire à une forme de collectivisme. Pas forcément au socialisme, bien entendu : on peut concevoir qu’il débouche sur l’État esclavagiste que le fascisme semble annoncer. Et l’inverse est également vrai. Le machinisme appelle le socialisme, mais le socialisme en tant que système mondial implique le machinisme, puisqu’il sous-entend certaines exigences incompatibles avec le mode de vie primitif. Il exige, par exemple, une intercommunication constante et un échange perpétuel de marchandises entre les différents points du globe. Il exige un certain degré de centralisation. Il exige un niveau de vie sensiblement égal pour tous les êtres humains et, sans doute, une certaine uniformité dans l’éducation. Nous pouvons en conclure qu’une Terre où le socialisme serait devenu une réalité devrait être au moins aussi mécanisée que les États-Unis d’aujourd’hui, et vraisemblablement beaucoup plus. En tout cas, aucun socialiste n’oserait s’inscrire en faux contre cette affirmation. Le monde socialiste est toujours présenté comme un monde totalement mécanisé, strictement organisé, aussi étroitement tributaire de la machine que les civilisations antiques pouvaient l’être des esclaves.

Jusque là, tout va très bien, ou très mal, comme l’on voudra. Parmi les gens qui réfléchissent, beaucoup, pour ne pas dire la majorité, ne nourrissent aucun penchant particulier pour la civilisation des machines. […] Le malheur, c’est que le socialisme, tel qu’il est généralement présenté, charrie avec lui l’idée d’un progrès mécanique conçu non pas comme une étape nécessaire mais comme une fin en soi — je dirais presque comme une nouvelle religion. Cela saute aux yeux quand on considère tout le battage orchestré autour des réalisations mécaniques de la Russie soviétique (les tracteurs, le barrage sur le Dniepr, etc.). Karel Capek épingle fort bien le phénomène dans la terrible fin de son roman R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), où l’on voit les robots, ayant exterminé le dernier représentant de la race humaine, proclamer leur intention de « construire beaucoup de maisons » (pour le seul plaisir d’en construire, sans plus). Les individus les mieux disposés à l’égard du socialisme sont en même temps ceux qui se pâment d’enthousiasme devant le progrès mécanique en tant que tel. Et cela est si vrai que la plupart des socialistes sont incapables d’admettre qu’on puisse avoir une opinion contraire. En règle générale, l’argument le plus fort qu’ils trouvent à vous opposer consiste à dire que la mécanisation du monde actuel n’est rien comparée à ce que l’on verra quand le socialisme aura triomphé. Là où il y a aujourd’hui un avion, il y en aura alors cinquante ! Toutes les tâches aujourd’hui effectuées manuellement seront alors exécutées par la machine. Tout ce que l’on fabrique aujourd’hui avec du cuir, du bois ou de la pierre sera fait de caoutchouc, de verre ou d’acier. Il n’y aura plus de désordre, plus de gaspillage, plus de déserts, plus d’animaux sauvages, plus de mauvaise herbe, on aura oublié la maladie, la pauvreté, la souffrance, etc. Le monde socialiste s’annonce avant tout comme un monde ordonné, un monde fonctionnel. Mais c’est précisément cette vision d’un futur à la Wells, d’un futur nickelé qui rebute les esprits réceptifs. Il est à remarquer que cette conception essentiellement pantouflarde du progrès n’est pas un article inamovible de la doctrine socialiste. Mais on en est venu à la considérer comme telle, avec ce résultat que le conservatisme viscéral existant à l’état latent chez toute sorte de gens ne demande qu’à se mobiliser contre le socialisme.
Tout individu à l’esprit réceptif connaît des moments où il se prend à douter de la machine et même, dans une certaine mesure, des sciences physiques. Mais il importe de bien distinguer les motifs, très différents suivant les époques, d’hostilité au machinisme et à la science, et de ne pas se laisser abuser par les manifestations de dépit de la gent littéraire contemporaine, dressée contre une science qui a confisqué à son profit la foudre de la littérature. La première attaque en règle contre la science et le machinisme que je connaisse se trouve dans la troisième partie des Voyages de Gulliver. Mais les considérations de Swift, aussi brillantes et séduisantes soient-elles sur le plan littéraire, n’en sont pas moins hors du sujet, et même plutôt bêtes, parce qu’elles présentent le point de vue (la remarque paraîtra peut-être paradoxale, visant l’auteur des Voyages de Gulliver) d’un homme manquant d’imagination. Pour Swift, la science n’était qu’un ramassis de recettes sordides, et les machines le fruit d’élucubrations de cerveaux dérangés, des objets qui ne pourraient jamais fonctionner. Swift n’avait d’autre critère que l’utilité pratique et il lui manquait cet esprit visionnaire qui lui aurait permis de comprendre qu’une expérience dépourvue sur le moment d’intérêt manifeste peut porter ses fruits dans l’avenir. Il cite, quelque part dans son livre, comme exemple de réussite incomparable le fait d’arriver à « faire pousser deux brins d’herbe là où auparavant il n’en poussait qu’un », sans apparemment s’apercevoir que c’est précisément ce que la machine est capable de réaliser. Un peu plus tard, ces machines si méprisées se mirent à marcher, la science physique consolida son emprise sur le monde, et ce fut le fameux affrontement de la religion et de la science qui remua si fort l’esprit de nos grands-pères. La guerre est aujourd’hui finie, chacun des deux adversaires en présence s’étant replié sur ses positions, persuadé d’avoir remporté la victoire, mais nombre d’esprits religieux continuent à entretenir au fond d’eux-mêmes un tenace préjugé contre la science. Tout au long du dix-neuvième siècle les voix n’ont pas manqué pour s’élever contre la science et le machinisme (pensez aux Temps difficiles de Dickens, par exemple), mais cette protestation s’appuyait en général sur l’argument, assez peu consistant, que l’industrialisme présentait dans les premières phases de son développement un visage cruel et repoussant.
Les arguments développés par Samuel Butler dans un chapitre fameux d’Erewhon sont d’une autre trempe. Mais Butler vivait à une époque beaucoup moins féroce que la nôtre, une époque où un individu de qualité avait encore le loisir de se comporter, s’il le désirait, en dilettante, et de voir toute l’affaire sous l’angle d’un pur exercice intellectuel. Butler a aperçu de manière assez claire l’abjecte dépendance dans laquelle pouvait nous maintenir la machine, mais au lieu d’en envisager les ultimes conséquences, il a préféré se livrer à une charge qui ne dépasse guère le niveau de la farce. Seule notre époque, l’époque de la mécanisation triomphante, nous permet d’éprouver réellement la pente naturelle de la machine, qui consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique.

On aurait sans doute du mal à trouver un être doué de pensée et de sensibilité qui ne se soit dit un jour ou l’autre, à la vue d’une chaise en tubes, que la machine est l’ennemie de la vie. Mais en règle générale, il s’agit là d’un sentiment plus instinctif que raisonné. Les gens se rendent confusément compte que le « progrès » est un leurre, mais ils aboutissent à cette conclusion par une sorte de sténographie mentale. Mon rôle est ici de restituer les transitions logiques généralement escamotées. La première question à se poser est : « Quelle est la fonction de la machine ? » Manifestement, sa fonction primordiale est d’épargner de la peine, et les gens qui admettent pleinement la civilisation machiniste voient rarement la nécessité d’aller chercher plus loin. Voici par exemple quelqu’un qui proclame, ou plutôt crie sur les toits, son parfait accord avec le monde mécanisé d’aujourd’hui. Les citations suivantes sont tirées de World without Faith de M. John Beevers. Écoutons ce dernier :
« Il est parfaitement insensé d’affirmer que l’individu moyen d’aujourd’hui, payé de deux livres dix shillings à quatre livres par semaine, représente un recul par rapport au valet de ferme du dix-huitième siècle, ou même à tout ouvrier agricole ou paysan appartenant à n’importe quelle communauté exclusivement agricole existante ou disparue. C’est un mensonge. Il est aussi inepte de célébrer à grands cris les effets civilisateurs du travail aux champs ou dans une cour de ferme que de s’insurger contre celui qui s’accomplit dans de grands ateliers de construction de locomotives ou dans une usine de construction automobile. Le travail est un fardeau. Si nous travaillons, c’est parce que nous y sommes obligés, et tout travail n’a d’autre finalité que de nous procurer du temps de loisir et les moyens d’occuper aussi agréablement que possible ce temps de loisir ».
Et un peu plus loin :
« L’homme aura bientôt assez de temps disponible et de pouvoir sur la matière pour chercher son paradis sur la Terre sans plus se préoccuper de celui qui l’attend au ciel. La Terre sera un endroit si agréable à vivre que le prêtre et le pasteur n’auront plus guère l’occasion de propager leurs sornettes. Un seul coup bien assené suffit à dégonfler ces baudruches ».
M. Beevers consacre tout un chapitre (le chapitre IV de son livre) à illustrer cette thèse, et son argumentation n’est pas sans intérêt dans la mesure où elle traduit la forme la plus vulgaire, la plus ignorantiste et la plus primaire du culte de la machine. On entend ici s’exprimer sans entraves toute une fraction du monde moderne. Chaque mangeur d’aspirine des banlieues reculées se fera un devoir d’applaudir des deux mains. Notez le trémolo indigné de M. Beevers (« C’est un menson-on-on-ge ! ») à l’idée que son grand-père ait pu lui être supérieur en tant qu’individu ; et à l’idée, encore plus horrible, que le fait de retourner à un mode de vie plus simple pourrait le contraindre à se retrousser les manches pour accomplir un véritable travail. Car le travail, voyez-vous, n’a d’autre but que de nous « procurer du temps de loisir ». Du loisir pour quoi faire ? Pour nous rendre encore plus semblables à M. Beevers, je suppose. La tirade sur le « paradis sur la Terre » nous permet toutefois d’imaginer assez précisément la civilisation que M. Beevers appelle de ses vœux : une sorte de Lyons Corner House instaurée in sœcula saculorum et qui deviendrait sans cesse plus vaste et sans cesse plus bruyante. Et vous trouverez dans n’importe quel livre écrit par un sectateur du monde de la machine — H. G. Wells par exemple — quantité de passages du même tonneau. Combien de fois ne nous a‑t-on pas rebattu les oreilles avec le couplet bourratif sur les « machines, notre nouvelle race d’esclaves, qui permettront à l’humanité de se libérer », etc. Pour ces penseurs, semble-t-il, le seul danger de la machine réside dans l’usage qui pourrait en être fait à des fins de destruction, comme par exemple les avions en cas de guerre. Mais la guerre et les catastrophes imprévisibles mises à part, le futur est conçu comme la marche toujours plus rapide du progrès mécanique. Des machines pour nous épargner de la peine, des machines pour nous épargner des efforts de pensée, des machines pour nous épargner de la souffrance, pour gagner en hygiène, en efficacité, en organisation — toujours plus d’hygiène, toujours plus d’efficacité, toujours plus d’organisation, toujours plus de machines, jusqu’à ce que nous débouchions sur cette utopie wellsienne qui nous est devenue familière et qu’a si justement épinglée Huxley dans Le Meilleur des mondes, le paradis des petits hommes grassouillets. Naturellement, quand ils rêvent d’un tel futur, les petits hommes grassouillets ne se voient ni petits ni grassouillets : ils sont plutôt pareils à des dieux. Mais pourquoi seraient-ils ainsi ? Tout progrès mécanique est dirigé vers une efficacité toujours plus grande ; c’est-à-dire, en fin de compte, vers un monde où rien ne saurait aller de travers. Mais dans un tel monde, nombre des qualités qui, pour M. Wells, rendent l’homme pareil à un dieu ne seraient pas plus extraordinaires que la faculté qu’a un animal de remuer ses oreilles. Les êtres que l’on voit dans Men Like Gods et The Dream sont présentés comme braves, généreux et physiquement forts. Mais dans un monde d’où tout danger physique aurait été banni — et il est évident que le progrès mécanique tend à éliminer le danger — peut-on s’attendre à voir se perpétuer le courage physique ? Est-il concevable qu’il se perpétue ? Et pourquoi la force physique se maintiendrait-elle dans un monde rendant inutile tout effort physique ? Et quant à la loyauté, la générosité, etc., dans un monde où rien n’irait de travers, de telles qualités seraient non seulement sans objet mais aussi, vraisemblablement, inimaginables. En réalité, la plupart des vertus que nous admirons chez les êtres humains ne peuvent se manifester que face à une souffrance, une difficulté, un malheur. Mais le progrès mécanique tend à éliminer la souffrance, la difficulté, le malheur. Des livres comme The Dream ou Men Like Gods affirment implicitement que la force, le courage ou la générosité subsisteront parce qu’il s’agit là de vertus louables, attributs indispensables de tout être humain à part entière. Il faut donc croire que les habitants d’Utopie créeraient des dangers artificiels pour tremper leur courage, et feraient des haltères pour se forger des muscles qu’ils n’auraient jamais à utiliser. On voit ici l’énorme contradiction généralement présente au cœur de l’idée de progrès. Le progrès mécanique tend à vous fournir un cadre de vie sûr et moelleux ; et pourtant, vous luttez pour demeurer brave et dur. Du même mouvement, vous vous ruez furieusement de l’avant et vous retenez désespérément pour rester en arrière. Comme un agent de change londonien qui voudrait se rendre à son bureau en cotte de maille et s’entêterait à parler en latin médiéval. De sorte qu’en dernière analyse, le champion du progrès se fait aussi le champion de l’anachronisme.
Jusqu’ici j’ai tenu pour acquis que le progrès mécanique tendait à rendre la vie sûre et douce. Ceci peut être mis en doute, dans la mesure où toute nouvelle invention mécanique peut produire des effets opposés à ceux qu’on en attendait. Prenez par exemple le passage de la traction animale aux véhicules à moteur. On pourrait dire à première vue, considérant le nombre effarant des victimes de la route, que l’automobile ne contribue pas précisément à assurer une vie plus sûre. Par ailleurs, il faut probablement autant de caractère et de force physique pour disputer des courses de motos sur cendrée que pour mater un bronco ou courir le Grand National. Cependant, la pente naturelle de la machine est de devenir toujours plus sûre, toujours plus facile à mettre en œuvre. Le danger représenté par les accidents disparaîtrait si nous décidions de prendre à bras le corps le problème de la circulation routière, comme il nous faudra tôt ou tard le faire. En attendant, l’automobile en est arrivée à un point de perfectionnement tel que tout individu qui n’est pas aveugle ou paralytique peut se mettre au volant au bout de quelques leçons. Aujourd’hui, il faut beaucoup moins de sang-froid, d’habileté, pour conduire passablement une automobile qu’il n’en faut pour monter correctement un cheval. D’ici vingt ans, il se peut qu’il n’y faille plus ni sang-froid ni habileté. C’est pourquoi, si l’on considère la société dans son ensemble, il faut bien avouer que le passage du cheval à l’automobile s’est : traduit par un amollissement de l’être humain. Prenons une autre invention — l’avion par exemple, qui, à première vue, ne semble pas fait pour rendre la vie plus sûre. Les premiers aviateurs étaient des hommes d’un extraordinaire courage, et il faut aujourd’hui encore une bonne dose de sang-froid pour piloter un plus lourd que l’air. Mais la machine s’est déjà engagée sur sa pente naturelle. Comme aujourd’hui l’automobile, l’avion pourra bientôt être confié au premier venu. Un million d’ingénieurs travaillent, presque à leur insu, pour parvenir à ce but. Et finalement — c’est là le but, même si on ne l’atteint jamais tout à fait — vous obtiendrez un avion qui ne demandera pas à son pilote plus d’adresse ou de courage qu’il n’en faut à un bébé pour se laisser promener dans son landau. Et c’est dans cette direction que s’effectue et doit continuer à s’effectuer tout progrès mécanique. Une machine évolue en s’automatisant, c’est-à-dire en devenant plus facile à utiliser, plus fiable. La finalité ultime du progrès mécanique est donc d’aboutir à un monde entièrement automatisé — c’est-à-dire, peut-être, un monde peuplé d’automates.
M. Wells nous répliquerait sans doute que le monde ne deviendra jamais totalement fiable, indéréglable, pour cette raison que, quel que soit le niveau d’efficacité auquel on parvient, on bute toujours sur de nouvelles difficultés. Ainsi (c’est là une des idées favorites de M. Wells : il l’a reprise dans Dieu sait combien de péroraisons) le jour où un ordre parfait régnera sur cette planète, il faudra alors s’atteler à la tâche gigantesque qui consistera à atteindre et coloniser un autre monde. Mais ce n’est que reculer pour mieux sauter : l’objectif, lui, demeure inchangé. Qu’on colonise une autre planète, et le jeu du progrès mécanique recommence. Le monde indéréglable aura été remplacé par un système solaire indéréglable, par un univers indéréglable. Se vouer à l’idéal de l’efficacité mécanique, c’est se vouer à un idéal de mollesse. Mais pareil idéal n’a rien qui puisse susciter l’enthousiasme : de sorte que le progrès apparaît tout entier comme une course frénétique vers un but qu’on espère ne jamais atteindre. Parfois — cela n’est pas très fréquent mais cela arrive — on tombe sur un individu qui, tout en comprenant bien que ce que l’on appelle communément progrès va de pair avec ce que l’on appelle aussi communément décadence, ne s’en déclare pas moins partisan de ce progrès. Ainsi s’explique que dans l’Utopie de M. Shaw une statue ait été élevée à Falstaff, en tant que premier homme à avoir prononcé un éloge de la lâcheté.
Mais l’affaire va infiniment plus loin. Jusqu’ici, je me suis borné à signaler la contradiction qu’il y a à vouloir en même temps le progrès mécanique et la préservation de qualités rendues superflues par ce même progrès. La question qu’il faut maintenant se poser, c’est de savoir s’il existe une seule activité humaine qui ne souffrirait pas irrémédiablement de la toute-puissance de la machine.
La fonction de la machine est de nous épargner du travail. Dans un monde entièrement mécanisé, toutes les tâches ingrates et fastidieuses seraient confiées à la machine, nous laissant ainsi libres de nous consacrer à des occupations plus dignes d’intérêt. Présenté sous cet angle, le projet est admirable. Il est navrant de voir une demi-douzaine d’hommes suer sang et eau pour creuser une tranchée destinée à recevoir une conduite d’eau quand une machine de conception assez simple remuerait la même quantité de terre en deux ou trois minutes. Pourquoi ne pas laisser faire le travail à la machine, et permettre aux hommes de s’occuper d’autre chose ? Mais aussitôt surgit la question : quoi d’autre ? En théorie, ces hommes sont libérés du « travail » pour pouvoir s’adonner à des occupations qui ne sont pas du « travail ». Mais qu’est-ce qui est du travail, et qu’est-ce qui n’en est pas ? Est-ce travailler que remuer la terre, scier du bois, planter des arbres, abattre des arbres, monter à cheval, chasser, pêcher, nourrir la basse-cour, jouer du piano, prendre des photographies, construire une maison, faire la cuisine, semer, garnir des chapeaux, réparer des motocyclettes ? Autant d’activités qui constituent un travail pour certains et un délassement pour d’autres. Il y a en fait très peu d’activités qu’on ne puisse classer dans l’une ou dans l’autre catégorie suivant la manière dont on les considère. Le paysan qu’on aura dispensé de travailler la terre voudra peut-être employer tout ou partie de ses loisirs à jouer du piano, tandis que le concertiste international sautera sur l’occasion qui lui est offerte d’aller biner un carré de pommes de terre. D’où la fausseté de l’antithèse entre le travail conçu comme un ensemble de corvées assommantes et le non-travail vu comme activité désirable. La vérité, c’est que quand un être humain n’est pas en train de manger, de boire, de dormir, de faire l’amour, de jouer à un jeu ou simplement de se prélasser sans souci — et toutes ces choses ne sauraient remplir une vie — il éprouve le besoin de travailler. Il recherche le travail, même si ce n’est pas le nom qu’il lui donne. Dès qu’on dépasse le stade de l’idiot de village, on découvre que la vie doit être vécue dans une très large mesure en termes d’effort. Car l’homme n’est pas, comme semblent le croire les hédonistes vulgaires, une sorte d’estomac monté sur pattes. Il a aussi une main, un œil et un cerveau. Renoncez à l’usage de vos mains et vous aurez perdu d’un coup une grande part de ce qui fait votre personnalité. Reprenez à présent la demi-douzaine d’hommes occupés à creuser une tranchée pour la conduite d’eau. Une machine les a dispensés de remuer la terre, ils vont se distraire en s’adonnant à une autre occupation — la menuiserie, par exemple. Mais de quelque côté qu’ils se tournent, ils découvrent qu’une autre machine a été mise en place pour faire le travail à leur place. Car, dans un monde complètement mécanisé, il n’y aurait pas plus besoin de menuisiers, de cuisiniers, de réparateurs de motocyclettes qu’il n’y aurait besoin de terrassiers pour creuser des tranchées. Il n’est pratiquement aucun travail, qu’il s’agisse de harponner une baleine ou de sculpter un noyau de cerise, dont une machine ne puisse s’acquitter. La machine pourrait même empiéter sur les activités que nous rangeons dans la catégorie de l’ « art » ; elle le fait d’ailleurs déjà avec le cinéma et la radio. Mécanisez le monde à outrance, et partout où vous irez vous buterez sur une machine qui vous barrera toute possibilité de travail — c’est-à-dire de vie.
A première vue, la chose peut sembler sans gravité. Qu’est-ce qui vous empêcherait de vous consacrer à votre, travail « créateur » sans vous soucier aucunement des machines qui le feraient pour vous ? Mais l’affaire n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Me voici, qui passe huit heures par jour dans un bureau à trimer pour le compte d’une compagnie d’assurances ; à mes moments de loisir, j’ai envie de me livrer à une occupation « créatrice », et c’est pourquoi je choisis de me transformer en menuisier d’occasion, pour me fabriquer une table, par exemple. Notez bien qu’il y a dès le départ quelque chose d’artificiel dans tout cela, car les maisons spécialisées peuvent me livrer une table bien meilleure que celle qui sortira de mes mains. Mais même si je me mets au travail, il m’est impossible de le faire dans le même état d’esprit que l’ébéniste du siècle dernier, et a fortiori que Robinson sur son île. Car avant même de commencer, le plus gros de la tâche a déjà été accompli par des machines. Les outils que j’utilise ne demandent qu’un minimum d’habileté. Je peux, par exemple, disposer d’outils capables d’exécuter sur commande n’importe quelle moulure, alors que l’ébéniste du siècle dernier aurait dû effectuer le travail au ciseau et à la gouge, outils dont l’emploi suppose un réel entraînement de la main et de l’œil. Les planches que j’achète sont déjà rabotées, les pieds tournés mécaniquement. Je peux même acheter la table en pièces détachées, qu’il ne reste plus qu’à assembler. Mon travail se borne alors à enfoncer quelques chevilles et à passer un bout de papier de verre. Et s’il en est ainsi dès à présent, cela ne peut qu’empirer dans un futur mécanisé. Avec les matériaux et les outils dont on disposera alors, il n’y aura plus la moindre possibilité d’erreur, et donc plus aucune place pour l’habileté manuelle. Fabriquer une table sera encore plus facile et encore plus ennuyeux qu’éplucher une pomme de terre. Dans de telles conditions, il est absurde de parler de « travail créatif ». Quoi qu’il en soit, les arts de la main (qui se transmettent par l’apprentissage) auront depuis longtemps disparu. Certains d’entre eux sont déjà morts, tués par la concurrence de la machine. Rendez-vous dans n’importe quel cimetière de campagne et essayez de trouver une pierre tombale correctement taillée qui soit postérieure à 1820. L’art, ou plutôt le métier de tailleur de pierre, s’est si bien perdu qu’il faudrait des siècles pour le ressusciter.
Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas conserver la machine et le travail créateur ? Pourquoi ne pas cultiver l’anachronisme sous la forme du divertissement à temps perdu ? Nombreux sont ceux qui ont caressé cette idée, de nature, selon eux, à apporter une solution simple et élégante aux problèmes posés par la machine. […] Celui qui s’est déplacé par des moyens primitifs dans un pays peu développé sait qu’il y a, entre ce type de voyage et les voyages modernes en train, auto, etc., autant de différence qu’entre la vie et la mort. Le nomade qui se déplace à pied ou à dos d’animal, avec ses bagages chargés sur un chameau ou une voiture à bœufs, éprouvera peut-être toute sorte de désagréments, mais au moins il vivra pendant ce temps. Alors que celui qui roule dans un train express ou vogue à bord d’un paquebot de luxe ne connaît en fait de voyage qu’un interrègne, une sorte de mort temporaire. […]
Le progrès mécanique tend ainsi à laisser insatisfait le besoin d’effort et de création présent en l’homme. Il rend inutile, voire impossible, l’activité de l’œil et de la main. L’apôtre du progrès vous dira parfois que cela est sans grande importance, mais il est généralement assez facile de lui clouer le bec en poussant à l’extrême les conséquences de cette manière de voir les choses. Ainsi, pourquoi continuer à se servir de ses mains pour se moucher, par exemple, ou pour tailler un crayon ? Il serait certainement possible d’adapter sur ses épaules un dispositif de caoutchouc et d’acier, quitte à laisser ses bras se transformer en moignons où ne resteraient que la peau et les os. Et continuer dans cette voie pour chaque organe et chaque faculté. Il n’y a vraiment aucune raison impérative pour qu’un être humain fasse autre chose que manger, boire, dormir, respirer et procréer ; tout le reste pourrait être fait par des machines qui agiraient à sa place. C’est pourquoi l’aboutissement logique du progrès mécanique est de réduire l’être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal. Tel est l’objectif vers lequel nous nous acheminons déjà, même si nous n’avons, bien sûr, aucunement l’intention d’y parvenir : de même qu’un homme buvant quotidiennement une bouteille de whisky ne le fait pas dans l’intention bien arrêtée d’y gagner une cirrhose du foie. La fin implicite du progrès, ce n’est peut-être pas tout à fait le cerveau dans le bocal, mais c’est à coup sûr un effroyable gouffre où l’homme —le sous-homme — s’abîmerait dans la mollesse et l’impuissance.
Et le malheur, c’est qu’aujourd’hui les mots de « progrès » et de « socialisme » sont liés de manière indissoluble dans l’esprit de la plupart des gens. On peut tenir pour certain que l’adversaire résolu du machinisme est aussi un adversaire résolu du socialisme. Le socialiste n’a à la bouche que les mots de mécanisation, rationalisation, modernisation — ou du moins croit de son devoir de s’en faire le fervent apôtre. Ainsi, tout récemment, un personnage en vue du parti travailliste indépendant m’a confessé, avec une sorte de retenue mélancolique — comme s’il y avait là quelque chose de vaguement indécent — qu’il avait « la passion des chevaux ». Car voyez-vous, le cheval appartient à un passé terrien révolu et la nostalgie est toujours entachée d’un vague parfum d’hérésie. Je ne pense pas quant à moi que cela soit justifié, mais c’est un fait : Un fait qui, à lui seul, suffit à expliquer les distances que prennent vis-à-vis du socialisme les honnêtes gens.
Il y a une génération, tout individu doté d’intelligence était d’une certaine façon un révolutionnaire. Aujourd’hui, on serait plus près de la vérité en affirmant que tout individu intelligent est réactionnaire. A cet égard, il n’est pas sans intérêt de mettre en parallèle Le Dormeur se réveille d’H. G. Wells et Le Meilleur des mondes d’Huxley, écrits à trente années de distance. Dans les deux cas on a affaire à une Utopie pessimiste, à l’évocation d’une sorte de paradis du pharisien concrétisant tous les rêves de l’individu « progressiste ». Considéré sous le seul angle de l’œuvre d’imagination, Le Dormeur se réveille est à mon sens très supérieur, mais on y trouve d’énormes contradictions, et cela parce que Wells, en sa qualité de grand prêtre du progrès, est incapable d’écrire avec quelque conviction contre ce même progrès. Il nous présente le tableau d’un monde resplendissant et sournoisement inquiétant où les classes privilégiées connaissent une vie placée sous le signe d’un hédonisme pusillanime et superficiel tandis que les travailleurs, réduits à un état de total esclavage et maintenus dans une ignorance les ravalant au rang de sous-hommes, peinent comme des troglodytes dans des cavernes creusées sous la terre. Il suffit d’examiner l’idée de base — reprise dans une très belle nouvelle contenue dans les Stories of Space and Time — pour en découvrir toute l’absurdité logique. Car dans le monde outrancièrement mécanisé qu’imagine Wells, pourquoi les ouvriers devraient-ils travailler plus durement qu’aujourd’hui ? De toute évidence, la machine tend à supprimer le travail, et non à l’accroître. Dans une civilisation des machines, les ouvriers pourraient être réduits en esclavage, mal traités, voire sous-alimentés, mais ils ne sauraient être condamnés à travailler sans cesse avec leurs bras. Car alors, quel serait le rôle de la machine ? Il peut y avoir des machines pour faire tout le travail, ou des êtres humains, mais pas les deux à la fois. Ces années d’ouvriers troglodytes, avec leurs uniformes bleus et leur langage adultéré, à peine humain, ne sont là que pour vous donner la chair de poule. Wells entend signifier que le progrès peut se fourvoyer ; mais la seule conséquence funeste qu’il imagine, c’est l’inégalité — une classe qui s’adjuge toute la richesse et tout le pouvoir, et qui opprime le reste de l’humanité, par pur caprice apparemment. Modifiez très légèrement cette optique, semble dire l’auteur, renversez la classe privilégiée — en fait, passez du capitalisme mondial au socialisme — et tout sera pour le mieux. La civilisation machiniste doit être préservée, mais il faut en répartir équitablement les fruits. L’idée que Wells se refuse à regarder en face, c’est que la machine puisse être le véritable ennemi. Et c’est pourquoi ses utopies les plus révélatrices (The Dream, Men Like Gods, etc.) marquent un retour à l’optimisme et à la vision d’une humanité « libérée » par la machine, s’incarnant dans une race d’êtres éclairés uniquement occupés à paresser au soleil et à se féliciter d’être si supérieurs à leurs ancêtres.
Le Meilleur des mondes témoigne d’une autre époque et d’une génération qui a percé à jour le mythe du progrès. C’est une œuvre qui n’est pas exempte de contradictions (la plus importante ayant été signalée par M. John Strachey dans The Coming Struggle for Power), mais qui n’en constitue pas moins un coup mémorable asséné au perfectionnisme de l’espèce la plus suffisante. Par-delà le parti pris de charge, l’ouvrage exprime sans doute l’attitude d’une majorité de gens doués de raison vis-à-vis de la civilisation machiniste.
[…] Il suffit d’ouvrir les yeux autour de soi pour constater les rapides et sinistres progrès qu’enregistre la machine dans son entreprise d’assujettissement. A commencer par l’effrayante perversion du goût dont nous sommes redevables à un siècle de mécanisation. C’est là un fait presque trop évident, trop reconnu de tous pour qu’il soit besoin de s’y attarder. Mais prenons le seul exemple du goût au sens le plus étroit — celui qui vous pousse à consommer une nourriture convenable. Dans les pays hautement mécanisés, les aliments en boîte, la conservation par le froid, les arômes synthétiques ont fait du palais un organe quasiment mort. Comme vous pouvez vous en rendre compte chez n’importe quel marchand de fruits et légumes, ce que la majorité des Anglais appellent une pomme, c’est un morceau de ouate vivement coloré en provenance d’Amérique ou d’Australie. Les Anglais dévorent, apparemment avec plaisir, ce genre de chose et laissent pourrir sous l’arbre les pommes de leur pays. C’est l’aspect brillant, standardisé, mécanisé des pommes américaines qui les séduit ; le goût bien supérieur de la pomme anglaise est un fait qui leur échappe, purement et simplement. Considérez encore, chez l’épicier, ces fromages industriels enveloppés de papier d’étain, et ce beurre « de mélange » ; regardez ces hideux alignements de boîtes de fer blanc qui envahissent chaque jour un peu plus les étagères des comestibles, et même des crémeries. Regardez une bûche à six pence ou une glace à deux pence ; regardez les misérables sous-produits chimiques que les gens s’enfournent dans le gosier en croyant boire de la bière. Partout vous assisterez au triomphe de l’article tape-à‑l’œil fabriqué à la chaîne sur le produit traditionnel ayant encore un goût différent de celui de la sciure de bois. Et ce qui vaut pour les aliments s’applique aussi aux meubles, aux maisons, aux vêtements, aux livres, aux distractions, à tout ce qui constitue notre cadre de vie. Ils sont aujourd’hui des millions — et leur nombre ne cesse de croître — ces gens pour qui les crachotements nasillards de la T.S.F. constituent un fond sonore non seulement plus approprié mais aussi plus naturel que les meuglements des troupeaux ou le chant des oiseaux. La mécanisation du monde ne saurait aller très loin si le goût, même réduit aux seules papilles gustatives, demeurait intact, car dans ce cas la plupart des produits de la machine ne trouveraient tout bonnement pas preneur. Dans un monde en bonne santé, il n’y aurait pas de demande pour les boîtes de conserves, l’aspirine, les gramophones, les chaises en tubes, les mitrailleuses, les journaux quotidiens, les téléphones, les automobiles, etc. ; on se disputerait, en revanche, les objets que la machine est incapable de produire. Mais la machine est là et ses ravages sont presque impossibles à endiguer. On la voue aux gémonies mais on continue à l’utiliser. Pour peu qu’on lui en donne l’occasion, un sauvage allant les fesses au vent s’imprégnerait en quelques mois des vices de la civilisation. La mécanisation conduit à la perversion du goût, la perversion du goût à une demande accrue d’articles fabriqués à la machine, et donc à une mécanisation toujours plus poussée, et c’est ainsi que la boucle est bouclée. Mais il y a plus : la mécanisation du monde tend à se développer d’une manière en quelque sorte automatique, indépendamment de notre volonté. Ceci parce que, chez l’Occidental d’aujourd’hui, la faculté d’invention mécanique s’est trouvée constamment stimulée et encouragée au point de faire presque figure d’instinct second. On invente de nouvelles machines et on perfectionne celles qui existent déjà de manière quasi inconsciente, comme un somnambule qui se lèverait au milieu de la nuit pour aller travailler. Jadis, au temps où chacun était persuadé que la vie sur cette planète était cruelle, ou à tout le moins vouée au labeur, il semblait tout naturel de continuer à utiliser les outils imparfaits hérités des ancêtres, et il ne se trouvait que quelques rares illuminés pour proposer, de loin en loin, des innovations. Ainsi s’explique que le char à bœufs, la charrue ou la faucille aient pu traverser les siècles sans subir aucun changement. On a établi que la vis était connue dans la plus lointaine antiquité, mais il a fallu attendre le milieu du dix-neuvième siècle pour que quelqu’un s’avise de placer une pointe au bout. Pendant plusieurs milliers d’années, on s’est obstiné à forer des trous où pourraient s’insérer des vis à bout plat. Aujourd’hui, une telle chose serait inconcevable. Car l’actuel produit de la civilisation occidentale paraît doté d’un sens hypertrophié de l’invention. Pour lui, inventer des machines est un réflexe aussi naturel que la nage chez l’insulaire de Polynésie. Confiez à l’Occidental un quelconque travail à faire, et il entreprend aussitôt de concevoir une machine capable de le faire à sa place ; donnez-lui une machine, et il songe aussitôt au moyen de la perfectionner. Je comprends assez bien cette tendance car je me trouve moi-même pourvu de ce tour d’esprit, même s’il n’aboutit généralement à rien, ou à pas grand-chose. Je n’ai ni la patience ni la qualification mécanique requise pour concevoir la moindre machine susceptible de fonctionner, mais je vois perpétuellement défiler dans mon esprit, comme des zombies, des machines qui me dispenseraient de devoir faire travailler mes muscles ou mon cerveau. Un individu plus doué que moi pour la mécanique en construirait certainement quelques-unes et les ferait fonctionner. Mais dans le système économique qui est aujourd’hui le nôtre, la construction de ces machines — ou plutôt le destin public qu’elles connaîtraient — serait soumis aux impératifs du marché. Les socialistes ont donc raison quand ils affirment que le progrès mécanique connaîtra un rythme de développement beaucoup plus rapide une fois que le socialisme aura été instauré. Dans le cadre d’une civilisation mécaniste, le processus d’invention et de perfectionnement est appelé à se poursuivre sans cesse, mais la pente naturelle du capitalisme est de le freiner, car un tel système veut que toute invention ne rapportant pas de profits à très court terme soit négligée. Certaines même, qui menacent de réduire les profits, sont étouffées dans l’œuf aussi impitoyablement que le verre souple mentionné par Pétrone. Que le socialisme triomphe — et que disparaisse donc le principe de profit — et l’inventeur aura les mains libres. Le rythme de la mécanisation du monde, qui est déjà assez rapide, serait, ou en tout cas pourrait être, prodigieusement accéléré. Cette perspective ne laisse pas d’être inquiétante si l’on songe que nous avons d’ores et déjà perdu le contrôle du processus de mécanisation. Et ceci pour la simple raison que l’humanité a pris le pli. Un chimiste met au point un nouveau procédé de fabrication du caoutchouc synthétique, un ingénieur conçoit un nouveau type d’axe de piston : pourquoi ? Non pas dans un but clairement défini, mais simplement en vertu d’une force, devenue aujourd’hui instinctive, qui pousse ce chimiste ou cet ingénieur à inventer et à perfectionner. Mettez un pacifiste au travail dans une usine où l’on fabrique des bombes, et avant deux mois vous le trouverez en train de mettre au point un nouvel engin. Ainsi s’expliquent des inventions aussi diaboliques que les gaz asphyxiants, dont les auteurs ne s’attendent certainement pas à ce qu’elles se révèlent bénéfiques pour l’humanité. Notre attitude vis-à-vis des gaz, par exemple, devrait être celle du roi de Brobdingnag face à la poudre à canon. Mais, vivant dans une ère scientifique et mécanique, nous avons l’esprit perverti au point de croire que le « progrès » doit se poursuivre et que la science doit continuer à aller de l’avant, quoi qu’il en coûte. En paroles, nous serons tout prêts à convenir que la machine est faite pour l’homme et non l’homme pour la machine ; dans la pratique, tout effort visant à contrôler le développement de la machine nous apparaît comme une atteinte à la science, c’est-à-dire comme une sorte de blasphème. Et même si l’humanité tout entière se dressait soudain contre la machine et se prononçait pour un retour à un mode de vie plus simple, la tendance ne serait pas si facile à renverser. Il ne suffirait pas de briser, comme dans Erewhon de Butler, toutes les machines inventées postérieurement à une certaine date ; il faudrait encore briser la tournure d’esprit qui nous pousserait, presque malgré nous, à inventer de nouvelles machines aussitôt les anciennes détruites. Et cette disposition mentale est présente, ne fût-ce qu’à l’état larvé, en chacun de nous. Dans tous les pays du monde, la grande armée des savants et des techniciens, suivie tant bien que mal par toute une humanité haletante, s’avance sur la route du « progrès » avec la détermination aveugle d’une colonne de fourmis. On trouve relativement peu de gens pour souhaiter qu’on en arrive là, on en trouve beaucoup qui souhaitent de toutes leurs forces qu’on n’en arrive jamais là, et pourtant ce futur est déjà du présent. Le processus de la mécanisation est lui-même devenu une machine, un monstrueux véhicule nickelé qui nous emporte à toute allure vers une destination encore mal connue, mais selon toute probabilité vers un monde capitonné à la Wells, vers le monde du cerveau dans le bocal.
Tel est le procès instruit contre la machine. Que ce procès soit fondé ou non fondé, peu importe. Ce qui demeure, c’est que les arguments présentés, ou des arguments très voisins, recueilleraient l’assentiment de tout individu hostile à la civilisation machiniste. Et malheureusement, en raison du complexe associatif « socialisme-progrès-machinisme-Russie-tracteur-hygiène-machinisme-progrès » présent dans l’esprit de la quasi-totalité des gens, le même individu se trouve, en général, être également hostile au socialisme. Celui qui a en horreur le chauffage central et les chaises en tubes est aussi celui qui, dès que vous prononcez le mot de socialisme, grommelle quelque chose sur « l’État-ruche » et s’éloigne d’un air douloureux. Si j’en crois mes observations, très rares sont les socialistes qui comprennent la raison de ce phénomène, ou même qui en sont simplement conscients. Prenez à part un socialiste de l’espèce la plus exaltée, répétez-lui en substance tout ce que j’ai exposé dans ce chapitre, et attendez sa réponse. Je peux déjà vous dire que vous obtiendrez plusieurs réponses : je les ai tant de fois entendues que je les connais maintenant presque par cœur.
Pour commencer, il vous dira qu’il est impossible de « faire marche arrière » (ou de « retenir la main du progrès » — comme si cette main n’avait pas été brutalement retenue à maintes reprises dans l’histoire de l’humanité !), puis il vous taxera d’obscurantisme et vous récitera le couplet sur les calamités de toute sorte qui sévissaient au moyen âge, la lèpre, l’Inquisition, etc. En réalité, la plupart des griefs invoqués par les tenants de la modernité à l’encontre du moyen âge et, plus généralement, du passé sont sans objet dans la mesure où cela revient à projeter l’homme d’aujourd’hui, avec ses mœurs délicates et ses habitudes de confort douillet, dans un temps où ces notions n’avaient pas cours. Mais notez aussi que cette réponse n’en est pas une. Car l’aversion que peut inspirer un futur mécanisé n’implique aucune faiblesse coupable pour une quelconque période du passé. D. H. Lawrence, trop fin pour se laisser prendre au piège médiéviste, a choisi d’idéaliser les Étrusques, peuple dont, par une heureuse coïncidence, nous ne savons pas grand-chose. Mais nul besoin n’est d’idéaliser les Étrusques, les Pélasges, les Aztèques, les Sumériens ou toute autre civilisation parée par sa disparition d’une aura romantique. Si l’on se représente une forme souhaitable de civilisation, c’est uniquement en tant qu’objectif à atteindre, sans qu’il faille pour cela lui trouver une caution en un point quelconque du temps ou de l’espace. Enfoncez bien ce clou, expliquez que ce que vous souhaitez, c’est parvenir à une vie plus simple et plus dure au lieu d’une vie plus molle et plus compliquée, et le socialiste vous rétorquera presque inévitablement que vous voulez revenir à « l’état de nature », c’est-à-dire à quelque nauséabonde caverne du paléolithique : comme s’il n’y avait pas de moyen terme entre un éclat de silex et les aciéries de Sheffield, entre une pirogue primitive et le Queen Mary ! [et comme si ce dégoût du passé, cette diabolisation des premiers temps de l’être humain sur Terre, des temps qui représentent également 99,9% de l’existence humaine, était justifié, ou sensé, comme si étant malheureux ou mal embarqué aujourd’hui, il était logique que l’être humain le fut davantage par le passé, dans cette pré-histoire crasseuse, débile, triste et malsaine. Ce dénigrement du passé est une condition première du succès du progressisme, élaboré, propagé et instillé par la culture dominante. NdE]
Vous obtiendrez, à la longue, une réponse un peu plus adéquate, que l’on peut en gros résumer comme suit : « Oui, tout ce que vous dites est fort beau, et ce serait très bien de notre part de nous endurcir, d’apprendre à nous passer de l’aspirine, du chauffage central, etc. L’ennui, voyez-vous, c’est que personne n’en a vraiment envie. Cela signifierait un retour au mode de vie rural — c’est-à-dire travailler du matin au soir comme des bêtes, et c’est une tout autre affaire que de faire un peu de jardinage à ses moments perdus. Je n’ai pas envie de faire un travail de forçat, vous n’avez pas envie de faire un travail de forçat, personne n’en a envie dès qu’il sait ce que cela représente. Si vous parlez comme vous le faites, c’est que vous n’avez jamais de toute votre vie travaillé toute une journée », etc.
Il y a là-dedans une part de vérité. Cela revient à dire : « Nous sommes mous — eh bien, pour l’amour du ciel, qu’on nous laisse à notre mollesse ! », argument qui a le mérite du réalisme. Comme je l’ai déjà signalé, la machine nous tient et nous tient bien, et il sera extrêmement difficile de lui échapper. Cette réponse n’en est pas moins une échappatoire, dans la mesure où elle élude la question de savoir ce que nous entendons vraiment par « avoir envie » de ceci ou de cela. Je suis un semi-intellectuel décadent du monde moderne, et j’en mourrais si je n’avais pas mon thé du matin et mon New Statesman chaque vendredi. Manifestement, je n’ai pas envie de revenir à un mode de vie plus simple, plus dur, plus fruste et probablement fondé sur le travail de la terre. En ce même sens, je n’ai pas « envie » de me restreindre sur la boisson, de payer mes dettes, de prendre davantage d’exercice, d’être fidèle à ma femme, etc. Mais en un autre sens, plus fondamental, j’ai envie de tout cela, et peut-être aussi en même temps d’une civilisation où le « progrès » ne se définirait pas par la création d’un monde douillet à l’usage des petits hommes grassouillets.
Les arguments que je viens de résumer sont à peu près les seuls qu’ont trouvé à m’opposer les socialistes — j’entends les socialistes conscients, nourris de livres, à chaque fois que j’ai tenté de leur expliquer comment ils en arrivaient à faire fuir les adhérents potentiels. Bien sûr il y a toujours cette vieille rengaine selon laquelle le socialisme s’instaurera de toute façon, que les gens le veuillent ou non, par la grâce de cette merveille qu’est la « nécessité historique ». Mais la nécessité historique, ou plutôt la foi qu’on pouvait avoir en elle, n’a pas survécu à la venue d’Hitler.
En attendant, l’homme de réflexion, généralement de gauche par ses idées mais souvent de droite par tempérament, ne se décide pas à franchir le pas. Assurément, il se rend compte qu’il devrait être socialiste. Mais, constatant l’épaisseur d’esprit des socialistes pris individuellement, puis la mollesse flagrante des idéaux socialistes, il passe son chemin. Jusqu’à une date récente, il était naturel de se réfugier dans l’indifférentisme. Il y a dix ans, et même cinq ans, l’homme de lettres typique rédigeait des monographies sur l’architecture baroque et planait en esprit bien au-dessus de la politique. Mais cette attitude devient difficile à soutenir, et même franchement démodée. La vie est de plus en plus âpre, les questions apparaissent sous un jour plus cru, la conviction que rien ne saurait changer (c’est-à-dire que vos dividendes seront préservés) commence à battre de l’aile. La haute palissade sur laquelle perche notre homme de lettres, qui lui paraissait naguère encore aussi confortable que le coussin de peluche d’une stalle de cathédrale, commence à lui meurtrir cruellement les fesses, et, de plus en plus, il se demande de quel côté tomber. Il serait amusant de recenser les bons auteurs qui, il y a une douzaine d’années, se posaient en champions de l’art pour l’art et auraient jugé d’une inconcevable vulgarité de mêler leurs voix à un scrutin, fût-ce pour une élection générale, et qui aujourd’hui prennent fermement position en matière politique. Alors que la plupart des jeunes écrivains, tout au moins ceux qui ne sont pas de simples gâche-papier, sont « politiques » depuis le début de leur carrière. Je crains qu’il n’y ait, pour cause de mal aux fesses, un terrible danger de voir les forces vives de l’intelligentsia se tourner vers le fascisme. Quand les fesses seront-elles vraiment trop meurtries, c’est difficile à dire. Cela dépendra vraisemblablement des événements en Europe. Mais le seuil critique pourrait être atteint d’ici deux ans — peut-être même un an. Et ce sera aussi le moment où tout individu ayant un tant soit peu de jugement ou de respect de soi sentira, du plus profond de lui-même, qu’il est de son devoir de se ranger dans le camp socialiste. Mais cela ne se fera pas tout seul. Trop de vieux préjugés encombrent encore la route. Il faudra le convaincre, et pour ce faire user de méthodes qui prennent son point de vue propre en considération. Les socialistes ont assez perdu de temps à prêcher des convertis. Il s’agit pour eux, à présent, de fabriquer des socialistes, et vite. Or, trop souvent, ce sont des fascistes qu’ils fabriquent. […]
Pour combattre le fascisme, il est nécessaire de le comprendre, c’est-à-dire d’admettre qu’il y a en lui un peu de bon à côté de beaucoup de mauvais. Dans la pratique, bien sûr, ce n’est qu’une odieuse tyrannie utilisant, pour arriver au pouvoir et s’y maintenir, des méthodes telles que même ses plus chauds partisans préfèrent parler d’autre chose si la question vient sur le tapis. Mais le sentiment fasciste sous-jacent, le sentiment qui pousse les gens dans les bras du fascisme est peut-être parfois moins méprisable. Ce n’est pas toujours, comme on pourrait le croire à la lecture du Saturday Review, la peur panique de l’épouvantail bolchevik qui est déterminante. Tous ceux qui se sont un tant soit peu penchés sur le phénomène savent que le fasciste « du rang » est bien souvent un individu animé des meilleures intentions, sincèrement désireux, par exemple, d’améliorer le sort des chômeurs. Mais encore plus significatif est le fait que le fascisme tire sa force aussi bien des bonnes que des mauvaises variétés de conservatisme. Il séduit tout naturellement ceux qui ont un penchant pour la tradition et la discipline. Il est sans doute très facile, quand on a subi jusqu’à l’écœurement la plus impudente propagande socialiste, de voir dans le fascisme la dernière ligne de défense de tout ce qu’il y a de précieux dans la civilisation européenne. Le nervi fasciste sous son jour le plus tristement symbolique — matraque en caoutchouc d’une main et bouteille d’huile de ricin de l’autre — ne se sent pas forcément l’âme d’une brute aux ordres : il se voit plus probablement tel Roland à Ronceveaux, défenseur de la chrétienté contre les barbares. Il faut bien reconnaître que si le fascisme est partout en progrès, la faute en incombe très largement aux socialistes. Et ceci est dû en partie à la tactique communiste de sabotage de la démocratie — tactique aberrante qui revient à scier la branche sur laquelle on est assis —, mais aussi et surtout au fait que les socialistes ont, pour ainsi dire, présenté leur cause par le mauvais bout. Ils ne se sont jamais attachés à montrer de manière suffisamment nette que le socialisme a pour fins essentielles la justice et la liberté. L’œil rivé sur le fait économique, ils ont toujours agi comme si l’âme n’existait pas chez l’homme et, de manière explicite ou implicite, lui ont proposé comme objectif suprême l’instauration d’une Utopie matérialiste. Grâce à quoi le fascisme a pu jouer de tous les instincts en révolte contre l’hédonisme et une conception à vil prix du « progrès ». Il a pu se poser en champion de la tradition européenne, annexer à son profit la foi chrétienne, le patriotisme et les vertus militaires. Il est trop facile de rayer d’un trait de plume le fascisme en parlant de « sadisme de masse » ou en recourant à toute autre formule facile du même acabit. Si vous affirmez qu’il ne s’agit que d’une aberration passagère qui disparaîtra comme elle est venue, vous vous mouvez dans un rêve dont vous pourriez bien être tiré le jour où quelqu’un vous caressera la tête avec une matraque en caoutchouc. La seule démarche possible, c’est ouvrir le débat sur le fascisme, entendre ses arguments, et ensuite proclamer à la face du monde que tout ce qu’il peut y avoir de bon dans le fascisme est aussi implicitement contenu dans le socialisme.
L’heure est grave, très grave. À supposer qu’aucune plus grande catastrophe ne s’abatte sur nous, il y a la situation que j’ai décrite dans la première partie de ce livre, situation qui ne saurait s’améliorer dans le cadre du système économique actuel. Encore plus pressant est le danger d’une mainmise fasciste sur l’Europe. Et, à moins que la doctrine socialiste ne connaisse une diffusion très large et très rapide dans une formulation efficace, rien n’autorise à penser que le fascisme sera un jour vaincu. Car le socialisme est le seul véritable ennemi que le fascisme ait à affronter. Il ne faut pas compter sur les gouvernements impérialistes-capitalistes, même s’ils se sentent eux-mêmes sur le point d’être assaillis et plumés comme des volailles, pour lutter avec quelque conviction contre le fascisme en tant que tel. Nos dirigeants, du moins ceux qui comprennent les données du problème, préféreraient sans doute céder jusqu’au dernier pouce de l’empire britannique à l’Italie, à l’Allemagne et au Japon plutôt que de voir le socialisme triompher. Il était facile de rire du fascisme quand nous nous imaginions qu’il était fondé sur une hystérie nationaliste, parce qu’il paraissait alors évident que les États fascistes, se considérant chacun comme le peuple élu et l’incarnation du patriotisme contra mundum, allaient se déchirer les uns les autres. Mais rien de tel ne s’est produit. Le fascisme est aujourd’hui un mouvement international, ce qui veut dire non seulement que les nations fascistes peuvent s’associer dans des buts de pillage, mais aussi qu’elles tendent, d’une manière qui n’est peut-être pas encore absolument concertée, vers l’instauration d’une hégémonie mondiale. Car à l’idée d’un État totalitaire commence à se substituer sous nos yeux l’idée d’un monde totalitaire. Comme je l’ai déjà signalé, le progrès de la technique machiniste doit en fin de compte conduire à une forme de collectivisme, mais une forme qui ne sera pas nécessairement égalitaire. C’est-à-dire, qui ne serait pas forcément le socialisme. N’en déplaise aux économistes, il est très facile d’imaginer une société mondiale, placée économiquement sous le signe du collectivisme (c’est-à-dire ayant éliminé le principe de profit), mais où tout le pouvoir politique, militaire et pédagogique se trouverait concentré entre les mains d’une petite caste de dirigeants et d’hommes de main. Une telle société, ou quelque chose de très voisin, voilà l’objectif du fascisme. Et cette société, c’est bien sûr l’État esclavagiste, ou plutôt le monde esclavagiste. Ce serait vraisemblablement une société stable et, si l’on considère les immenses richesses que recèle un monde scientifiquement mis en valeur, on peut penser que les esclaves seraient convenablement nourris et entretenus, de manière à être satisfaits de leur sort. On a l’habitude d’assimiler l’ambition fasciste à la mise en place d’un État-ruche — ce qui est faire gravement injure aux abeilles. Il serait plus approprié de parler d’un monde de lapins gouverné par des furets. C’est contre cette sinistre éventualité que nous devons nous unir.
La seule chose au nom de laquelle nous pouvons combattre ensemble, c’est l’idéal tracé en filigrane dans le socialisme : justice et liberté. Mais ce filigrane est presque complètement effacé. Il a été enfoui sous des couches successives de chicaneries doctrinales, de querelles de parti et de « progressisme » mal assimilé, au point de ressembler à un diamant caché sous une montagne d’excréments. La tâche des socialistes est d’aller le chercher où il se trouve pour le mettre à jour. Justice et liberté ! Voilà les mots qui doivent résonner comme un clairon à travers le monde. Depuis déjà un bon bout de temps, et en tout cas au cours des dix dernières années, le diable s’est adjugé les meilleurs airs. Nous en sommes arrivés à un point où le mot de socialisme évoque, d’un côté, des avions, des tracteurs et d’immenses et resplendissantes usines à ossature de verre et de béton ; et de l’autre côté, des végétariens à la barbe flétrie, des commissaires bolcheviks (moitié gangster, moitié gramophone), des dames au port digne et aux pieds chaussés de sandales, des marxistes à la chevelure ébouriffée mâchouillant des polysyllabes, des Quakers en goguette, des fanatiques du contrôle des naissances et des magouilleurs inscrits au parti travailliste. Le socialisme, du moins dans cette île qui est la nôtre, ne sent plus la révolution et le renversement des tyrannies, mais l’excentricité incohérente, le culte de la machine et la stupide béatification de la Russie. Si l’on ne fait pas disparaître cette odeur, et vite, le fascisme peut gagner.
Georges Orwell
Source : L’incohérence du socialisme : le mythe du progrès et le culte de la machine (par George Orwell)


